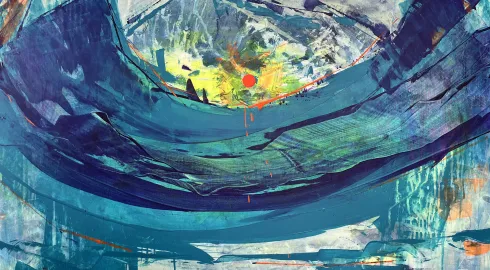Les articles du dossier sont réunis et publiés sous le titre Penser l'après-COVID-19 [PDF].
[Tous les articles du présent dossier, coordonné par Catherine Girard, Isabelle Laforest-Lapointe et Félix Mathieu, ont été publiés initialement dans le journal La Presse, du 4 au 20 mai 2020, sous le titre La relève pense le Québec de l'après-COVID-19]
Cela fait maintenant plus d’un siècle que les épidémiologistes s’intéressent à la modélisation des maladies infectieuses. Les études pionnières d’Anderson McKendrick et William Kermack ont proposé une série d’équations visant à prédire comment une population sera affectée par une maladie lorsque le risque de contamination varie à travers les différents groupes d’âge.
Leurs travaux ont établi les bases de milliers d'articles scientifiques qui ont permis de répondre à de multiples questions fondamentales en santé publique et en épidémiologie. Est-ce qu’une épidémie va se déclencher (quel est le fameux R0)? Quelle proportion de la population aura été infectée à la fin de l’épidémie? Combien de personnes faut-il vacciner pour contrôler et éventuellement éradiquer une maladie infectieuse? Toutes ces interrogations sont en fait des questions d’ordre mathématique, auxquelles les modèles apportent des réponses… mathématiques.
Des mathématiques à la santé publique
Utiliser un modèle mathématique pour comprendre un système biologique, c’est comme faire voler un avion en papier : on peut développer des intuitions sur la portance, sur la forme des ailes, sur la résistance de l’air… mais on n’en retire pas vraiment les informations nous permettant de faire voler un avion réel. Les épidémiologistes qui ont poursuivi les réflexions de Kermack et McKendrick l’avaient d’ailleurs bien compris. C’est pourquoi ils ont eu tendance à simplifier leurs modèles.
L’utilisation d’un modèle mathématique ne vise généralement pas la compréhension d’une épidémie spécifique (par exemple la COVID-19). Plutôt, les modèles permettent de décrire comment les épidémies se propagent, dans le monde abstrait des mathématiques.
Il ne fait aucun doute que les outils mathématiques de modélisation des épidémies sont importants. Même à l’aide d’un modèle très simple, un chercheur peut diminuer le taux de transmission afin de visualiser la courbe qui s'aplatit; identifier les caractéristiques de l’épidémie qui prennent le plus de temps à disparaître; observer la diminution du nombre total de personnes malades en même temps. De plus, les modèles nous permettent de confirmer que la distanciation sociale, ça marche!
Ce qu’on ne peut pas faire avec un modèle simple, en revanche, c’est prédire combien de personnes seront malades dans notre quartier, dans notre province, ou dans le monde. Pour ça, il faut faire un vrai travail de prédiction, et il s’agit d’un défi de taille.
La difficulté du travail de prédiction provient du fait qu’il faut faire communiquer au moins deux mondes : les abstractions mathématiques et le monde réel. Dans le cas des maladies infectieuses, cela veut dire la réalité du système de santé, mais aussi celle des décisions politiques!
De la description à la prédiction
La difficulté du travail de prédiction provient du fait qu’il faut faire communiquer au moins deux mondes : les abstractions mathématiques et le monde réel. Dans le cas des maladies infectieuses, cela veut dire la réalité du système de santé, mais aussi celle des décisions politiques!
Si on ignore la décision soudaine du gouvernement du Québec de ne plus faire de différence entre les cas confirmés et les cas supposés de COVID-19, cela pourrait amener les chercheurs à créer un modèle de prédiction erroné. En bref, les systèmes épidémiques et pandémiques répondent à leurs propres contraintes biologiques, mais aussi à des décisions externes. Saisir cette subtilité dans les modèles exige une étroite collaboration entre une grande diversité d’acteurs. Ce n’est pas un exercice académique, même pas un exercice mathématique : c’est surtout un exercice de communication et d’accès à l’information.
L’apport de l’intelligence artificielle
On a de plus en plus tendance à se tourner vers l’intelligence artificielle (IA). Cette méthode donne souvent des prédictions très précises. Mais sont-elles utiles? Ce qui reste particulièrement complexe, c’est de lier les prédictions de l’IA aux connaissances des biologistes. Ce n’est pas seulement parce que les algorithmes peinent à intégrer ces connaissances, mais aussi parce que les savoirs des biologistes sont souvent difficiles à comprendre pour les non-initiés.
Pour réagir rapidement à une pandémie, nous avons besoin de tous ces ingrédients : des prédictions précises, qu’on peut interpréter et comprendre, et qui nous éclairent sur les mécanismes qui régissent les épidémies. Parce qu’alors même que nous subissons les effets de la COVID-19, il faut se préparer à la prochaine épidémie.
Tout ceci doit nous motiver à repenser la formation des biologistes. Que ce soit pour les épidémies, pour les changements climatiques, pour les déversements pétroliers, pour l’étalement urbain ; il va falloir faire plus de prédictions, et plus vite. On ne peut pas simplement se débarrasser du problème en supposant que l’IA va faire ce travail pour nous. Les universités québécoises devraient donc se donner les moyens de former des biologistes polyglottes, capables de communiquer leur expertise d’une façon qui soit accessible aux non-biologistes. Les biologistes gagneront aussi à être à l’aise autant avec un sarrau qu’avec une paire de jumelles que devant un ordinateur. C’est ainsi que nous comprendrons comment les nouvelles méthodes de la science des données peuvent amplifier notre impact positif sur la société.
Que ce soit pour les épidémies, pour les changements climatiques, pour les déversements pétroliers, pour l’étalement urbain ; il va falloir faire plus de prédictions, et plus vite. On ne peut pas simplement se débarrasser du problème en supposant que l’IA va faire ce travail pour nous. Les universités québécoises devraient donc se donner les moyens de former des biologistes polyglottes, capables de communiquer leur expertise d’une façon qui soit accessible aux non-biologistes. Les biologistes gagneront aussi à être à l’aise autant avec un sarrau qu’avec une paire de jumelles que devant un ordinateur. C’est ainsi que nous comprendrons comment les nouvelles méthodes de la science des données peuvent amplifier notre impact positif sur la société.
- Timothée Poisot
Université de Montréal
Timothée Poisot est professeur adjoint en sciences biologiques à l'Université de Montréal.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre