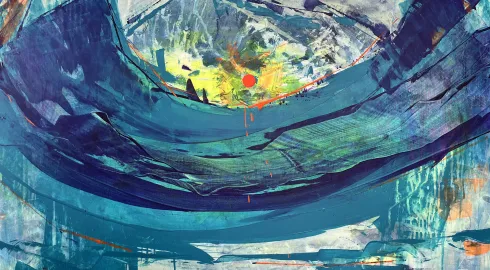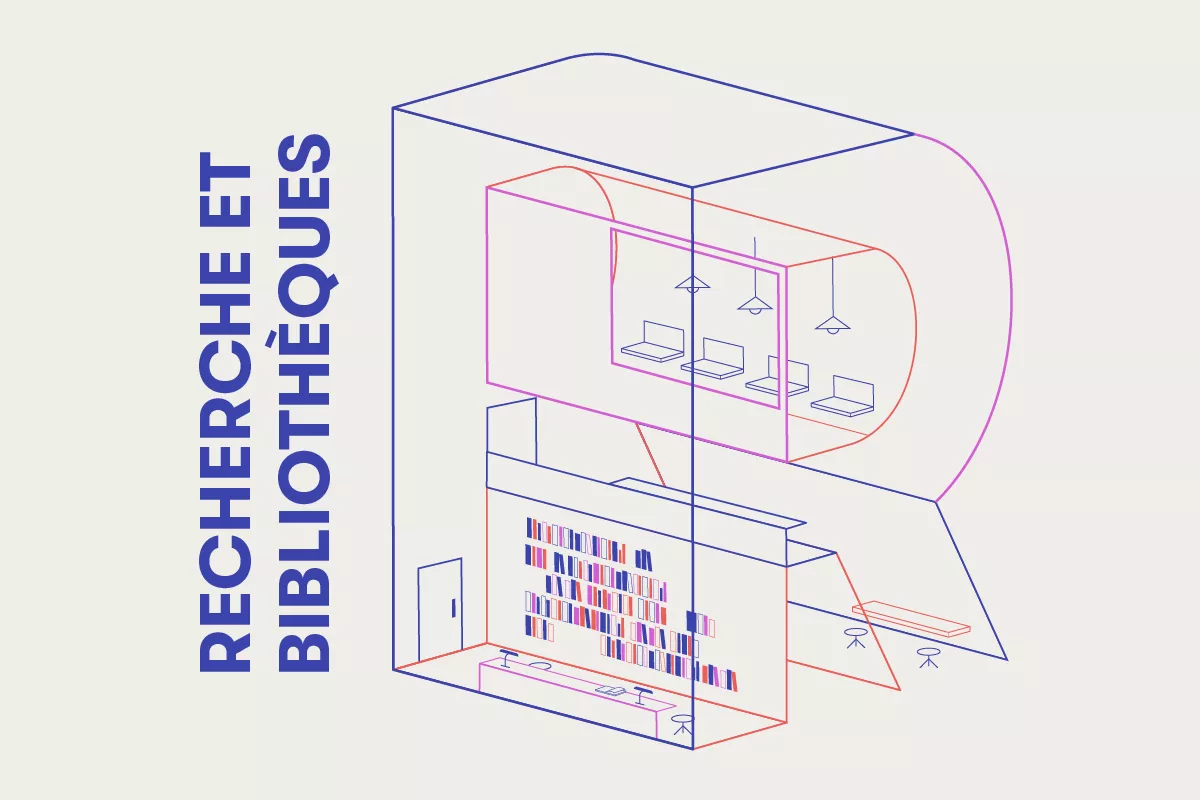La recherche et l'enseignement constituent les piliers fondamentaux de notre paysage éducatif et scientifique, et au cœur de ces activités se trouvent les bibliothèques, ces lieux souvent perçus comme silencieux, mais qui résonnent pourtant d'une intense activité intellectuelle. Ce « numéro spécial » a une importance particulière pour nous, car c’est la première fois qu’un dossier du Magazine de l’Acfas est entièrement dédié aux bibliothèques, aux bibliothécaires et à leurs contributions à la recherche et à l’enseignement. C’est un dossier historique!
Le fait d’être deux personnes non-francophones, francofolles et profondément francophiles, membres des communautés d’enseignement et de la recherche, engagé·es envers la langue française et la culture québécoise et canadienne, nous a permis d'observer comment les bibliothèques francophones, qu'elles soient universitaires, collégiales, publiques ou spécialisées, avec leurs approches distinctives, contribuent significativement à la recherche et l'avancement du savoir. En tant qu'hispanophone originaire du Mexique et anglophone né au Michigan d’origine coréenne, nous apportons un regard extérieur, mais passionné sur ces institutions qui transcendent les frontières linguistiques tout en préservant leurs particularités culturelles.
Sortir de l'ombre...
Ce numéro propose un temps d’arrêt pour reconnaître pleinement l'essentielle contribution des bibliothécaires à la recherche et à l'enseignement. Trop longtemps relégué au rôle passif de « gestion de dépôts des savoirs », le corps des bibliothécaires émerge aujourd'hui comme un acteur dynamique de la production et de la diffusion des connaissances.
Les bibliothèques ne sont pas seulement des espaces physiques remplis d'ouvrages classés sur des rayons à perte de vue; elles constituent de véritables laboratoires intellectuels, où se forgent les esprits critiques et où s'établissent des collaborations interdisciplinaires fécondes.
La bibliothèque moderne dépasse largement la conception traditionnelle. Dans le contexte collégial, elle joue un rôle fondamental dans la transition des étudiant·es vers l'université, leur offrant un premier contact avec la rigueur de la recherche documentaire et celle des méthodes d'analyse critique des sources. Les bibliothèques de recherche, quant à elles, qu'elles soient rattachées à des institutions universitaires, à une législature ou qu'elles soient indépendantes, comme les grands établissements patrimoniaux et les bibliothèques nationales, constituent des pôles d'excellence où s'élaborent des savoirs de pointe dans toutes les disciplines.
Quant aux bibliothèques publiques, ce bien commun si précieux, elles ont ce potentiel de se transformer en laboratoires citoyens, en universités populaires et autres. Si nous reconnaissons volontiers ces dernières comme les plus grandes infrastructures culturelles de notre société, nous oublions trop souvent qu’elles représentent également le réseau le plus vaste de diffusion des savoirs et d’accès à l’information au sein de nos communautés.
En 2019, les bibliothèques publiques du Québec ont enregistré près de 30 millions de visites. Si l’on y ajoute les quelque 4,5 millions d’entrées dans les bibliothèques collégiales et près de 10 millions d’entrées dans les bibliothèques universitaires, on atteint un total impressionnant d’environ 44,5 millions de visites dans les bibliothèques québécoises cette année-là.
Ces différentes typologies de bibliothèques forment un écosystème complexe où cohabitent ressources physiques et numériques, où s'articulent préservation du patrimoine et innovation technologique. Les articles de ce dossier explorent cette diversité et mettent en lumière comment les bibliothèques québécoises et de la francophonie canadienne évoluent tout en maintenant leur identité propre.
Par ailleurs, de la bibliothèque collégiale à la bibliothèque de recherche spécialisée ou universitaire, ces institutions jouent un rôle crucial dans la démocratisation de l’accès au savoir et à la culture, rendant accessibles des ressources parfois coûteuses ou difficiles d'accès aux étudiant·es et aux chercheur·euses de tout horizon. Cette dimension sociale mérite d'être valorisée, car elle contribue significativement à l'équité dans l'accès à l'éducation et à la qualité de la recherche.
Les bibliothécaires sous la lumière
Au-delà des clichés tenaces des « gardien·nes silencieux·euses à lunettes » imposant le calme dans les rayonnages, les bibliothécaires contemporain·nes assument des fonctions des plus diversifiées et passablement stratégiques. Loin d'être de simples gestionnaires de collections, les bibliothécaires sont devenu·es, rien de moins que des partenaires incontournables de la réussite éducative et de l'excellence en recherche.
Les bibliothécaires sont des expert·es en science de l'information, capables de naviguer dans l'océan de données et d’informations de notre ère numérique. Ils guident les usager·ères dans l'élaboration de stratégies de recherche efficaces, dans l’utilisation des bases de données et des moteurs de recherche, ils collaborent à l’élaboration des synthèses des connaissances, ils sont impliqués dans la préparation de plan de gestion de données de recherche, ils conseillent sur les questions de propriété intellectuelle et d'éthique de la publication, etc.
L'expertise des bibliothécaires dans la gestion des données de recherche et dans la connaissance des nouvelles pratiques de science ouverte est devenue indispensable aux avancées scientifiques contemporaines.
Les bibliothécaires sont également des bâtisseur·euses d’infrastructures vouées à la conservation, à la préservation et à la diffusion des savoirs. À travers leur engagement dans des projets tels que les dépôts institutionnels (CorpusUL, eScholarship, Papyrus, etc.), les plateformes Géoindex et Géophotos de la Bibliothèque de l’Université Laval, ou encore l’outil de découverte Sofia des bibliothèques universitaires québécoises, ils et elles contribuent à structurer des écosystèmes durables pour la recherche. Leur participation au Réseau Circé, qui vise à pérenniser les revues savantes québécoises, en est une autre illustration.
Pour tous les publics servis par les bibliothécaires, ils et elles sont des pédagogues qui enseignent les incontournables compétences informationnelles et numériques : évaluation critique des sources, méthodologie de recherche documentaire, et utilisation éthique de l'information. Ces compétences, bien au-delà du cadre académique, préparent les individus à devenir des citoyen·nes éclairé·es dans une société où l'information est omniprésente, mais de qualité et de fiabilité variables.
Plus récemment, nous avons observé l'émergence de nouveaux rôles pour les bibliothécaires, notamment au sein des comités d'éthique universitaires. Cette évolution témoigne de la reconnaissance de leur expertise en matière d'intégrité, et de leur vision holistique des enjeux liés à la création et à la diffusion des savoirs. Ce positionnement stratégique confirme que les bibliothécaires ne sont plus cantonné·es à un rôle périphérique, mais qu'ils et elles sont désormais acteurs et actrices au cœur de la gouvernance universitaire.
En conclusion
L'état actuel des bibliothèques et de la profession de bibliothécaire reflète une évolution profonde, toujours en mouvement. Si les défis sont nombreux – contraintes budgétaires, explosion des ressources numériques, évolution rapide des besoins des usagers, arrivée de l’IA générative –, les opportunités le sont tout autant.
La bibliothèque de demain, qu'elle soit collégiale, universitaire, publique ou spécialisée, se dessine comme un espace hybride, physique et virtuel, où l'expertise humaine des bibliothécaires demeure irremplaçable – et nous souhaitons souligner ici « irremplaçable » – , malgré l'automatisation croissante de nos pratiques universitaires et sociales. La profession continue de se réinventer et de s’adapter, intégrant de nouvelles compétences, tout en maintenant les valeurs fondamentales que sont l'accès équitable à l'information et le service à leurs communautés.
En définitive, les bibliothèques et leurs professionnel·les incarnent parfaitement cette capacité d'adaptation et de création qui caractérise les institutions éducatives et de recherche les plus résilientes. En tant que francophiles évoluant dans un environnement international d’enseignement et de la recherche, nous sommes convaincu·es que le modèle francophone de bibliothèque, avec sa tradition intellectuelle forte et son ouverture aux innovations, a beaucoup à apporter au dialogue global sur l'avenir de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Sachez que les textes de ce dossier ne sont qu’un début. Ce dossier est conçu pour s'accroître avec d'autres contenus à l’intersection des bibliothèques, de l’enseignement et de la recherche. Nous avons très hâte de voir ce dossier évoluer et recevoir de futures contributions de nos collègues. Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne réflexion!
- Daniela Zavala Mora
Université Laval
Daniela Zavala Mora est bibliothécaire à l'Université Laval, spécialisée en musique, alimentation et agriculture. Parfaitement trilingue (français, anglais, espagnol), elle détient une maîtrise en sciences de l’information et bibliothéconomie de l'Université McGill ainsi qu’une maîtrise en musique de l'Université Western Ontario. Son expertise professionnelle comprend les méthodologies de synthèses de connaissances et l’enseignement des compétences informationnelles et numériques. Elle a contribué à plusieurs publications scientifiques et a exercé comme co-présidente lors de la première édition entièrement en français de l'Institut de recherche des bibliothécaires de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Elle occupe actuellement la présidence de la Section québécoise de l’Association canadienne des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux.
- Michael David Miller
Université McGill
Michael David MILLER est bibliothécaire agrégé aux Bibliothèques de l’Université McGill, où il occupe le poste de bibliothécaire de liaison pour les littératures de langue française, les sciences économiques et les études de genre. Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’information (M.S.I.) de l’Université de Montréal (2013), il œuvre dans le milieu des bibliothèques universitaires depuis près de vingt ans, dont douze à titre de bibliothécaire. Naviguant entre les mondes bibliothéconomiques et wikimédiens francophone, catalanophone et anglophone, il s’intéresse aux croisements entre bibliothéconomie et Mouvement Wikimédia, notamment dans une perspective de découvrabilité des contenus scientifiques et culturels francophones, d’équité des savoirs et de démocratisation de l’accès aux savoirs. Il s’intéresse également aux rôles stratégiques et au statut des bibliothécaires dans l’écosystème de la recherche, ainsi que sur leur contribution à la préservation, à la diffusion et à la médiation des savoirs.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre