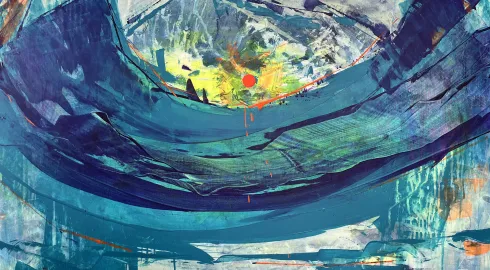Au sein des universités comme au cœur des institutions publiques québécoises en général, des tendances de gestion issues du secteur privé sont déployées pour cadrer l'organisation du travail. Quelles en sont les conséquences sur la capacité des universitaires de poursuivre les missions qui leur sont confiées par la société? Et comment réagir pour éviter les dérives?
Conversation entre Simon Viviers, Louis-Philippe Lampron et Chantal Pouliot
Chantal Pouliot : Au moment où on se parle, des questions à la fois vives et d’importance sont soulevées dans les universités en ce qui concerne l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité. Quelles sont celles qui vous interpellent en particulier?
Simon Viviers : Je suis interpellé par la dégradation des conditions d’exercice du travail dans les institutions publiques – écoles, services sociaux et de santé, universités – et par le peu de pouvoir, voire d’intérêt, que l’on accorde à la voix des travailleuses et des travailleurs. Par leurs savoirs d’expérience, leur expertise et leur connaissance fine de la réalité du terrain, ces personnes sont pourtant les premières à savoir ce qui est bon, bien, juste, désirable de faire dans le cadre de leur activité professionnelle, pour atteindre la mission qui leur est confiée et pour laquelle elles se sont engagées.
Or, actuellement, l’atteinte de cette mission est trop souvent empêchée, ou parfois c’est la mission même qui est détournée, ce qui mine le sens du travail et la mobilisation. Les travailleurs et travailleuses des institutions publiques, et c’est vrai pour nombre d’universitaires, sentent qu’ils ne peuvent pas exercer le cœur de leur métier, ce qui leur amènerait du plaisir, de la satisfaction, un sentiment du devoir accompli; bref, le sentiment de réaliser un travail défendable à leurs yeux. Ce « travail empêché » a des conséquences à la fois sur la qualité des tâches accomplies et sur la santé mentale des personnes qui les accomplissent. La crise des services publics – épuisement et détresse vécus massivement, multiplication des congés de maladie, décrochage professionnel, pénurie de main-d'œuvre – n’est pas surprenante dans ce contexte. Or, les organisations publiques font tout actuellement pour empêcher les travailleuses et travailleurs de témoigner de cette situation, en invoquant notamment le « devoir de loyauté ». Outre les journalistes, nous sommes les seuls, comme universitaires, à pouvoir lever le voile sur cette réalité dramatique.
Cela dit, nous sommes aussi largement affectés par ces tendances de gestion que j’associe à ce que le sociologue Vincent de Gaulejac appelle « l’idéologie gestionnaire ou managériale ». Issue du secteur privé, cette idéologie a progressivement pris racine au sein des institutions publiques, et on la voit en ce moment s’accentuer au cœur des universités. En fait, l’université managériale ressemble de plus en plus à une grande entreprise privée : elle est gouvernée d’abord et avant tout selon des indicateurs économiques et vise à attirer des « ressources » financières, réputationnelles, humaines.
Les centres de recherche qui s’y trouvent sont jaugés et comparés entre eux à l’aulne de l’argent rapporté en subventions, du nombre d’étudiantes et d'étudiants recrutés et diplômés, du nombre d’articles publiés dans des revues à comité de lecture, etc. Ces critères constituent des contraintes fortes sur la carrière des professeur-e-s et minent le sens même de leur travail, voire de leur santé psychologique, comme l’ont montré mes collègues Chantal Leclerc et Bruno Bourassa1. Pourtant, les professeur-e-s bénéficient d’une liberté universitaire protégée par leur convention collective, liberté qui implique notamment une critique de l’institution même : comment comprendre, donc, cette impuissance vécue et ressentie par rapport aux conditions d’exercice de leurs fonctions? Je pense qu’il faut explorer là une hypothèse culturelle, c’est-à-dire qu’au-delà du droit formel – par exemple, convention collective –, il y a des normes, des discours et des pratiques qui se développent et s’intériorisent de manière insidieuse. Ils nuisent à notre capacité à rendre effectifs ces droits formels, à accéder à ce qu’Amartya Sen appelle « la liberté réelle ».
...nous sommes aussi largement affectés par ces tendances de gestion que j’associe à ce que le sociologue Vincent de Gaulejac appelle "l’idéologie gestionnaire ou managériale". Issue du secteur privé, cette idéologie a progressivement pris racine au sein des institutions publiques, et on la voit en ce moment s’accentuer au cœur des universités.
Louis-Philippe Lampron : Pour ma part, je partage entièrement la lecture que fait Simon à propos de la montée en puissance de l’idéologie managériale au sein des universités québécoises et, plus largement, occidentales. Dans ce contexte, l’enjeu qui m’interpelle tout particulièrement tient à la préservation de la mission d’intérêt public des universités, qui constitue la raison d’être d’une garantie institutionnelle comme la liberté académique. Cette mission, comme tu le mentionnes dans ta question Chantal, va bien au-delà de ce qui est transmis dans les seules salles de classe. Elle concerne également la recherche et sa diffusion. Elle permet notamment aux universités et aux universitaires de fournir à l’ensemble de la population des connaissances rigoureuses et fiables dont les citoyennes et citoyens ont besoin pour prendre part aux affaires sociétales. Je réfléchis donc aux prises de position normatives susceptibles d’assurer une protection plus robuste de la liberté académique (que je préfère à « liberté universitaire » parce que les enjeux qui concernent la recherche touchent un éventail d’institutions plus large que les seules institutions universitaires), garantie institutionnelle similaire à la liberté de la presse, sans laquelle les chercheuses et chercheurs ne peuvent tout simplement pas accomplir leur mission d’intérêt public.
Dès qu’on creuse un peu cette question, on constate que deux visions de l’université, et de la liberté académique, s’opposent. La première, qui n’est pas la mienne, est profondément verticalisée et limite la portée de la liberté académique aux choix institutionnels qui peuvent être orientés par la direction des universités. Individuellement parlant, les professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs ne pourraient alors valablement s’exprimer que s’ils respectent les grandes orientations des universités au sein desquelles elles et ils travaillent.
La seconde met de l’avant une approche collégiale de l’institution au sein de laquelle : 1) les dirigeant-e-s ne dirigent l’institution que pour un temps limité avant de reprendre leurs fonctions professorales; et 2) une institution dans le cadre de laquelle on valorise l’expression et la diffusion de propos critiques ou controversés : la liberté académique étant à la fois celle de l’institution que celle des professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs qui y travaillent.
Dans la première conception, qui tend à trouver de plus en plus de traction au sein des directions universitaires actuelles, les professeur-e-s-chercheur-se-s vont nécessairement y penser à deux fois avant d’aborder des sujets qui pourraient porter à controverse ou, pire encore, porter ombrage à l’un des nombreux partenaires financiers sur lesquels les Universités comptent de plus en plus pour assurer leur financement, nuisant ainsi à leur capacité de traiter d’enjeux importants qui, souvent, ne peuvent être abordés qu’au sein d’institutions comme les universités.
Or, pour éviter cet effet paralysant, nocif pour la réalisation de la mission d’intérêt public des universités, il est nécessaire que les universitaires aient non seulement les coudées franches pour enseigner et faire de la recherche sans subir de pression doctrinales (provenant de l’intérieur comme de l’extérieur des institutions), mais qu’ils puissent aussi compter sur la protection du droit (et de leurs institutions) s’ils devaient être pris à partie pour avoir fait leur travail.
[...] il est nécessaire que les universitaires aient non seulement les coudées franches pour enseigner et faire de la recherche sans subir de pression doctrinales (provenant de l’intérieur comme de l’extérieur des institutions), mais qu’ils puissent aussi compter sur la protection du droit (et de leurs institutions) s’ils devaient être pris à partie pour avoir fait leur travail.
Chantal Pouliot : Récemment, le scientifique en chef a déposé un document de réflexion et de consultation à l’intention du ministère de l’Enseignement supérieur portant sur l’université québécoise du futur. L’université du futur, c’est aussi les professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs du futur. En quoi vos objets de recherche concernent-ils la relève professorale?
Simon Viviers : Le danger que je vois actuellement, c’est que les nouvelles et nouveaux professeur-e-s arrivent en poste en croyant que les modes de fonctionnement qui se déploient actuellement sont des modes de fonctionnement « normaux » de l’Université. C’est ainsi que se crée cette nouvelle normalité au sein même du corps professoral. Je pense que les plus expérimentés d’entre nous doivent faire œuvre de pédagogie en transmettant une mémoire de ce qu’était l’Université et de ce qu’elle pourrait (re)devenir. Mais les nouveaux sont pressés par des normes matérielles et culturelles qui les enjoignent à « produire » de la recherche, à « recruter » rapidement des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, etc., délaissant, par exemple, la participation aux instances de prise de décisions collégiale. Ces pressions fragilisent la santé mentale des nouvelles et nouveaux professeur-e-s, une situation largement documentée et très inquiétante. Et au-delà de ces conséquences sur les personnes, c’est la société dans son ensemble qui y perd au change, puisqu’une conception verticalisée de l’institution, telle qu’évoquée par Louis-Philippe, risque de s’implanter sans résistance réelle, nuisant du coup à l’atteinte de la mission d’intérêt public de l’université.
Dans le cadre de mes recherches, je m’intéresse aux actions collectives que déploient les travailleuses et les travailleurs pour reprendre un pouvoir d’agir sur l’organisation de leurs tâches, dans une perspective de restaurer un rapport au travail satisfaisant et de préserver leur santé mentale. Nous avons la responsabilité de prendre soin de nos collègues en début de carrière, de les épauler, de nous solidariser, mais aussi de protéger l’institution contre ces « dérives » dont nous avons discuté. Mes constats actuels montrent la nécessité, pour ce faire, d’occuper le terrain, tant dans des formes d’action institutionnelle (par exemple, via l’action syndicale ou les instances de décision collégiale) que dans des formes d’action plus locales et sociales. Et je dois dire que je suis heureux et encouragé de voir que de nombreux collègues agissent dans ce sens, de différentes façons, avec différents groupes – cercles étudiants, citoyennes et citoyens, groupes marginalisés –, parfois de façon très originale, pour préserver la capacité de l’université à traiter de sujets sensibles, difficiles et controversés.
Nous avons la responsabilité de prendre soin de nos collègues en début de carrière, de les épauler, de se solidariser avec elles et eux, mais aussi de protéger l’institution contre ces « dérives » dont nous avons discutées.
Louis-Philippe Lampron : Je partage entièrement l’inquiétude de Simon sur le risque que les « dérives » actuelles concernant le fonctionnement des universités posent pour les nouveaux collègues. Cela vient avec le risque d’internaliser l’obligation de limiter ses recherches à des objets, phénomènes ou situations qui ne risquent pas de soulever de vagues. Le risque associé à des rumeurs au sujet de « sujets-qu’il-vaut-mieux-ne-pas-aborder » va bien au-delà de la seule période de précarité d’emploi. Les premières années dans la fonction de professeur-e déterminent bien souvent le programme de recherche qui sera déployé tout au long de la carrière. En ce sens, je suis inquiet pour les jeunes professeur-e-s-chercheur-se-s qui, tant qu’ils n’ont pas obtenu la permanence d’emploi, peuvent tout à fait valablement se sentir moins bien protégés que des collègues qui ont acquis la permanence. Car il s’agit à mes yeux de la période où l’on devrait inciter le plus fortement les nouveaux collègues à faire preuve de toute l’audace et du courage dont ils sont capables, tant dans le choix de leurs sujets de recherche que dans la manière de les aborder. Au sein des institutions qui militent pour une vision restrictive de la liberté académique, je crois nécessaire que les collègues permanent-e-s et les syndicats soient très visibles et convaincants auprès des collègues en début de carrière, de manière à les conforter quant à leur capacité d’exercer une conception large et robuste de la liberté académique dès leur entrée en fonction.
J’ajouterais ceci: je considère que la participation active aux débats publics – notamment par l’intermédiaire d’entrevues médiatiques – fait partie intégrante de ce qui justifie l’importance de la liberté académique en tant que garantie institutionnelle. La société doit pouvoir compter sur un corps de spécialistes, de chercheuses, de chercheurs et d’intellectuel-le-s qui jouissent d’une liberté de parole garantie sur un vaste ensemble de sujets. Lorsque des professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs en début de carrière craignent de prendre la parole publiquement alors que le sujet des conversations sociopolitiques est lié à leur expertise, on affaiblit la raison d’être de la liberté académique : soit la capacité des institutions universitaires et de celles et ceux qui y travaillent, de contribuer à la vitalité des débats démocratiques en fournissant les idées, données et informations fiables et de qualité sur la base desquelles il est possible de prendre des décisions libres et éclairées.
[...] la participation active aux débats publics – notamment par l’intermédiaire d’entrevues médiatiques – fait partie intégrante de ce qui justifie l’importance de la liberté académique en tant que garantie institutionnelle. La société doit pouvoir compter sur un corps de spécialistes, de chercheur-se-s et d’intellectuel-le-s qui jouissent d’une liberté de parole garantie sur un vaste ensemble de sujets.
- 1Voir, entre autres, à ce sujet leur enquête présenté ici, dans le présent magazine : Dérives de la recherche et détresse psychologique : une recherche qualitative - https://www.acfas.ca/publications/magazine/2016/06/derives-recherche-detresse-psychologique-recherche-qualitative
- Simon Viviers et Louis-Philippe Lampron
Université Laval
Simon Viviers est professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. Ses travaux portent sur la santé mentale et le travail dans les métiers de la relation et de l’éducation. Il est chercheur régulier au Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT) et dirige une équipe de recherche sur le thème du rapport au travail dans le monde contemporain.
Louis-Philippe Lampron est professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval. Ses travaux concernent la protection des libertés fondamentales et du droit à l’égalité au sein des sociétés pluralistes. Il est co-porte-parole du Groupe d’étude en droits et libertés (GEDEL) et chercheur régulier au sein du Centre de recherche interuniversitaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ).
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre