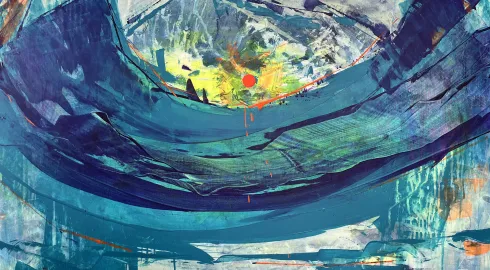L’avenir de l’Université de l’Ontario français (UOF) a été, avec l’abolition du Commissariat aux services en français (CSF), de toutes les tribunes à l’automne 2018. Cette annonce a été ressentie d’un bout à l’autre de la francophonie canadienne comme une profonde injustice à l’endroit de la communauté franco-ontarienne. En effet, mise sur la glace jusqu’à l’amélioration des finances publiques, l’annulation du projet universitaire a fait couler beaucoup d’encre.

Brève histoire du bilinguisme universitaire en Ontario français
Il existe de manière presque ininterrompue depuis 1848 la possibilité d’obtenir, en Ontario, certaines formations postsecondaires en langue française. Cependant, même si les Franco-Ontariens forment, et de loin, la plus importante communauté de langue française en nombres absolus à l’extérieur du Québec, le réseau universitaire franco-ontarien contraste avec celui de plusieurs des autres provinces canadiennes en ce qu’il est presque entièrement composé d’institutions bilingues, plutôt que linguistiquement homogènes. En ce sens, pour comprendre l’actuel mouvement en faveur d’une université de langue française, il faut l’inscrire dans un mouvement historique visant l’autonomisation de l’éducation postsecondaire franco-ontarienne.
Les Oblats fondent en 1848 l’ancêtre de l’Université d’Ottawa, le Collège de Bytowne, optant immédiatement pour un enseignement dans les deux langues afin de répondre aux attentes des populations catholiques irlandaise et canadienne-française. Après une période d’unilinguisme anglais durant le dernier quart du XIXe siècle, l’Université d’Ottawa renoue avec le bilinguisme sous l’impulsion de l’archevêque Duhamel. Au fil des ans, si le nombre absolu d’étudiants francophones augmente, leur poids relatif par rapport à l’ensemble de la population estudiantine ne cessera de diminuer pour s’établir, en 2018, en-deçà du plancher symbolique des 30 %.
Plus au nord et à l’abri des Oblats, les Jésuites établissent à Sudbury un premier collège classique unilingue en 1913 : le Collège Sacré-Cœur. On crée cependant à partir de cette institution, en 1957, l’Université de Sudbury, un établissement bilingue. Trois ans plus tard naît, avec le concours des Jésuites et d’autres dénominations religieuses, la Fédération de l’Université Laurentienne, une entité laïque et également bilingue à laquelle s’affilie le Collège universitaire de Hearst, seule institution de la province dont l’administration et l’enseignement se font entièrement en langue française.
Du côté de Toronto, le Collège Glendon voit le jour en 1966, telle une excroissance de l’Université York. Le contexte s’y prête : le Canada traverse une importante crise politique et identitaire qui favorise le bilinguisme. Dans le discours inaugural du campus, le premier ministre Pearson félicite l’institution d’offrir un enseignement permettant aux étudiants de devenir parfaitement bilingues. On comprend que la mission de l’institution était moins d’offrir aux Franco-Ontariens une éducation postsecondaire que de former une nouvelle élite anglophone bilingue.
Notons que toutes ces institutions sont fondées avant la création, en 1969, des premières écoles secondaires publiques de langue française. Avant cette date, le taux de décrochage scolaire des Franco-Ontariens était relativement élevé. Ceux qui ne pouvaient se permettre des études privées dans les institutions séparées (catholiques) intégraient les High Schools où leurs taux de diplomation étaient particulièrement faibles.
Les institutions bilingues ont reçu leur part de critiques : environnement et vie culturelle anglo-dominants qui favorise l’acculturation, faible offre de cours et de programmes en français, obligation de compléter sa formation dans l’autre langue, etc. Cette situation agace les étudiants de l’Université Laurentienne à la fin des années 1970. Avec les encouragements de certains professeurs militants, ils occupent la salle du Sénat académique, réclamant la centralisation des services en français de l’université autour d’un espace francophone. En 1980, ils exigent de la province une institution universitaire unilingue française, donnant un élan à cette lutte qui se poursuit aujourd’hui.
Même si les Franco-Ontariens forment, et de loin, la plus importante communauté de langue française en nombres absolus à l’extérieur du Québec, le réseau universitaire franco-ontarien contraste avec celui de plusieurs des autres provinces canadiennes en ce qu’il est presque entièrement composé d’institutions bilingues, plutôt que linguistiquement homogènes. En ce sens, pour comprendre l’actuel mouvement en faveur d’une université de langue française, il faut l’inscrire dans un mouvement historique visant l’autonomisation de l’éducation postsecondaire franco-ontarienne.
2008-2017 : Entre principe et pragmatisme
Dans sa plus récente incarnation, le mouvement pour la création d’une institution universitaire de langue française a été piloté par le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO). Faisant de l’accessibilité des études dans les régions mal desservies son principal cheval de bataille et souhaitant également la bonification de l’offre de programmes, le RÉFO cible la région de Toronto, où la population francophone semble connaître la plus forte croissance de la province. Le Centre-Sud-Ouest est également la région où la proportion de programmes offerts en français est la plus faible.
Si le RÉFO cible d’abord la mise sur pied d’une nouvelle université dans le Centre-Sud-Ouest, c’est peut-être le fait que les efforts au fil des décennies, notamment dans le Nord-Est de la province, se sont soldés par des échecs. Pour leur part, Ottawa et Sudbury étaient déjà desservis par des institutions bilingues où il était possible de poursuivre des études jusqu’au doctorat en langue française, du moins dans certains domaines. Il a alors été jugé bon de déplacer le champ de bataille vers le Sud-Ouest, là où ne se trouve aucune chasse-gardée. Le gouvernement libéral de Kathleen Wynne a prêté l’oreille à ces revendications et a commandé la production d’un rapport.
Le rapport Adam, Innover localement, exceller mondialement, déposé à l’Assemblée législative le 30 juin 2017, a reçu un accueil mitigé. Malgré tout, le gouvernement libéral, cherchant à conserver ses appuis en milieu francophone, a rapidement agi en adoptant, le 14 décembre 2017, un projet de loi omnibus créant l’UOF.
Pourtant, dans sa présente mouture, l’UOF fait largement l’économie des demandes pour une université provinciale de langue française. Si elle évoque le principe, peu a été fait pour réaliser l’objectif. En poursuivant un modèle axé sur le numérique et le marché international, le rapport Adam affirme proposer un « projet éducatif et pédagogique adapté pour le 21e siècle », caractérisé par la « transdisciplinarité ». Les programmes proposés avaient de quoi laisser perplexe : Pluralité humaine, Environnements urbains, Économie mondialisée et Cultures numériques. Plusieurs ont critiqué la nature abstraite des programmes, l’orientation surtout internationale de l’institution et la portée limitée du projet pour la communauté franco-ontarienne. Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur élu en juin 2018 justifiait après-coup ses compressions en s’appuyant sur ces critiques.
L’UOF : à travers les critiques, le consensus
Historiquement, la francophonie ontarienne a cherché à obtenir la gouvernance autonome d’institutions de langue française. Le milieu scolaire est depuis longtemps vu comme le lieu par excellence de la transmission de la langue et de la culture françaises. Après l’obtention d’écoles secondaires en 1969, l’établissement de collèges francophones à partir de 1989 et l’octroi de la gestion scolaire en 1997, la création d’un réseau universitaire francophone et provincial représente le maillon manquant de la complétude institutionnelle scolaire franco-ontarienne.
Le 1er décembre 2018, 14 000 Franco-Ontariens et alliés sont descendus dans les rues de la province pour dénoncer les compressions au CSF et à l’UOF. Si tous n’étaient pas d’accord avec les modalités de mise en œuvre de l’UOF, force est de constater que le principe d’une université de langue française jouit en Ontario français d’un large consensus. Cet appui populaire doit être compris dans une optique du désir de « faire société » de la communauté franco-ontarienne. En effet, c’est par l’entremise d’institutions telles qu’une université que cette minorité assurerait sa capacité de transmettre sa culture, d’intégrer en son sein, voire d’être maîtresse de son destin. Si le gouvernement provincial, pusillanime, s’entête à lui refuser cette institution clé, les tribunaux accueilleront peut-être cette revendication avec plus de magnanimité.
Cet appui populaire doit être compris dans une optique du désir de « faire société » de la communauté franco-ontarienne. En effet, c’est par l’entremise d’institutions telles qu’une université que cette minorité assurerait sa capacité de transmettre sa culture, d’intégrer en son sein, voire d’être maîtresse de son destin.
Poursuivez votre lecture en consultant les autres articles du dossier.
- Serge MivilleProfesseur·e d’universitéUniversité Laurentienne
Serge Miville est professeur adjoint au département d’histoire de l’Université Laurentienne et titulaire de la chaire de recherche en histoire de l’Ontario français depuis juillet 2016. Ses recherches portent sur la presse, l’histoire intellectuelle et les mobilisations nationalitaires en Ontario français ainsi que sur les relations entre le Québec et la francophonie canadienne.
- Stéphanie ChouinardProfesseur·e d’universitéCollège militaire royal du Canada (Kingston) et Queen's University
Stéphanie Chouinard est professeure adjointe au département de science politique et d'économie au Collège militaire royal du Canada depuis 2017. Elle a obtenu sa co-affiliation de l'Université Queen's en 2018. Ses travaux de recherche portent sur le fédéralisme, sur le rapport entre droit et politique, et sur les droits des minorités, notamment des minorités linguistiques ainsi que des Autochtones. Elle est l'auteure de nombreuses publications dans ces domaines. Elle est membre de plusieurs groupes de recherche dont l'Institut des relations intergouvernementales et de la Chaire de recherche en francophonie et politiques publiques.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre