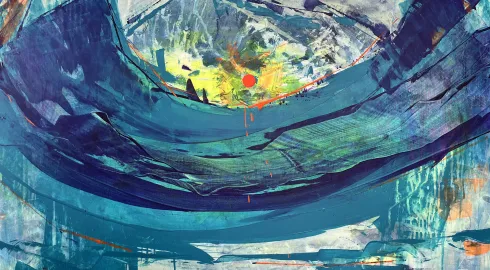La période qui va des années 1940 jusqu’à la fin des années 1960 au Québec est un moment charnière dans l’histoire de sa culture savante. Rares furent les occasions où les sciences humaines – l’histoire et la sociologie en particulier – se seront autant révélées dans une réciprocité avec la société globale. Durant ces années qui ont précédé puis vu se déployer la Révolution tranquille, une nouvelle génération de savants entre en scène et, suivant le mot de Jean-Charles Falardeau, se donne « la tâche d’une nouvelle “définition” de la situation canadienne-française »1. La science, et sa jeune génération d’universitaires laïcs, acquiert alors une fonction sociale transformatrice. En voulant proposer une analyse concrète et objective des grandes mutations socio-économiques que connaît le Québec, elle devient comme une boussole lui permettant d’acquérir une meilleure connaissance de lui-même, pour mieux agir en retour sur son devenir.
- 1Jean-Charles Falardeau, « Lettre à mes étudiants », Cité Libre, mai 1959, p. 14
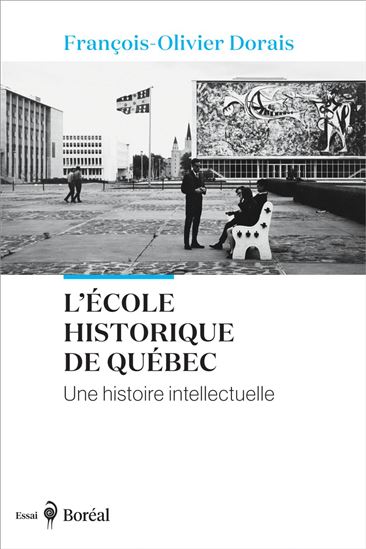
L’école historique de Québec, couramment associée aux travaux des historiens Marcel Trudel (1917-2011), Fernand Ouellet (1926-2021) et Jean Hamelin (1931-1998), trois historiens qui se retrouvent professeurs dans le jeune institut d’histoire de l’Université Laval durant les années 1950 et 1960, se dispose dans ce panorama. Si sa genèse correspond à un moment crucial de disciplinarisation de la science historique, elle est surtout emblématique de l’une des tentatives les plus riches de reprendre à neuf le récit de l’expérience historique du Québec francophone. Avec l’école de Montréal (Maurice Séguin, Guy Frégault, Michel Brunet), l’école de Québec a façonné, entre les années 1950 et 1970, l’une des grandes matrices de la tradition historiographique québécoise, structurée autour de la tentative d’expliciter les causes historiques de l’infériorité économique, sociale et politique des Canadiens français. Si cet enjeu taraude la classe intellectuelle québécoise depuis la fin du XIXe siècle, il se pose avec une acuité particulière durant l’après-guerre, alors que le Québec est confronté à une urbanisation et une industrialisation croissantes, une multiplication des conflits de travail et une hausse généralisée du niveau de vie dont les Canadiens français arrivent difficilement à tirer profit.
Les deux écoles, c’est bien connu, s’affronteront tant sur le diagnostic de cette infériorité que sur les réponses et les projets d’avenir qu’il s’agissait de proposer. À Montréal, la principale source de cette infériorité est attribuée à la Conquête de 1760 qui, en soumettant la Nouvelle-France à une autorité coloniale étrangère, aurait déstructuré sa vie économique et politique, mettant ainsi un terme à son développement « normal », à l’image des treize colonies américaines. Conclusion : seule l’indépendance du Québec permettrait de rétablir cette « normalité » nationale, ce que Séguin nommait l’« agir par soi collectif ». À Québec, le retard canadien-français serait plutôt redevable à des problèmes internes au Canada français, situés dans les replis de sa propre culture, qu’il s’agisse de l’influence trop grande du clergé et du catholicisme, de sa doctrine nationaliste ou encore du conservatisme des « mentalités » de l’élite canadienne-française. Conclusion : si le Québec est en partie responsable de sa situation, ce serait à lui de voir à une rénovation de sa culture pour l’adapter aux impératifs d’une modernité dont il se serait lui-même coupé. Ici, c’est plutôt du côté d’une intégration lucide au fédéralisme canadien que résidait l’espoir pour l’avenir de la société québécoise.
Quelle école ?
Dans mon ouvrage L’école historique de Québec. Une histoire intellectuelle, j’ai moins cherché à restituer les termes, déjà bien connus, de l’opposition entre ces deux écoles que d’interroger la formation d’une école historique à Québec. Il m’avait toujours semblé que cet objet récurrent de notre mémoire savante tenait lieu d’une sorte d’évidence héritée dont la substance nous échappait. Ainsi en va-t-il des classifications en termes d’« école » ou de « chapelle » qui, souvent appuyées sur une définition faible et intuitive, ont généralement une contrepartie arbitraire et normative. La reprise non problématisée de l’étiquette, souvent par commodité, a eu pour effet de réduire la valeur des productions intellectuelles des historiens lavallois aux controverses politiques et idéologiques qui les ont motivées, mais aussi à une lecture tendanciellement disqualificatoire, surtout du fait de leur affinité avec le courant fédéraliste. L’historien Ronald Rudin exagère à peine lorsqu’il écrit qu’« il est presque impossible de trouver un seul francophone qui soit admiratif des historiens de Laval, en dépit de leur longévité, de leurs innovations méthodologiques et de leurs laborieuses recherches »1.
Toujours est-il qu’il persistait une équivoque conceptuelle entourant la dénomination collective des historiens lavallois, équivoque qui tient sans doute au fait qu’ils n’ont pas formé une école de pensée au sens fort du terme, c’est-à-dire avec un cadre institutionnel relativement stable, une personnalité intellectuelle charismatique et un programme théorique puissamment articulé (comme à Montréal, où cela était plus évident). À Québec, on a un groupe dont l’identité est difficilement saisissable, impropre à toute définition précise et au corpus plutôt faiblement intégré. Quoi de commun, en effet, entre la vulgate positiviste et a-réflexive d’un Marcel Trudel et l’œuvre interprétative et polémique d’un Fernand Ouellet ? Entre l’anticléricalisme et l’antinationalisme viscéral de ce dernier et l’inclination plus nationaliste, humaniste et catholique d’un Jean Hamelin ? Et où situer les filiations avec les Thomas Chapais et Arthur Maheux, dont l’influence fut assez négligeable sur leurs travaux ? À ceci s’ajoute l’écart générationnel de ces trois historiens, qui sont moins rapprochés dans le temps que leurs vis-à-vis montréalais2, et la difficulté de leur attribuer une figure tutélaire autant qu’une génération de disciples successeurs, à travers laquelle se serait transmise une doctrine intellectuelle en vue de l’action. Autre preuve de la faible intégration de leurs idées, on ne recense à peu près aucune publication conjointe, à l’exception de l’ouvrage Canada. Unité et diversité, dont les recenseurs ont noté la fragile unité qui relie les différentes parties3.
Pour cerner avec le plus de nuance possible l’identité des historiens lavallois, j’ai plutôt eu recours au concept d’« école d’activité », emprunté au sociologue Samuel Gilmore4, et qui consiste à situer la dynamique convergente moins dans le partage d’une doctrine que sur le plan de l’ethos professionnel, les processus de travail et la conception du métier d’historien. Comme le sociologue Jean Lamarre l’a déjà affirmé, ce qui a rassemblé et suscité la convergence des historiens lavallois, c’est davantage « une conception semblable du métier d’historien qu’une thèse ou une hypothèse commune concernant le devenir global de leur société qu’ils auraient développée et propagée en commun »5. Pour autant, cela n’a pas empêché ces historiens de se reconnaître un même « air de famille » et d’esquisser un horizon interprétatif commun que l’on retrouve surtout dans leur rapport critique au nationalisme, leur penchant vers l’analyse des structures sociales et économiques, leur ouverture à l’historiographie canadienne-anglaise et française ou encore leur évaluation critique de la disposition culturelle des Canadiens français. C’est dire que leur méthode a nourri des thèses sur le passé, et ces thèses sur le passé ont suggéré des méthodes, dans une sorte de va-et-vient.
Quel récit ?
Pour une large part, les thèses de l’école de Québec se sont énoncées en réaction à celles de l’école montréalaise, plus spécifiquement à compter de la seconde moitié des années 1950 et du début des années 1960, à mesure que se polarise le débat sur la question nationale. Il s’agissait surtout, pour les historiens lavallois, d’offrir dans un même souffle et sur un même front, un contre-discours au traditionalisme canadien-français et au nationalisme. Cette dynamique de contre-proposition que l'on retrouve au cœur du récit de l’école de Québec l'inscrit dans une trame idéologique commune avec la revue Cité libre, dont André J. Bélanger précise qu'elle s'est elle aussi en partie définie comme une « idéologie d'opposition » qui « s'est peu attachée à prospecter un avenir politique possible » et dont les orientations se sont précisées « au contact du projet indépendantiste qui ne lui paraîtra pas "politiquement valable"»6. En effet, la sortie de la société traditionnelle n’a pas nécessairement impliqué, pour l’école de Québec, un souci de rénovation intérieure et de modernisation du nationalisme francophone, à la différence de l’école de Montréal, qui a cherché à adapter la perspective du nationalisme francophone aux exigences réformistes des années 1960. À Laval, on s’est plutôt contenté de suivre la diagonale intellectuelle libérale qui, dans le Québec d’après-guerre, aménage une voie antinationaliste qu’emprunteront plusieurs membres de la nouvelle intelligentsia francophone indisposés par le nationalisme stérilisant des vieux maîtres et par les nationalismes totalitaires européens.
Cette différence de sensibilité entre Montréal et Québec est attribuable à divers facteurs, à commencer par les environnements urbains et institutionnels dans lesquels ces historiens ont baigné. À Montréal, ville commerciale, le problème de la coexistence entre Canadien français et Canadien anglais se manifeste plus ouvertement que dans la vieille capitale où, comme l’écrivait Denis Vaugeois, on « connaît mieux le touriste que le capitaliste américain ou anglo-canadien »7. Il faudrait aussi considérer la spécificité du microclimat intellectuel à l’Université Laval où pour plusieurs universitaires, notamment à la Faculté des sciences sociales, le nationalisme est associé plus franchement au pouvoir duplessiste et au cléricalisme, qu’ils ont en séance permanente à Québec8. Ainsi, le nationalisme en vient-il à apparaître comme quelque chose de foncièrement incompatible avec la conception du rôle que l’on s’y fait de l’universitaire, qui doit éviter de se soumettre à des considérations idéologiques et politiques autres que celle de la connaissance réfléchie9. Ce rapport critique au nationalisme, chez les lavallois, prolonge aussi une longue tradition institutionnelle de collaboration avec la sphère savante du Canada anglais, collaboration qui s’est entre autres traduite dans un projet d’envergure comme le Dictionnaire biographique du Canada, fondé en 1959 et fruit d’une initiative conjointe entre l’Université Laval et l’Université de Toronto. Selon Nicole Gagnon, le poids de cette tradition aurait incité les historiens lavallois à « montrer patte blanche » devant l’élément canadien-anglais « en se dissociant complètement de l’"enthnocentrisme revanchard" »10.

Portrait de Marcel Trudel, 1955. Université d'Ottawa, CRCCF, Fonds Marcel Trudel (P27), Ph336-001.
Portrait de Fernand Ouellet, vers 1960. Source : revue Livres et auteurs canadiens, 1967, p. 140.
Portrait de Jean Hamelin, 1985. Source : Source : Université Laval, Division de la gestion des documents administratifs et des archives, Fonds Service des ressources pédagogiques, U540/86-0294, photographe Paul Laliberté, 1985
En s’intéressant à la genèse de l’institut d’histoire de l’Université Laval, qui deviendra formellement un département au début des années 1960, on remarque que celui-ci se particularise par la formation successive de deux configurations historiographiques. Il y a d’abord la tradition de l’histoire critique11, incarnée notamment par Marcel Trudel, le plus âgé des trois historiens et qui a joué un rôle clé dans l’orientation des études historiques à Laval au cours des années 195012. Inspirée par le credo scientiste de la fin du XIXe siècle – que Trudel avait fréquenté dans le cadre d’un séjour d’étude à Harvard (1945-1947)13, mais aussi au contact de son collègue et ami Guy Frégault – l’histoire critique se reconnaît surtout dans une volonté forte de « démythification » du passé en s’appuyant sur le projet d’une connaissance fondée en méthode, contre l’historiographie traditionnelle et providentialiste. Toute l’historiographie trudélienne sur la Nouvelle-France, qui, sous sa plume, est dépeinte comme une terre malheureuse en contrejour des portraits idylliques et édifiants esquissés par les anciens, procède de cette démarche qui appartient au contexte historiographique de l’immédiat après-guerre, où le hiatus entre le réel et l’idéal balise l’imaginaire historien. Cette sensibilité marquera durablement Trudel, qui n’y dérogera jamais complètement, comme en témoigne la dernière série d’ouvrages qu’il fait paraître au cours des années 2000 sous le titre évocateur des « Mythes et réalités en histoire du Québec ». Proche de Groulx et de l’école de Montréal dans sa jeunesse, Trudel s’en éloignera progressivement à la fin des années 1950 dans ses travaux sur le régime britannique, où il s’intéressera notamment aux problèmes inhérents à la structure institutionnelle du Canada français, notamment son Église14. De même, au début des années 1960, il prendra publiquement position contre l’« indépendantisme » québécois, au nom surtout de son attachement au Canada français et à la matrice dualiste du Canada mais aussi, parce qu’il considère qu’un tel projet viendrait morceler encore davantage un effectif francophone déjà rongé par une « faiblesse trois fois séculaire », dont les sources remonteraient au temps du Régime français et ses retards de développement15.
La seconde configuration historiographique qui caractérise l’école de Québec est celle de l’histoire économique et sociale. Elle se façonne dans le sillage des Annales françaises, dont l’empreinte fut décisive à Laval, résultat de la reprise des séjours d'études parisiens de ses étudiants mais aussi de la venue, à Québec, d'historiens français reconnus, dont Robert Mandrou. L'appel des Annales françaises aura imprimé dans leur démarche historienne le sens d’une mission scientifique, celle d’un décloisonnement autant disciplinaire que national. En outre, il a rendu ces derniers plus ouverts à une captation des sciences sociales mais aussi, à une approche plus « territoriale » que « nationale » du Québec, qui tend à minimiser les effets politiques liés au rapport de domination colonial pour plutôt fondre le Canada français et le Canada anglais dans la dynamique d'un système socio-économique en évolution, en insistant surtout sur les avantages liés à cette coexistence dans un espace commun. Dans ce cadre, le Québec est surtout envisagé comme un territoire intégré dans un système plus vaste, référé à la construction d'un nationalisme canadien.
L’œuvre historique de Fernand Ouellet, qui n’a jamais caché ses convictions fédéralistes16, est sans doute celle qui donnera la pleine mesure à cette interprétation. Des trois historiens lavallois, il est sans conteste celui pour qui le labeur du savant a été le plus concurrencé (sinon compromis) par celui de l’idéologue soumis aux angoisses de son temps. Sous la triple influence des Annales, plus particulièrement d’Ernest Labrousse, de l’historiographie de Donald Creighton et de la caractérologie française17, où il trouvera une assise scientifique au pouvoir explicatif des facteurs psychologique en histoire, il élaborera une œuvre fondée sur une lecture particulièrement radicale de la modernité, envisagée surtout sous l'angle des processus inhérents à la socioéconomie capitaliste, qu’il cherchera à opposer à la « mentalité » traditionnelle des élites canadiennes-françaises. Cette lecture est détaillée dans son Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850, paru en 1966, un ouvrage emblématique de l’école de Québec, s’il en est un. Pour Ouellet, la Nouvelle-France n’avait rien d’une société « normale » comparable à la force des colonies américaines. Bien au contraire, cette colonie d’Ancien régime étouffait économiquement, corsetée qu’elle était par le dirigisme de l’État français et du système des monopoles privés qui avaient empêché que ne s’y développe l’esprit capitaliste ou encore une bourgeoisie d’affaire digne de ce nom. Si bien qu’à ses yeux, la Conquête de 1760 n’avait rien d’un traumatisme ou d’une catastrophe, étant entendu que l’impuissance de la Nouvelle-France était plutôt due à des facteurs endogènes en amont de l’événement. Au contraire, Ouellet s’attachera à montrer combien les structures économiques et sociales de la colonie étaient demeurées relativement stables après 1760 et ce, jusqu’au début du XIXe siècle, période de grands bouleversements causés par la conjonction d’une crise agricole, du déclin du commerce de la fourrure et de la montée du commerce du bois. C’est là que toute la dramatique du Canada français se joue pour Ouellet, alors que sa jeune élite des professions libérales émergentes, incapable de s’adapter à la nouvelle réalité industrielle et commerciale, se crispera sur ses propres intérêts et s’obstinera à refuser toute innovation au nom d’une mythification nationaliste et religieuse. L’expérience patriote, dont Ouellet auscultera les raisons de l’échec comme pour prévenir ses contemporains des dangers de l’indépendance du Québec18, serait exemplaire de ce réflexe et de son cul-de-sac politique.
Des trois historiens, Jean Hamelin est peut-être celui dont la mémoire de l’œuvre a le plus souffert d’un embrigadement rétrospectif au sein de l’école de Québec. En effet, sa trajectoire intellectuelle est loin d’avoir souscrit aux critères d’unité et de conformité que suggère ce genre de label. S’il est vrai que Trudel et Ouellet se sont peu écartés des perspectives qu’ils ont privilégiées au début des années 1960, la trajectoire d’Hamelin s’incurvera et aura plusieurs ramifications en histoire économique, en histoire politique, en histoire du travail, en histoire de la presse, en histoire des idéologies et en histoire religieuse, sans compter qu’il évoluera vers le souverainisme au cours des années 197019. En effet, alors que sa production historiographique des années 1960 le rapproche des thèses de l’école de Québec (notamment son Économie et société en Nouvelle-France (1960), seul livre qu’il fera paraître sur le Régime français et dans lequel il critiquera la thèse néonationaliste de la « normalité » sociétale de la Nouvelle-France), il s’en éloignera progressivement à la faveur d’écrits à tonalité plus conservatrice, qui le distingueront de ses collègues Trudel et Ouellet. En effet, Hamelin figure parmi les « déçus » de la Révolution tranquille20, ces intellectuels qui, comme Fernand Dumont, Pierre Vadeboncoeur ou encore Paul Chamberland, manifestent au seuil des années 1980 le désir d’une médiation renouvelée avec le passé face à une modernisation dévoyée par la rationalité et la technocratie. C’est ce que l’on décèle dans L’Homme historien (1979), un ouvrage d’épistémologie historienne aujourd’hui un peu oublié et co-écrit avec Nicole Gagnon en collaboration avec d’autres collègues, dans lequel, sur fond du « retour du Sujet » en sciences sociales, il en appellera à une réhabilitation du récit en histoire et à une revalorisation de la contingence des motivations humaines. On pourrait aussi évoquer son Histoire du catholicisme québécois (1984), premier vaste chantier de recherche sur le passé catholique du Québec dans l’historiographie contemporaine, que l’on peut interpréter comme un retour du refoulé historique dans une époque aux repères brouillés. Dans la même lignée, son Histoire de l’Université Laval, parue en 1995, s’emploiera notamment à réhabiliter une vision classique et humaniste de l’institution universitaire, contre le détournement marchand et instrumental du savoir supérieur.
Quel héritage ?
Par-delà l’horizon politique qui a pu motiver, à degré variable, leur démarche, les historiens lavallois ont clairement innové sur les plans intellectuel et scientifique. À ce compte, leurs contributions au renouvellement de l’historiographie québécoise, en particulier sur les plans de l'histoire sociale et économique, et à la formation de générations d'étudiants et de chercheurs en histoire, sont majeures. Il faudrait aussi attribuer à ces historiens une influence décisive sur le plan du renouveau pédagogique des années 1960, comme en témoigne par exemple la section sur l’enseignement de l’histoire du rapport Parent, qui est marquée du sceau des perspectives de l’histoire sociale et de l’histoire critique lavalloise21. Si bien que, selon le politologue Olivier Lemieux, la division historiographique des deux écoles historiques recouperait, mutatis mutandis, une division didactique dont on percevrait encore les effets de nos jours entre, d’un côté, Christian Laville, Jean-François Cardin et Marc-André Éthier, plus proches de la tradition lavalloise et, de l’autre, André Lefebvre, un pionnier de la didactique de l'histoire, et Félix Bouvier, plus proches de la tradition montréalaise22.
Pour autant, en restant en quelque sorte fixée dans le moment critique de la pensée modernisatrice d'après-guerre et en donnant dans l’antinationalisme, on se demande si cette « école » n’a pas, en quelque sorte, hypothéqué sa propre postérité. On constate en effet que sa perspective critique sur l'Histoire est rapidement apparue en opposition à la dynamique de changement dont témoignait l’actualité de la Révolution tranquille, où la jeunesse, confrontée au constat d’une arriération culturelle et économique des Canadiens français, cherchait une échappatoire mobilisatrice que ne semblait pouvoir leur offrir le récit historique lavallois. C’est à cette conclusion qu’en était arrivé l’historien Jean-Marie Fecteau, pour qui le réaménagement des perspectives nationales qui a accompagné la Révolution tranquille avait été ni plus ni moins « fatal aux ambitions analytiques de l’école de Québec »23. Fernand Ouellet lui-même ne disait pas autre chose lorsqu’il écrivait, en 1975, que « [l]a poussée nationaliste des années 1960, qui se traduit aussi par l’intrusion du socialisme et du marxisme dans les milieux intellectuels, fait peu à peu disparaître depuis une dizaine d’années la frontière entre Québec et Montréal »24.
De ce point de vue, il serait tentant de se demander si les départs précipités des Trudel et Ouellet, qui ont quitté le milieu universitaire québécois au milieu des années 1960 pour poursuivre leur carrière en Ontario25, revêtiraient peut-être, au-delà des explications accoutumées sur leur laïcisme perturbateur, une signification autrement existentielle et politique. En cela, le destin de l’école de Québec rappelle une peu celui de la doctrine loyaliste de Thomas Chapais, rapidement tombée en désuétude au XXe siècle, car elle s’accordait difficilement avec l’évolution de la culture intellectuelle du Canada français26. Toujours est-il que cet « exil » ontarien des historiens lavallois est d’autant plus révélateur lorsqu’il est contrasté avec la résonnance sociale plus marquée des historiens de l’école de Montréal, qui ont su donner de puissants relais publics à leurs idées, que ce soit dans la fonction publique québécoise (Frégault), la revendication nationaliste (Brunet) ou la formation de générations de chercheurs et d’intellectuels (Séguin). Si l’école de Québec a réussi, sur le plan critique, à rompre avec les métarécits anciens et concurrents, créant ainsi une sorte d'appel d’air dont profiteront leurs successeurs, sur le flanc émancipatoire, elle semble avoir eu plus de difficulté à définir un nouveau métarécit unifié qui soit en phase avec l’évolution de la société québécoise. À ce compte, son originalité tiendrait peut-être moins à son rayonnement politique, au demeurant peu significatif, qu'à sa longévité académique, laquelle lui aura surtout permis de laisser une empreinte à l'intérieur du champ universitaire.
Qu’à cela ne tienne, les perspectives de l’école de Québec et de sa rivale montréalaise ont institué un débat fondamental sur la perception que les Québécois entretiennent d’eux-mêmes. Leur désaccord s’est découpé dans un même espace délibératif qui est constitutif de la richesse autant que de l’originalité de l’identité narrative du Québec contemporain. Pour cela seul, il nous semble pertinent d’y revenir.
Qu’à cela ne tienne, les perspectives de l’école de Québec et de sa rivale montréalaise ont institué un débat fondamental sur la perception que les Québécois entretiennent d’eux-mêmes. Leur désaccord s’est découpé dans un même espace délibératif qui est constitutif de la richesse autant que de l’originalité de l’identité narrative du Québec contemporain. Pour cela seul, il nous semble pertinent d’y revenir.
- 1Ronald Rudin, Faire de l’histoire au Québec, Québec, Septentrion, 1998, p. 197.
- 2Trudel est né en 1917, Ouellet en 1926 et Hamelin en 1931. À l’inverse, à Montréal, Brunet est né en 1917 et Frégault et Séguin sont nés en 1918.
- 3Voir, à ce propos, Jean Blain et al. « Paul G. Cornell, Jean Hamelin, Fernand Ouellet et Marcel Trudel, Canada — Unité et diversité, HoIt, Rinehart et Winston Limitée, 1968. 578 p. » dans Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 22, no. 3, décembre 1968, p. 450–466.
- 4Samuel Gilmore, « Schools of activity and innovation », The Sociological Quarterly, vol. 24, no. 2, juin 1988, p. 203-219. Ce concept a également été utilisé pour analyser la dimension collective de l’école de Chicago (voir Jacqueline Low et Gary Bowden (dir.), The Chicago School Diaspora. Epistemology and Substance, McGill-Queen’s University Press, 2013, 398 p.).
- 5Jean Lamarre, Le devenir de la nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet (1955-1969), Québec, Septentrion, 1993, p. 23.
- 6André J. Bélanger, Ruptures et constantes. Quatre idéologies du Québec en éclatement : La Relève, la JÉC, Cité libre, Parti Pris¸ Montréal, Les Éditions Hurtubise HMH, 1977, p. 131-132.
- 7Denis Vaugeois, L’Union des deux Canadas, nouvelle-Conquête ? (1791-1840), Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1962, p. 127.
- 8Au milieu des années 1960, l’Église en mène encore large à l’Université Laval, qui demeurera une université privée et confessionnelle jusqu’en 1971, avec une présence et une influence active du Séminaire dans la gestion interne de l’institution. À l’inverse, l’Université de Montréal était engagée sur la voie de la laïcisation depuis plusieurs années, avec l’arrivée d’un premier recteur laïc en 1965 et l’adoption d’une nouvelle charte en 1967.
- 9Cette vision est clairement explicitée, par exemple, chez le politologue lavallois Léon Dion dans son texte « Aspects de la condition du professeur d'université dans la société canadienne-française » paru dans Cité libre (no. 26, juillet 1958, p. 8-30).
- 10Nicole Gagnon, « Le Département de sociologie, 1943-1970 » dans Albert Faucher (dir.), Cinquante ans de sciences sociales à l’Université Laval. L’histoire de la Faculté des sciences sociales (1930-1988), Faculté des sciences sociales, Presses de l’Université Laval, 1988, p. 95.
- 11Je reprends le terme « histoire critique » de l’historien Serge Gagnon, qui en avait fait l’une des deux « révolutions méthodologiques » de l’histoire au Québec avec l’arrivée de l’histoire sociale dans les années 1960 (Serge Gagnon, Le passé composé. De Ouellet à Rudin, Montréal, VLB Éditeur, p. 17).
- 12Marcel Trudel a été Secrétaire de l’Institut d’histoire de Laval de 1949 à 1955 puis son directeur de 1954 à 1964.
- 13Je me permets de référer le lecteur ici à François-Olivier Dorais, « Marcel Trudel à Harvard : trajectoire d’un "retour d’Amérique" », Mens, vol. 20, no. 1-2, automne 2019, printemps 2020, p. 135–172.
- 14Voir, par exemple, Marcel Trudel, L’Église canadienne sous le Régime militaire 1759-1764 (volume 1 et 2), parus aux Presses de l’Université Laval en 1956 et 1957.
- 15Marcel Trudel, « Le séparatisme, solution de reniement », décembre 1961, Archives du Séminaire de Trois-Rivières, Fonds Albert-Tessier, FN-0236.
- 16Fernand Ouellet, « Le défi fédéraliste » dans Le Canada au seuil du siècle de l’abondance, Montréal, Éditions HMH, 1969, p. 319-328.
- 17La caractérologie est un courant analytique qui a connu une popularité grandissante dans la France de l’après-guerre grâce, notamment, à la diffusion des travaux de René Le Senne et de Pierre Mesnard.
- 18Voir notamment Fernand Ouellet, « Les fondements historiques de l’option séparatiste dans le Québec », Liberté, vol. 4, n° 21, 1962, p. 90-112; Louis-Joseph Papineau. Un être divisé, Publication de la Société Historique du Canada, brochure historique, n° 11, 1960.
- 19Le compte rendu que fait Jean Hamelin, en 1977, de l’ouvrage de François-Marie Monnet, Le défi québécois, laisse peu de doute sur son souverainisme (« Compte rendu de François-Marie Monnet, Le défi québécois », Recherches sociographiques, vol. XVIII, n° 3, 1977, p. 451-454).
- 20Je reprends cette expression du politologue Frédéric Boily (« Les conservateurs tranquilles ou les déçus de la Révolution tranquille » dans Le conservatisme au Québec. Retour sur une tradition oubliée, Québec, Presses de l'Université Laval, 2010, p. 63-89).
- 21Cette section est surtout comprise dans le chapitre XX du volume III du rapport, paru en 1966. Selon Guy Rocher, cette section du rapport serait « le reflet de l’École de Québec du temps contre l’École de Montréal ». Cette situation serait surtout redevable à son autrice, Jeanne Lapointe. Elle-même professeure à l’Université Laval, elle avait rédigé cette section du rapport après avoir mené des consultations auprès de ses collègues Marcel Trudel, Fernand Grenier et Claude Galarneau. Voir Olivier Lemieux, L’histoire à l’école, matière à débats… Analyse des sources de controverses entourant les réformes de programmes d’histoire du Québec au secondaire (1961-2013), Thèse de doctorat (administration et politiques de l’éducation), Université Laval, 2019, p. 153-157.
- 22Olivier Lemieux, Genèse et legs des controverses liées aux programmes d’histoire du Québec (1961-2013), Québec, Presses de l’Université Laval, 2021, p. 123-124.
- 23Jean-Marie Fecteau, « Entre la quête de la nation et les découvertes de la science. L'historiographie québécoise vue par Ronald Rudin », The Canadian Historical Review, vol. 80, n° 3, septembre 1999, p. 454.
- 24Fernand Ouellet, « Historiographie canadienne et nationalisme », Mémoires de la Société royale du Canada, vol. 13, 1975, p. 36.
- 25Marcel Trudel quittera pour le Département d'histoire de l'Université d'Ottawa en 1965, où il poursuivra sa carrière jusqu'à sa retraite en 1982. Quant à Ouellet, il quittera la même année pour rejoindre le corps professoral de l'Université Carleton, avant d'intégrer le Département d'histoire de l'Université d'Ottawa (1975-1985) et de l'Université York (1986).
- 26Voir, à ce sujet, Damien-Claude Bélanger, « Thomas Chapais, loyaliste », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 65, no. 4, printemps 2012, p. 439–472.
- François-Olivier Dorais
Université du Québec à Chicoutimi
Professeur agrégé d’histoire, Université du Québec à Chicoutimi.
Auteur de L’école historique de Québec. Une histoire intellectuelle (Boréal, 2022)
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre