La beauté de la littérature est une beauté fantôme qui n’existe que par le charme de la lecture. L’ambition de l’essai littéraire est de prolonger cette demi-vie qui habite les grandes œuvres littéraires. François Ricard, qui est un maître en la matière, a écrit, au sujet de ses propres essais littéraires, qu’ils doivent être lus comme « des textes de répercussion, qui ne visent qu’une chose : prolonger dans la pensée cet ébranlement, cette vibration mentale que créent pour moi certaines œuvres et certains écrivains ». Je ne saurais mieux dire. Ce n’est pas à moi de décider si j’y suis parvenu dans Le Piège du monde, mais c’est le motif derrière chacun des essais qui le compose : tenter de prolonger, au moyen de mes propres mots, l’ébranlement provoqué en moi par la lecture de quelques romans.
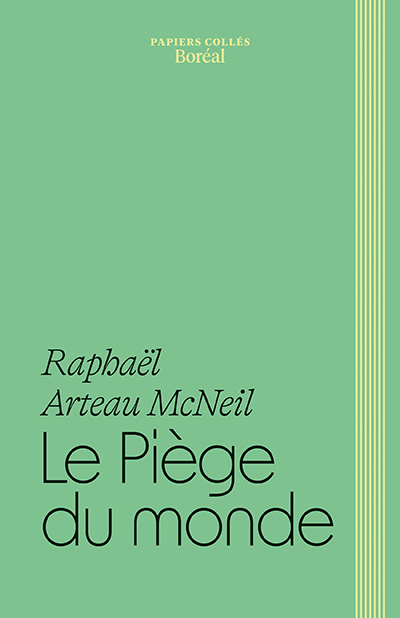
Le livre que je présente ici rassemble donc une douzaine d’essais littéraires que j’ai écrits au fil des ans et que j’ai cru possible de réunir en un seul ouvrage. Le Piège du monde est un recueil d’essais, ce n’est pas un livre au sens fort du terme; ses chapitres ont eu une vie antérieure et indépendante avant de trouver leur place sous une même reliure où ils partagent désormais une vie commune. Si leur regroupement en un seul livre tient du collage, j’ai quand même tenté de tracer un itinéraire de lecture avec, comme point de départ, l’intuition kundérienne que le monde est un piège; et j’ai remanié mes textes originaux afin de mieux baliser cet itinéraire et de poursuivre, à ma façon, l’exploration de cette intuition littéraire.
Pour la présenter en quelques mots, cette intuition qui me sert de fil conducteur, il convient de prendre un peu de recul, car l’idée que le monde puisse être un piège n’est pas nouvelle, elle est même très ancienne. L’Allégorie de la caverne de Platon le suggérait à sa façon, le Jardin d’Épicure se voulait un asile paisible offert contre la folie humaine, les anachorètes puis les moines se réfugiaient dans le désert ou le silence espérant fuir les tentations de ce monde. Bref, par-delà les querelles de sectes et d’écoles, par-delà tout ce qui distingue la philosophie grecque de la religion chrétienne, la sagesse ancienne enseignait d’une seule voix qu’un trop grand attachement aux biens de ce monde emprisonnait l’âme et la rapetissait. Il s’agit cependant de sagesse ancienne, et nous, modernes, avons voulu créer un monde à notre image, nous nous sommes détournés de ces enseignements trop austères et avons souhaité transformer le monde pour le rendre plus humain, plus juste et plus confortable. Il faut reconnaître que le résultat est impressionnant, et je suis le premier à jouir des bénéfices de cette grande transformation. Sauf que nos succès enivrants s’accompagnent d’échecs inquiétants, notre optimisme sucré sécrète comme malgré lui un scepticisme amer, et notre intelligence grimace quand elle veut sourire. Le monde a beaucoup changé depuis Platon, mais il demeure un piège au sens où, à trop le prendre au sérieux, on y perd encore et toujours son « âme » – ou peu importe le mot que l’on souhaite donner à cette partie de notre être qui risque de s’aplatir sous le poids du travail routinier, du divertissement abêtissant et de toutes les petites défaites qui composent notre quotidien. C’est le constat que posent plusieurs grandes œuvres de la littérature moderne, ce que je me plais à appeler des romans à épines, empruntant au passage une formule de Philippe Muray, qui s’y connaît si bien en choses piquantes.
Cette présentation serait incomplète si je ne disais rien des œuvres elles-mêmes, cette petite sélection de romanciers à la remorque desquels je pense mon monde et révèle les ressorts de ses pièges. Ce sont d’abord Kundera, Musil, Kafka et Woolf : les quatre essais qui ouvrent le recueil explorent comment leur héros (Franz, Ulrich, Josef K. et Mrs Dalloway) se débattent en vain contre leur monde. Dans chaque cas, la fiction démonte le piège de la fiction, de sorte que ces romans refusent de jouer le rôle de nourrices (Musil), de conforter notre fatigue (Kafka) et de se conclure par un « Et voilà tout » aussi souhaitable qu’improbable (Woolf). Dans la section suivante, je me tourne vers Hiroko Oyamada, Oscar Wilde et Mikhaïl Boulgakov qui m’offrent cette fois l’occasion d’explorer ce que j’appelle des semi-libertés – parce que ces essais sont les plus éclectiques du recueil, je me contenterai de cette phrase elliptique, qui aguichera peut-être le lecteur curieux. La dernière section du recueil porte quant à elle sur des romanciers plus récents et plus crus : d’abord, trois romanciers américains, Chuck Palahniuk, Bret Easton Ellis et David Foster Wallace, auxquels j’ai ajouté deux textes sur Michel Houellebecq. Cette section de mon ouvrage se veut à la fois une reconnaissance de dette et un aveu. Ma première éducation culturelle a été un gavage de films américains, une éducation hollywoodienne, si vous préférez, un phénomène qui n’a pourtant rien de singulier ni d’extraordinaire; c’est une vérité de mon époque autant que de ma personne. Disons que l’exploration des différents pièges qui composent notre monde devait tôt ou tard me conduire vers ces romanciers plus difficiles à aimer parce que plus durs et plu crus. N’empêche, ces romanciers contemporains ne sont pas moins précieux que leurs compères classiques, ne serait-ce pour cette raison que, si la culture américaine est un parfait exemple de ce que signifie l’expression « piège du monde », c’est parce qu’elle illustre à merveille cette vérité que tout piège est d’abord séduisant. Il est impossible de sentir le piège sans d’abord avoir été irrésistiblement attiré par ses appâts, et c’est l’un des plus grands mérites de ce petit groupe de romanciers d’être parvenus à exposer à la fois les pièges de notre époque et ses appâts. Pour réduire l’œuvre de Houellebecq à une formule, je dirais qu’il suffit de sentir en soi-même une aspiration à aimer, aussi faible et imparfaite soit-elle, mais une aspiration tout de même, pour voir se refermer sur soi le piège qui porte le nom de « liberté sexuelle ». Un constat similaire pourrait être formulé pour Palahniuk au sujet de la violence et pour Wallace au sujet de l’addiction.
Enfin, en guise de conclusion – et par souci de probité intellectuelle –, qu’il me soit permis de répéter ici la mise en garde de mon avant-propos. J’ai dit que les romans que je présente dans ce livre sont des romans à épines, c’est-à-dire des romans qui conduisent au bord du gouffre qu’est parfois la condition humaine. Parfois, parce que ce n’est pas toujours ainsi, parce que la vie n’est pas qu’un gouffre, n’est pas qu’épines. Il existe d’autres œuvres, tout aussi excellentes et à leur façon très dures aussi, mais qui proposent en fin de compte une vision plus réconciliée de la condition humaine. Je pense aux romans de Jane Austen, aux pièces de Shakespeare, aux dialogues de Platon. Si les œuvres littéraires les plus belles peuvent être comparées à des fleurs – la métaphore est usée, je sais, mais l’ayant empruntée il me faut maintenant la filer –, il y aurait d’un côté les œuvres à fruits et de l’autre, celles à épines. J’aime les deux espèces, même si elles cohabitent difficilement ensemble dans le même pot qui me sert de cervelle, comme si j’avais deux groupes d’amis irréconciliables pour lesquels j’éprouvais une affection égale. Par souci de cohérence – ou pour éviter les querelles d’amis –, j’ai choisi de ne présenter dans ce recueil que des textes qui portent sur des romans à épines. D’où le titre de mon livre : Le Piège du monde.
- Raphaël Arteau McNeil
Cégep Garneau
Raphaël Arteau McNeil est professeur de philosophie au cégep Garneau. Il est directeur de la revue Argument où il publie fréquemment des textes, il collabore aussi à la revue L’Atelier du roman et il est l’auteur des essais La Perte et l’Héritage (Boréal, 2018) et Le Piège du monde (Boréal, 2025).
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre



