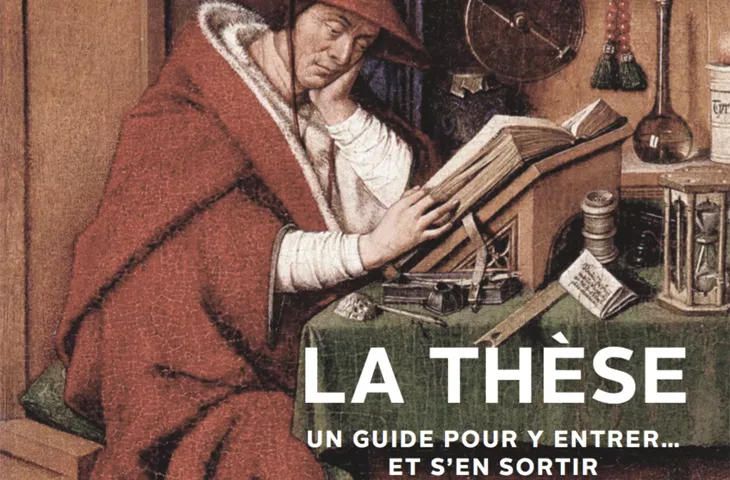Quand nous avons entrepris nos études doctorales en éducation, nous savions que le parcours serait exigeant, mais sans mesurer à quel point il serait solitaire. Les études aux cycles supérieurs sont souvent présentées comme une période d’effervescence intellectuelle; une image qui ne dit rien d’un quotidien fait de doutes, d’incertitudes et de longues heures de travail en tête-à-tête avec soi-même.
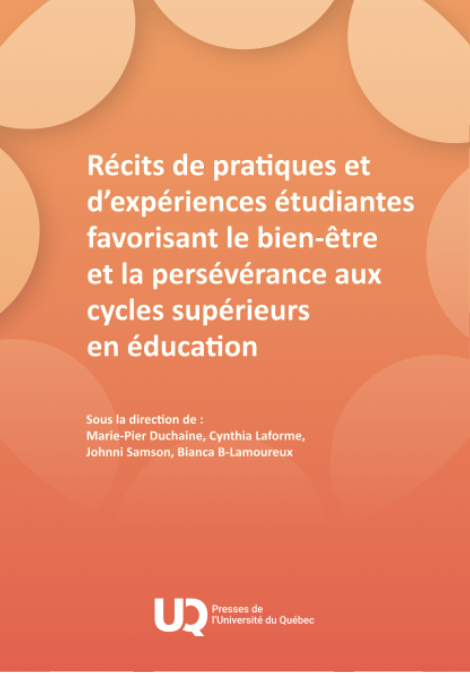 C’est dans ce contexte que nos routes se sont croisées et que s’est tissée, naturellement, une relation de « mentorat informel » devenue au fil du temps un véritable filet de sécurité dans notre parcours doctoral. Par « filet de sécurité », nous entendons un espace relationnel bienveillant, fondé sur la confiance, l’écoute et la réciprocité, qui nous a aidées à surmonter les moments de découragement et à préserver notre équilibre personnel et académique.
C’est dans ce contexte que nos routes se sont croisées et que s’est tissée, naturellement, une relation de « mentorat informel » devenue au fil du temps un véritable filet de sécurité dans notre parcours doctoral. Par « filet de sécurité », nous entendons un espace relationnel bienveillant, fondé sur la confiance, l’écoute et la réciprocité, qui nous a aidées à surmonter les moments de découragement et à préserver notre équilibre personnel et académique.
Nous avons voulu mettre des mots sur cette expérience dans notre chapitre intitulé « Le mentorat informel comme stratégie efficace pour contrer l’isolement et pour soutenir le bien-être et la persévérance » (Forest et Adams, 2024). Ce chapitre fait partie d’un ouvrage collectif ayant pour titre Récits de pratiques et d’expériences étudiantes favorisant le bien-être et la persévérance aux cycles supérieurs en éducation, publié en libre accès aux Presses de l’Université du Québec (Duchaine et coll., 2024). Nous espérons que tous ces récits pourront guider et encourager celles et ceux qui poursuivent leur route aux cycles supérieurs.
Les études aux cycles supérieurs sont souvent présentées comme une période d’effervescence intellectuelle; une image qui ne dit rien d’un quotidien fait de doutes, d’incertitudes et de longues heures de travail en tête-à-tête avec soi-même.
S’entraider pour mieux avancer
Le mentorat informel n’est ni planifié ni encadré par une structure officielle : il nait d’une affinité, d’une volonté réciproque de s’entraider, et se déploie au fil des besoins et des échanges. Dans notre cas, tout a commencé à la suite de réunions virtuelles de notre équipe de recherche, où nous restions parfois toutes les deux quelques minutes de plus pour discuter d’un article, d’une difficulté rencontrée ou simplement de nos avancées du moment. Ces discussions informelles et spontanées se sont peu à peu prolongées au-delà du cadre collectif, donnant lieu à des périodes de rédaction partagées et à des échanges plus personnels, jusqu’à ce que notre relation devienne un véritable espace de soutien mutuel. Sentiment d’appartenance, réduction du stress, élargissement du réseau professionnel, développement de nouvelles compétences, regain de motivation dans les moments creux : voilà autant d’effets bénéfiques aujourd’hui observables.
Au départ, notre relation était axée sur une dynamique mentorée-mentore assez classique — l’une étant un peu plus avancée dans son programme d’études —, mais avec le temps, nos rôles se sont équilibrés, selon les sujets abordés et les contextes. C’est cette évolution, de la transmission unidirectionnelle vers une réelle réciprocité, qui a rendu notre mentorat particulièrement riche et porteur.
Sentiment d’appartenance, réduction du stress, élargissement du réseau professionnel, développement de nouvelles compétences, regain de motivation dans les moments creux : voilà autant d’effets bénéfiques [du mentorat] aujourd’hui observables.
Nous avons aussi bénéficié d’un mentorat informel de la part de notre directeur de recherche, dont l’approche humaine a profondément marqué notre vision du milieu universitaire. Sa manière de « travailler sérieusement sans se prendre au sérieux » a contribué à créer un climat de collaboration, de plaisir et de respect mutuel, dans lequel nous avons évolué en confiance. Cette combinaison — mentorat entre pairs et mentorat avec une personne plus expérimentée — nous apparait comme une stratégie gagnante pour favoriser le bien-être et la persévérance aux cycles supérieurs.
Une écriture différente, mais tout aussi motivante
Contribuer à cet ouvrage collectif représente pour nous une expérience d’écriture inédite. Loin de la neutralité attendue des écrits scientifiques, nous avons choisi de livrer notre expérience subjective et nos ressentis. Cette démarche nous a conduites à prendre du recul sur notre parcours, à reconnaitre les étapes franchies, et surtout, à mettre en lumière l’importance du soutien humain dans la réussite universitaire.
Une mosaïque de parcours inspirants
L’un des plus grands plaisirs de cette expérience est la découverte des autres récits. Cet ouvrage collectif démontre bien qu’il existe de multiples chemins pour allier bien-être et persévérance dans la formation à la recherche. On y trouve, entre autres, des récits d’étudiant·es-parents sur les défis et stratégies pour concilier famille, travail et études, des textes sur la construction identitaire à travers le doctorat, des témoignages d’étudiant·es immigrants, ou encore, des récits d’initiatives collectives telles les séances de rédaction en ligne pour briser l’isolement. Chaque chapitre illustre à sa manière que le parcours vers la réussite aux cycles supérieurs n’est jamais tout à fait linéaire ni tout à fait solitaire, mais bien une aventure profondément humaine, traversée certes par des passages nuageux, mais surtout nourrie de collaborations et de solidarités.
[...] le parcours vers la réussite aux cycles supérieurs n’est jamais tout à fait linéaire ni tout à fait solitaire, mais bien une aventure profondément humaine, traversée certes par des passages nuageux, mais surtout nourrie de collaborations et de solidarités.
Pour que ces expériences profitent à d’autres
Si nous avons écrit ce chapitre, c’est avant tout avec l’espoir que notre expérience soit utile et inspire. Nous souhaitons que des étudiant·es y trouvent du réconfort, de la résonance et peut-être même l’élan nécessaire pour demander du soutien. Le milieu universitaire valorise l’autonomie, ce qui est une bonne chose, mais le fait de rechercher du soutien ne devrait pas être vu comme une faiblesse. Nous croyons fermement l’inverse : bien s’entourer est la clé.
Le mentorat informel, parce qu’il est souple, spontané et basé sur la confiance, peut jouer un rôle déterminant pour briser l’isolement et nourrir la persévérance. Bien qu’il ne puisse pas être imposé, il peut être encouragé et valorisé par des environnements ouverts et bienveillants. Nous espérons que notre récit incitera d’autres étudiant·es – et inspirera peut-être même les milieux universitaires – à créer des occasions propices à de telles relations qui valorisent la collaboration plutôt que la compétition.
Enfin, notre participation à cet ouvrage nous a rappelé que derrière chaque projet de recherche, il y a avant tout des personnes, avec leurs histoires, leurs forces et leurs doutes. Notre chapitre n’est qu’une pièce de ce grand ensemble, et s’inscrit dans une démarche collective qui cherche à humaniser le parcours aux cycles supérieurs. Nous espérons que vous aurez envie de découvrir ces récits dans leur diversité — et pourquoi pas, d’y puiser un peu d’inspiration pour votre propre cheminement.
[...] derrière chaque projet de recherche, il y a avant tout des personnes, avec leurs histoires, leurs forces et leurs doutes.
Références
Duchaine, M.-P., Laforme, C., Samson, J. et B-Lamoureux, B. (2024). Récits de pratiques et d’expériences étudiantes favorisant le bien-être et la persévérance aux cycles supérieurs en éducation. Presses de l’Université du Québec. https://www.puq.ca/catalogue/libreacces/recits-pratiques-experiences-etudiantes-favorisant-bien-4330.html
Forest, M.-P. et Adams, G. (2024). Le mentorat informel comme stratégie efficace pour contrer l’isolement et pour soutenir le bien-être et la persévérance. Dans M.-P. Duchaine, C. Laforme, J. Samson et B. B-Lamoureux (dir.), Récits de pratiques et d’expériences étudiantes favorisant le bien-être et la persévérance aux cycles supérieurs en éducation (p. 123-133). Presses de l’Université du Québec.
- Marie-Pier Forest
Université du Québec à Trois-Rivières
Marie-Pier Forest est professeure d’orthodidactique des mathématiques au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle réalise actuellement un doctorat en éducation à l’Université du Québec à Rimouski. Elle est membre du Réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite (RÉVERBÈRE) et membre étudiante du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE). Ses centres d’intérêt de recherche sont notamment l’enseignement des mathématiques par la résolution de problèmes, et le développement d’une compréhension conceptuelle chez les élèves en mathématiques.
- Gabrielle Adams
Université du Québec à Rimouski
Gabrielle Adams est doctorante en éducation à l’Université du Québec à Rimouski. Elle est membre étudiante du Réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite en contexte de diversité (RÉVERBÈRE) et du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE). Ses principaux centres d’intérêt de recherche sont le développement d’une compréhension conceptuelle des notions mathématiques chez les élèves du primaire et les classes flexibles.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre