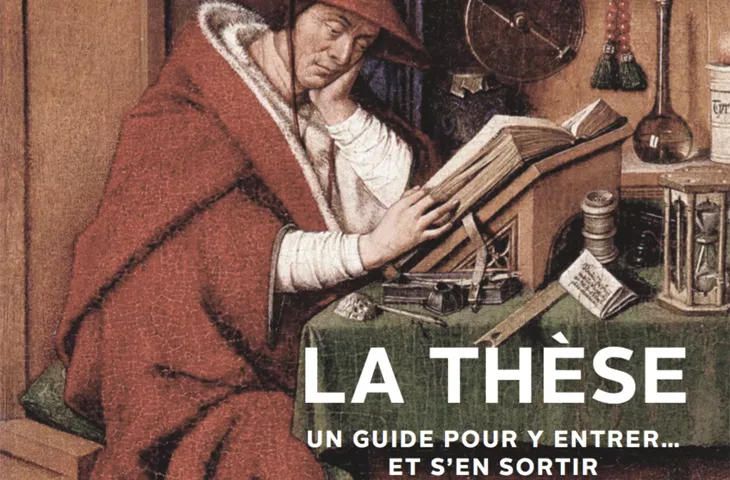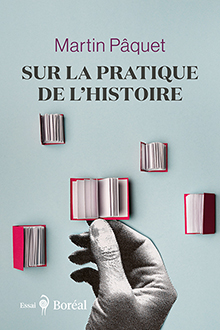
Écrire un essai sur la pratique du métier d’historien m’offre l’occasion d’une rencontre entre le passé et le présent.
Le passé d’abord : il y a plus de quarante-trois ans que je pratique mon métier, et trente-cinq ans que j’enseigne cette discipline à l’université. À ce moment de ma carrière, l’heure est venue de rassembler les éléments de réflexion issus de mon expérience dans un essai. Ce livre se présente donc tel un rapport d’étape.
Le présent ensuite : à l’instar de mes concitoyens, je constate les nombreux défis et enjeux de ma situation en cette terre d’Amérique. Les changements climatiques altèrent notre environnement. Devant l’irruption des pathologies, la santé des corps est un objet de préoccupations constantes. Les grands projets politiques ont perdu de leur superbe et de leur capacité de mobilisation. Comme l’horizon fuit au loin, le Grand Soir semble s’éloigner au fur et à mesure que nous nous en approchons. Les écarts de richesse se creusent, élimant les aspirations à l’épanouissement. Les multiples interprétations s’entrechoquent entre elles dans une cacophonie étourdissante. Le faux prend souvent la figure du vrai pour mieux leurrer. L’avenir est lourd de menaces, le passé devient révolu, le présent forme un refuge pour nos attentes et nos espoirs. Le Bien commun, ce que tous et toutes ont en partage, se fragmente sous les coups de butoir de notre confort et de notre indifférence.
Les enjeux du temps présent percutent mes références du passé issues de mon expérience. Ils m’interpellent comme historien, mais aussi comme citoyen du Québec du début du troisième millénaire. Afin de donner un sens à cette rencontre du passé et du présent, mon essai reprend l’appel de la philosophe Hannah Arendt : « ce que je propose est très simple : rien de plus que de penser ce que nous faisons ».
Afin de donner un sens à cette rencontre du passé et du présent, mon essai reprend l’appel de la philosophe Hannah Arendt : « ce que je propose est très simple : rien de plus que de penser ce que nous faisons ».
Pourquoi le format de l’essai ?
Après tout, l’essai n’est pas d’usage fréquent parmi les historiens et, plus généralement, parmi les scientifiques. Pour nous, il a généralement mauvaise presse. Le terme en soi sous-entendrait une réflexion brouillonne ou inaboutie, où l’argumentation ne se distinguerait pas par la mobilisation de la preuve et sa rigueur d’exposition. Plus encore, il provoquerait l’inconfort : les scientifiques préfèreraient nettement le regard froid et objectif, détaché des contingences humaines, plutôt que la perspective d’un sujet immergé dans le siècle. Pourtant, les cas abondent pour montrer les limites de la posture du scientist as problem solver pour comprendre le monde : le point de vue de Sirius demeure une conception abstraite de l’esprit, voire un argument d’autorité rhétorique assené à un lectorat passif.
Le choix de l’essai se justifie non par facilité, mais plutôt par la nature du sujet traité : celui-ci porte sur la discipline historique. Il y a donc une question de principe qui découle de la réflexion comme activité. Dans sa pratique quotidienne, l’historien n’est pas un Martien jetant son regard sur une terre d’humains, pour évoquer ici le philosophe Ludwig Wittgenstein. L’historien est un spectateur engagé, voire un observateur participant. Il ne peut donc adopter une posture de surplomb, le détachant complètement des êtres qu’il observe. Il fait partie du monde, il fréquente ses concitoyens, il agit à la manière d’un sujet. Faire un essai implique d’accepter cette part de subjectivité qui s’appuie sur mon expérience acquise et sur ma situation actuelle comme historien. C’est aussi la transcender : la subjectivité n'est qu’un narcissisme si elle se contente de déclamer un soliloque autoréférentiel. Je tiens à dialoguer avec mes concitoyens sur mon métier afin d’en montrer la pertinence pour nos temps présents. Dès lors, en adoptant un regard critique, il m’importe d’objectiver ma subjectivité à la manière d’un Pierre Bourdieu, de bien la saisir dans ses conditions sociales et individuelles. Bref, par l’essai, il s’agit d’explorer mes capabilités comme historien : ces possibilités de choisir et d’agir, selon l’acception de la philosophe Martha Nussbaum.
Faire un essai implique d’accepter cette part de subjectivité qui s’appuie sur mon expérience acquise et sur ma situation actuelle comme historien.[...] il s’agit d’explorer mes capabilités comme historien : ces possibilités de choisir et d’agir, selon l’acception de la philosophe Martha Nussbaum.
Marier la tête et la main
Tout au long de cet essai, j’emploie le terme de discipline historique car la pratique de l’histoire, à l’instar des différents métiers de l’activité humaine ou des arts martiaux, s’acquiert par un apprentissage. Toute discipline est faite de la pratique de gestes quotidiens répétés pendant une longue période, elle modèle le regard et affermit le geste. Une discipline est une activité demandant un effort.
Les historiens connaissent l’importance de l’effort. Faire de l’histoire, c’est mener une enquête, c’est marier la tête et la main : chercher dans les index, les dépôts et les bibliothèques ; tourner des pages de livres, de registres ou de documents; lire et noter; déplacer des boites d’archives; s’appliquer à connaitre les différents outils du métier; composer des corpus et les soumettre à l’analyse; vérifier et valider les données; se concentrer devant un écran d’ordinateur; se plier aux rituels de l’écriture; diffuser des résultats de recherche. Tout ce labeur exige du temps, de la patience et de l’opiniâtreté. Tout ce labeur engendre un ethos, des prédispositions fondées sur des valeurs partagées par les praticiens de la discipline, peu importe leur champ d’activités. L’exactitude, la bonne foi, la prudence, la bienveillance, la curiosité et le respect de l’intégrité humaine sont autant de valeurs qui se développent au fil de l’expérience et des rencontres, par le travail de découverte et de critique.
Ainsi, faire de l’histoire, c’est offrir un service public suivant une approche à la fois éthique et politique. Faisant face à des défis complexes et fondamentaux, nos sociétés contemporaines sont sollicitées par de multiples demandes de sens de la part des citoyens. Ces demandes relèvent souvent d’une quête de perspective : nous tous et toutes cherchons à saisir d’où provient telle situation, et quelles seront ses conséquences éventuelles. Ces demandes de sens m’interpellent à titre de serviteur public. La pratique de l’histoire comme service public repose donc sur l’établissement d’une double compréhension fondée sur l’empathie : comprendre les attentes de ses concitoyens, faire comprendre le passé dans toute sa complexité. Voilà la pertinence de ce métier.
La pratique de l’histoire comme service public repose donc sur l’établissement d’une double compréhension fondée sur l’empathie : comprendre les attentes de ses concitoyens, faire comprendre le passé dans toute sa complexité. Voilà la pertinence de ce métier.
Une pratique de la solidarité
Une préoccupation éthique guide finalement ma réflexion sur ma discipline : le respect de la dignité humaine. Cette préoccupation est actuelle. Enclenché après la Deuxième Guerre mondiale avec l’épanouissement de la technoscience, l’urgence environnementale, les politiques de la reconnaissance et les divers mouvements de décolonisation, le tournant éthique promeut la dignité des individus comme principe normatif. Dans l’exercice de leur discipline, les historiens reconnaissent volontiers et prennent en compte l’importance de la dignité humaine. Elle interpelle l’ethos historien et, plus particulièrement, son adhésion aux valeurs de prudence et de bienveillance.
Mieux encore, la dignité oblige les historiens à se concentrer sur l’essentiel : de respecter ce que nous sommes en soi comme êtres humains et d’assurer notre reconnaissance au regard des Autres. Respecter la dignité humaine, vivante et passée, c’est rejeter cette conception d’un objet manipulable, réduit aux simples fonctions d’un instrument dans un modèle abstrait ou dans un récit édifiant. Reconnaître la dignité, c’est instituer des procédures mettant fin aux multiples humiliations qui déprécient notre humanité. Je partage pleinement les propos de mon collègue Carlo Ginzburg : « Il n’y a pas de serment d’Hérodote ou de Thucydide pour les historiens comme il y a un serment d’Hippocrate pour les médecins ; mais s’il y en avait un, le respect des morts devrait y figurer ».
Pour moi, faire de l’histoire devient une pratique de connaissance et de compréhension du passé, une pratique qui nous habilite comme citoyens en nous situant urbi et orbi, une pratique de la solidarité par laquelle nous respectons et nous reconnaissons la dignité humaine par-delà le silence et la mort.
Respecter la dignité humaine, vivante et passée, c’est rejeter cette conception d’un objet manipulable, réduit aux simples fonctions d’un instrument dans un modèle abstrait ou dans un récit édifiant. Reconnaître la dignité, c’est instituer des procédures mettant fin aux multiples humiliations qui déprécient notre humanité.
- Martin Pâquet
Université Laval
Martin Pâquet est actuellement professeur titulaire en histoire au Département des sciences historiques de l’Université Laval. Œuvrant en anthropologie historique, il est l’auteur ou le co-auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont Tracer les marges de la Cité. Étranger, immigrant et État au Québec, 1627-1981 [2005], Langue et politique au Canada et au Québec. Une synthèse historique [2010, avec Marcel Martel], Brève histoire de la Révolution tranquille [2021, avec Stéphane Savard] et Sur la pratique de l’histoire [2025] parus aux éditions du Boréal. Il se spécialise en histoire des cultures politiques et des usages publics du passé dans un contexte contemporain au Québec, au Canada et dans les francophonies nord-américaines. Il intervient régulièrement sur ces sujets dans l’espace public.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre