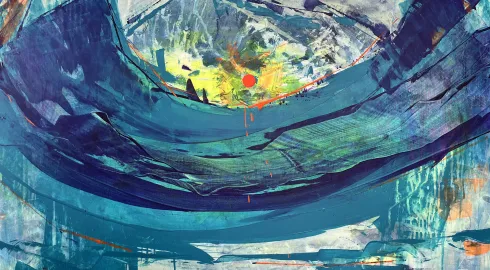La possibilité technique n’est pas l’acte de communication. Il ne faut pas tenir pour acquis qu’une fonctionnalité technique entraîne nécessairement une pratique sociale.
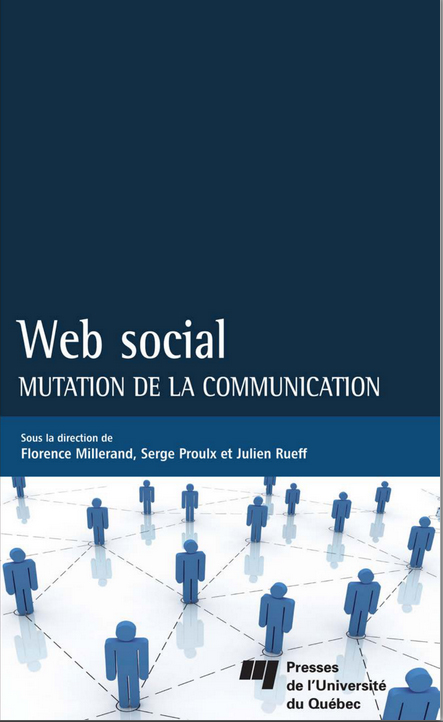
Johanne Lebel : Commençons peut-être par situer un peu les termes. Dans l’introduction de l’ouvrage que vous cosignez avec Serge Proulx et Julien Rueff, publié en 2010, Web social : mutation de la communication, j’ai reconnu, en lisant la définition de web social, les caractéristiques de ce qu’on appelle aujourd’hui les médias sociaux. Vous parlez des nouvelles fonctionnalités qui incitent les « utilisateurs à collaborer entre eux, dans le but de créer et de partager des contenus par l’intermédiaire d’outils tels que blogues, wikis, sites de réseaux sociaux (comme Facebook et LinkedIn), sites de partage de musique, d’images, de vidéos, [etc.] ». Comment placez-vous les termes web social et médias sociaux l’un par rapport à l’autre?
Florence Millerand : L’expression web social apparaît vers les années 2004. C’est en fait le terme utilisé en sciences sociales pour parler du phénomène du Web 2.0, qui émergeait alors. Les médias sociaux, apparus peu après, sont inclus dans cet univers du web social. Les fonctionnalités de chacun sont assez proches, mais le premier terme permet de mieux saisir l’ensemble des usages de collaboration et de production de contenus par les usagers.
Johanne Lebel : Cela permettrait d’inclure un site comme Science Hub?
Florence Millerand : En fait, Science Hub n’est pas un média social au même titre que Facebook, c’est un site de partage de fichiers (d’articles scientifiques en l’occurrence) qui s’inscrit dans la mouvance de la science ouverte militante, qui elle-même est un mouvement s’appuyant sur le web social. Au début, les publications s’échangeaient de main à main, puis ce fut par courriel et au moyen des serveurs de prépublications. Avec Science Hub, on change d’échelle parce qu’on peut contourner les éditeurs en produisant et en diffusant directement des publications – et sans avoir à en payer le coût, d’où les nombreuses poursuites judiciaires. Peu après mon doctorat, on utilisait le mot-clé #IcanhazPDF pour envoyer une demande : « Ah tiens, je voudrais tel PDF ». Avec Science Hub, on a accès à une immense base de données, c’est énorme comme changement.
Pour revenir aux médias sociaux, j’ai écrit en 2016 un article dans la revue Communication, intitulé « Les imaginaires de la science 2.0 : de l’idéal de la science ouverte au marketing de soi ». C’était le compte-rendu d’une enquête sur les usages d’Academia, ResearchGate et My Science Work, ce dernier étant beaucoup moins connu que les deux premiers; ces sites sont un peu les pendants scientifiques de Facebook ou de LinkedIn. Dans l’article, je montrais, par exemple, les différents usages d’Academia. On peut être sur le site par simple imitation : tout le monde y est, donc j’y suis. Dans ces cas, on crée une page et on en reste là, car maintenir un profil sur ce site en plus de celui de sa page institutionnelle et autres, cela peut devenir assez lourd. D’autres l’utilisent comme LinkedIn, comme une sorte de CV numérique. D’autres enfin exploitent toutes les fonctionnalités de collaboration et de coopération. « Tiens, on va lancer ça sur ResearchGate et organiser un groupe pour discuter de tel sujet ».
Johanne Lebel : Pouvez-vous nous situer un peu votre univers théorique?
Florence Millerand : J’ai été formée à la sociologie des usages, une tradition de recherche qui appréhende les transformations suscitées par les technologies à partir de l’examen détaillé des usages. C’est l’étude ce que l’on fait des technologies, mais c’est surtout l’analyse de ce que cela signifie et de ce que cela révèle comme tendances culturelles et sociales de fond.
Cet univers s’oppose à ce qu’on appelle le déterminisme technologique, lequel considère qu’un nouveau média ou un nouveau dispositif technique entraînent directement des changements de pratiques sociales : on va collaborer différemment parce que le média social possède telles ou telles propriétés techniques. On a tendance à penser que parce que les réseaux sociaux favorisent la communication, ils font la communication. Mais dans les pratiques, dans les usages, il y a des métiers, il y a des façons de faire, des habiletés qu’il faut apprendre à développer. La possibilité technique n’est pas l’acte de communication. Il ne faut pas tenir pour acquis qu’une fonctionnalité technique entraîne nécessairement une pratique sociale. Dans les travaux que je mène au sein de ma chaire de recherche, je n'ai jamais vu une pratique sociale découler d'une fonction technique.
Dans les travaux que je mène au sein de ma chaire de recherche, je n'ai jamais vu une pratique sociale découler d'une fonction technique.
Les tenants du déterminisme social soutiendront pour leur part que ce sont les tendances sociales de fond qui structurent et expliquent les évolutions techniques, sans vraiment se préoccuper de l’action de la technique sur les usages.
L’étude des usages sociaux est un peu une troisième voie. On part des pratiques de l’usager, on observe ses gestes et on les documente. C’est une posture de recherche empirique. On peut se demander, par exemple, ce que signifie pour les jeunes chercheurs d’être sur Academia ou de contribuer à Wikipédia. Comment cela s’intègre-t-il dans leurs pratiques au quotidien? Qu’est-ce que ça change quant à leur inscription dans des réseaux de recherche et à la diffusion de leurs travaux – si ça change quelque chose? Ou encore, quelle est leur vision des rapports entre science et société? Et comment cette vision s’incarne-t-elle dans la tenue d’un blogue, par exemple?
Au sein des mêmes cultures épistémiques, on retrouvera des gens qui ont des usages très différents. L’étude des pratiques au niveau micro fait ressortir des phénomènes plus larges. Il faut garder en tête le contexte historique, culturel, social et économique dans lequel se développent tous ces outils de communication.. Tout cela structure les usages singuliers comme les pratiques sociales propres à des communautés. Par exemple, la visibilité que les chercheurs vont chercher sur les médias sociaux est liée à des impératifs d’exposition de soi qui viennent avec une façon de penser la science aujourd’hui, tels l’impératif d’attirer plus de doctorants ou celui de devenir plus présent auprès de certains publics, et pas uniquement le public scientifique.
...ces médias offrent de nouvelles possibilités de dialogue, d’autant que depuis les années 1980 l’idéal de "communauté" scientifique a trouvé écho dans l’avènement des réseaux numériques. C’est ce qui explique qu’Internet a toujours bénéficié d’une sorte d’aura, d’une représentation très positive auprès des chercheurs. Ce réseau résonne avec l’idée d’universalité du savoir scientifique.
Johanne Lebel : Le web social n’est-il pas aussi une occasion d’amplifier le dialogue entre science et société?
Florence Millerand : De fait, ces médias offrent de nouvelles possibilités de dialogue, d’autant que depuis les années 1980 l’idéal de « communauté » scientifique a trouvé écho dans l’avènement des réseaux numériques. C’est ce qui explique qu’Internet a toujours bénéficié d’une sorte d’aura, d’une représentation très positive auprès des chercheurs. Ce réseau résonne avec l’idée d’universalité du savoir scientifique. Ainsi, l’idéal de la démocratisation de la science par les médias sociaux concorde avec le projet de résonnance sociale de la science.
Il serait cependant un peu naïf de prétendre qu’Internet permet, de par ses seules propriétés techniques, de démocratiser les savoirs scientifiques. Cela dit, le phénomène est porteur de nouveaux discours qui ne sont pas sans effet. On a vu, par exemple, une augmentation importante du nombre de projets de science participative et de science citoyenne qui sont organisés en ligne, sur le web. J’ai étudié pour ma part avec des collègues TelaBotanica, un réseau de chercheurs et d’amateurs en botanique. Il est fascinant d’observer que ce réseau, un cas emblématique, a littéralement revitalisé la botanique et l’a remise à l’avant de la scène. Du côté des scientifiques, c’est un nouveau potentiel d’étude de certains phénomènes. Du côté des citoyens, c’est un accès facilité aux chercheurs et aux contenus, et une possibilité de participer à la production de la science. Pensons aussi aux projets de recherche en astronomie, qui font appel aux amateurs depuis longtemps.
Si tout cela ne révolutionne pas les manières de faire, cela amplifie toutefois certaines pratiques en mettant en réseau plus facilement des centaines d’expertises, et surtout en combinant des types d’expertise différents qui ne se seraient pas nécessairement retrouvés ensemble autrement : une chercheuse en botanique, un professionnel d’un ministère et un naturaliste amateur qui contribuent tous à documenter la flore d’une région du Québec, par exemple. C’est là toute la promesse des plateformes de sciences participatives. Il existe d’ailleurs des portails qui regroupent des dizaines de projets : on choisit celui auquel on souhaite participer comme citoyen ou citoyenne.
Johanne Lebel : Je participe pour ma part au BumbleBee Watch, un réseau de chercheurs et d’amateurs qui documente ces gros butineurs que sont les bourdons. C’est motivant de recevoir le retour, la réponse d’un chercheur, on est encouragé à développer notre capacité d’identification et d’observation.
Florence Millerand : Effectivement, c’est très stimulant de se sentir partie prenante de l’évolution de la recherche. Pour les chercheurs, ce sont aussi de nouvelles opportunités : bénéficier d’observateurs passionnés qui peuvent fournir un volume et une qualité d’informations qu’eux-mêmes ne seraient pas en mesure de fournir soit par manque de connaissances – je fais référence aux savoirs de terrain –, soit par manque de moyens – aucun programme de financement ne pourrait couvrir de tels coûts.
Johanne Lebel : Je sais que certains chercheurs sont très critiques face à la pratique des médias sociaux. Je me souviens de l’un d’eux qui avait beaucoup travaillé sur la question du cannabis. On lui disait qu’il perdait son temps, mais, pour lui, c’était un devoir de rétablir certains faits dans les échanges sur Facebook.
Florence Millerand : Porter une voix scientifique dans l’espace public peut être très exigeant, voire risqué parfois. Un discours au « je », une certaine mise à distance de l’établissement et des occasions d’échanger sans intermédiaires sont des opportunités que certains chercheurs non seulement apprécient, mais trouvent nécessaires. Les blogues, par exemple, suscitent des débats que l’article scientifique n’engendre pas. Certains y voient du marketing de soi, d’autres une distraction, d’autres encore une posture qui irait à l’encontre de la réserve propre au métier de scientifique. En fait, les controverses autour de ces usages expriment différentes tensions qui renvoient à l’ethos de la science et à l’idéal mertonien.
Johanne Lebel : Quel serait cet idéal?
Florence Millerand : C’est celui que la science ouverte revendique, du moins en partie. Le sociologue Robert K. Merton a défini l’éthos scientifique à partir d’une série de normes, méthodologiques et éthiques, pour guider le comportement des scientifiques. L’une de ces normes, le communalisme, considère les connaissances comme des biens collectifs qui doivent être diffusés dans la société. C’est l’idée que la science doit faire fi des frontières. En quelque sorte, Science Hub met en action cette vision en s’opposant aux logiques de rentabilité derrière la publication des articles scientifiques.
Mais l’idéal mertonien reste un idéal. Academia et ResearchGate, par exemple, formulent leur approche dans des termes d’ouverture : « Regardez, nous, tout ce qu’on veut, c’est de rendre disponibles les publications ». Mais dans les faits, ils concurrencent les archives ouvertes et les dépôts institutionnels des universités, et ils monétisent l’activité des chercheurs. Initialement, ces initiatives ont été mises en place par des chercheurs, souvent des doctorants ou des postdocs qui se trouvaient pris en otage par les éditeurs privés gardiens des articles scientifiques produits par l’argent public. Puis, ces sites ont évolué vers la vente de services et vers des logiques propriétaires accompagnées d’un marketing très agressif allant jusqu’à polluposter nos boîtes de courriel en envoyant des notifications à tout vent. Sans surprise, cela a fini par conduire à une désaffection. ResearchGate, par exemple, peut vous créer un profil sans votre consentement. Si un de vos coauteurs possède un profil, cela suffit pour que l’algorithme moissonne le web afin de cueillir vos publications et de les disposer derrière votre profil autocréé. Cela fâche beaucoup.
Johanne Lebel : Vous utilisez Twitter, je pense?
Florence Millerand : Je m’en sers surtout comme source d’information. Avec certains collègues, on « se suit » mutuellement. Ce peut être utile aussi pour recruter un postdoc, par exemple. J’ai des collègues qui commentent leur activité scientifique au quotidien sur Twitter ou sur Facebook. C’est intéressant parce que c’est un peu comme de travailler à « haute voix ». On peut rendre visible le travail réalisé hors des cours, des conférences, des publications. C’est un accès aux coulisses du métier de professeur d’université. Évidemment, il y a des coulisses qu’on ne veut pas connaître, ou qu’on ne devrait pas connaître…
Mais ces nouvelles possibilités viennent avec une charge, voire une surcharge. Quand on suscite l’engagement, il faut être là pour répondre aux questions suscitées par nos interventions. C’est à intégrer dans sa pratique de chercheur, tout comme on s’est habitué à répondre aux questions des journalistes. On demande aux chercheurs d’être sur tous les fronts, d’être plus présents dans les médias aussi pour contrer le phénomène des fausses informations, et c’est un problème important. Mais se lancer dans une discussion sur un groupe Facebook ou animer un compte Twitter peuvent prendre énormément de temps. Cela crée des attentes. Il faut se former, être préparé, car on attend de nous une parole rigoureuse, informée.
De plus, cela ne remplace pas le travail de communication scientifique ou de journalisme scientifique. C’est une erreur de penser que parce que nous sommes des enseignants et des chercheurs habitués à prendre la parole en public, nous sommes forcément compétents pour parler de nos recherches de manière intéressante et juste avec d’autres publics que nos étudiants.
C’est une erreur de penser que parce que nous sommes des enseignants et des chercheurs habitués à prendre la parole en public, nous sommes forcément compétents pour parler de nos recherches de manière intéressante et juste avec d’autres publics que nos étudiants.
Johanne Lebel : C’est une prise de parole spécifique en effet.
Florence Millerand : Exactement. Pour ceux et celles qui acceptent de le faire et qui veulent bien le faire, c’est une nouvelle occasion de faire circuler des savoirs et des connaissances. On le voit beaucoup aussi chez les chercheurs de sciences sociales, qui travaillent sur ou plutôt avec les êtres humains. C’est une manière d’accéder à des informateurs, à des participants à la recherche. Au sein de ma chaire de recherche et du LabCMO , il nous arrive fréquemment d’utiliser les médias sociaux comme outil de recrutement.
Cela m’amène à la question de l’expertise. Dans un chapitre du livre Experts, sciences et sociétés [en libre accès], je parle justement du communicateur ou de la communicatrice scientifique et de Wikipédia, qui mettent de l’avant de nouvelles figures d’experts et de nouvelles formes d’expertise, qu’on pourrait qualifier de distribuées. Revenons aux sciences participatives : à partir du moment où l’on reconnaît que la description de telle espèce a été réalisée grâce à la contribution d’une armée de citoyens, on place le projecteur sur un autre type d’expertise – et on décentre un peu notre regard de la sphère scientifique. L’expertise, on le sait, ne se situe pas uniquement dans les universités et chez les chercheurs. Tous les producteurs de savoirs qui ne sont pas forcément des scientifiques, mais dont la contribution à la science est pourtant reconnue, deviennent plus visibles grâce à des initiatives de science participative. Wikipédia est un très bon exemple.

Johanne Lebel : Comment voyez-vous la suite des choses?
Florence Millerand : Pour ce qui est de la science ouverte, il y a un mouvement de fond et je pense que ce développement est un vœu de l’ensemble de la communauté, et le mien aussi. Mais il y a en même temps des logiques fortes, commerciales notamment, qui pèsent lourd et qui freinent beaucoup les changements.
Quant à la science participative, je m’y intéresse depuis le début des années 2010 et je suis contente de voir que ce type de démarche prend de plus en plus de place dans le monde scientifique et dans la société plus généralement. Contribuer à un projet de recherche comme participant, que ce soit en donnant un peu de son sang, de son temps ou de son intelligence, c’est aussi une occasion de mieux comprendre comment on fabrique les connaissances. Participer à leur diffusion, via Wikipedia ou autre, c’est aussi une manière de lutter contre la prolifération des fausses informations. Du côté de la recherche, travailler sur des projets de science participative permet d’être plus en phase avec les préoccupations des citoyens concernés, et il y a des occasions d’apprentissage de part et d’autre.
Ce n’est pas sans problèmes ni controverses; le web et les médias sociaux ne viennent pas tout régler et il ne faut pas penser qu’ils vont fondamentalement révolutionner les choses. Sur le plan des dynamiques d’évolution, je m’inscris dans la thèse de l’amplification suggérée par Dominique Boullier et d’autres avant lui : il n’y a pas de révolution numérique, mais il y a une amplification des tendances. Un peu comme l’imprimerie est venue amplifier la circulation des connaissances en facilitant la diffusion des textes.
Johanne Lebel : Mais cette amplification, pour des questions de nombre, de changement d’échelle, ne va-t-elle pas produire des effets imprévisibles, des émergences?
Florence Millerand : L’incertitude est, semble-t-il, ce qui caractérise notre époque, et il ne fait pas de doute selon moi que les médias sociaux et plus généralement les technologies de communication numérique dans leur ensemble y participent. Je pense que les technologies ont surtout un effet de levier dans la réorganisation sociale de nos sociétés contemporaines. Et c’est aussi pour cette raison que je m’intéresse moins à ce que le numérique transforme, et plus à ce qu’il participe à transformer.
RÉFÉRENCES
- Boullier, D. (2018). Sociologie du numérique (2e éd.). Paris : Armand Colin.
- Jaurréguiberry, F., Proulx, S. (2011). Usages et enjeux des technologies de communication. Toulouse, Éres.
- Millerand, F., Proulx, S., Rueff, J. (2010). Web social : mutation de la communication. Presses de l’Université du Québec.
- Millerand, F. (2015). Les imaginaires de la science 2.0 : de l’idéal de la science ouverte au marketing de soi, Communication, 33(2), DOI : 10.4000/communication.6070
- Millerand, F., Heaton, L., Myles, D. (2018). "Les reconfigurations sociales de l'expertise sur Internet". Dans F. Claveau, J. Prud'homme (éd.), Experts, Sciences et Sociétés (pp. 153-174). Montréal, Presses de l'Université de Montréal.
L’incertitude est, semble-t-il, ce qui caractérise notre époque, et il ne fait pas de doute selon moi que les médias sociaux et plus généralement les technologies de communication numérique dans leur ensemble y participent. Je pense que les technologies ont surtout un effet de levier dans la réorganisation sociale de nos sociétés contemporaines. Et c’est aussi pour cette raison que je m’intéresse moins à ce que le numérique transforme, et plus à ce qu’il participe à transformer.
- Florence Millerand
Université du Québec à Montréal
Florence Millerand est professeure titulaire au Département de communication sociale et publique à l’UQAM. Elle est titulaire de la Chaire de recherche sur les usages des technologies numériques et les mutations de la communication, codirectrice du Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur (LabCMO) et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST). L’étude des mutations sociales liées à l’essor du numérique est au cœur de son programme de recherche. Elle s’intéresse, entre autres, aux plateformes collaboratives en science et à la montée des savoirs amateurs sur Internet, aux cultures numériques émergentes, aux pratiques jeunes de consommation de contenus médiatiques et aux enjeux sociopolitiques de la production et l'usage de « mondes de données ».
Entretien réalisé par Johanne Lebel, rédactrice en chef du Magazine de l'Acas.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre