-
 18 septembre 2018
18 septembre 2018Questions pour Geneviève Deblois, postdoctorante
Centre de recherche sur le cancer de l’hôpital Princess Margaret, Toronto -
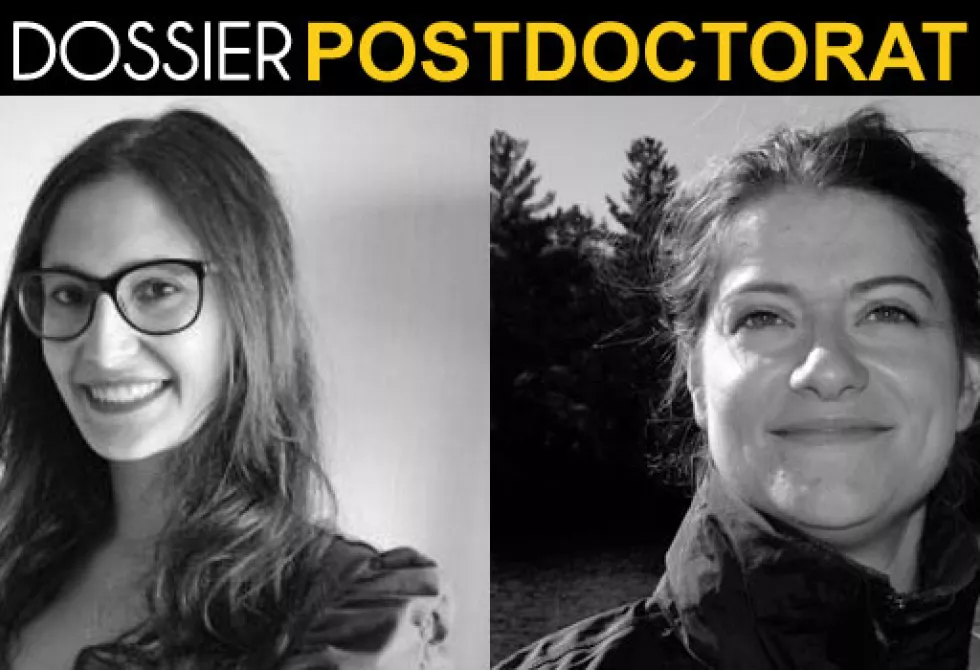 17 septembre 2018
17 septembre 2018Cuisine administrative : conversation entre les deux corédactrices du dossier
Université McGill, Université Laval -
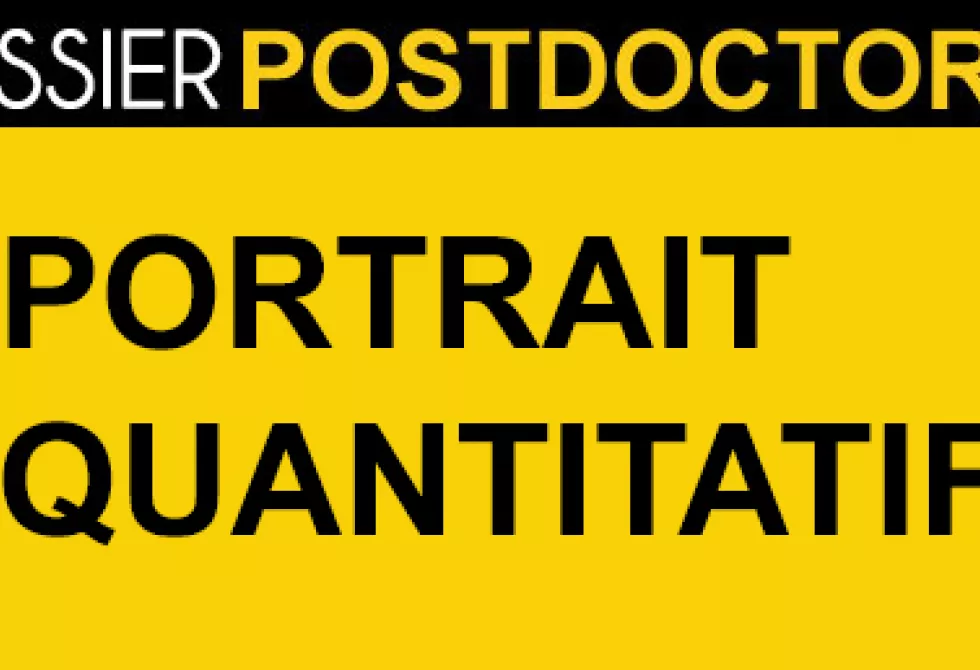 16 septembre 2018
16 septembre 2018Postdoctorants et postdoctorantes : portrait quantitatif d’une population
-
 16 septembre 2018
16 septembre 2018Questions pour Francis Laliberté, postdoctorant
Université de Sherbrooke -
 12 septembre 2018
12 septembre 2018Questions pour Évelyne Jean-Bouchard, postdoctorante
Université de Montréal -
 12 septembre 2018
12 septembre 2018L’importance des postdoctorants pour le système de la recherche
Université de Montréal -
 12 septembre 2018
12 septembre 2018La supervision des postdoctorants : Entretien avec Claude Perreault
Université de Montréal -
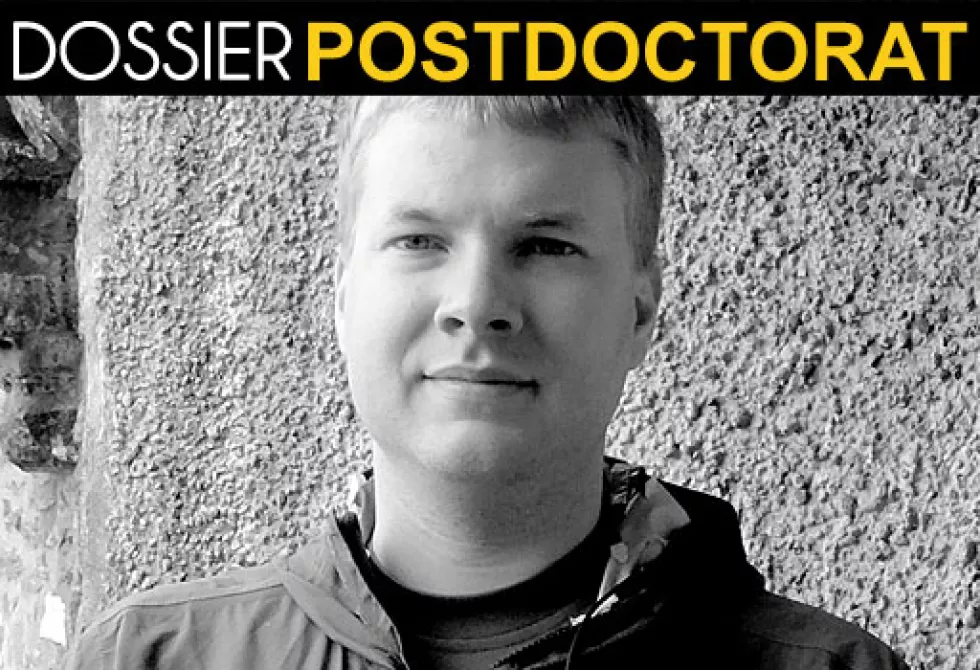 12 septembre 2018
12 septembre 2018Questions pour Jean-François Gélinas, postdoctorant
Université McGill -
 12 septembre 2018
12 septembre 2018Insertion professionnelle hors des murs de l’université : pistes de solutions issues d'une consultation
-
 12 septembre 2018
12 septembre 2018Questions pour Emilie Champagne, postdoctorante
Université Laval, Ouranos et ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs -
 12 septembre 2018
12 septembre 2018La supervision des postdoctorants : Entretien avec Nelson Thiffault
Ressources naturelles Canada -
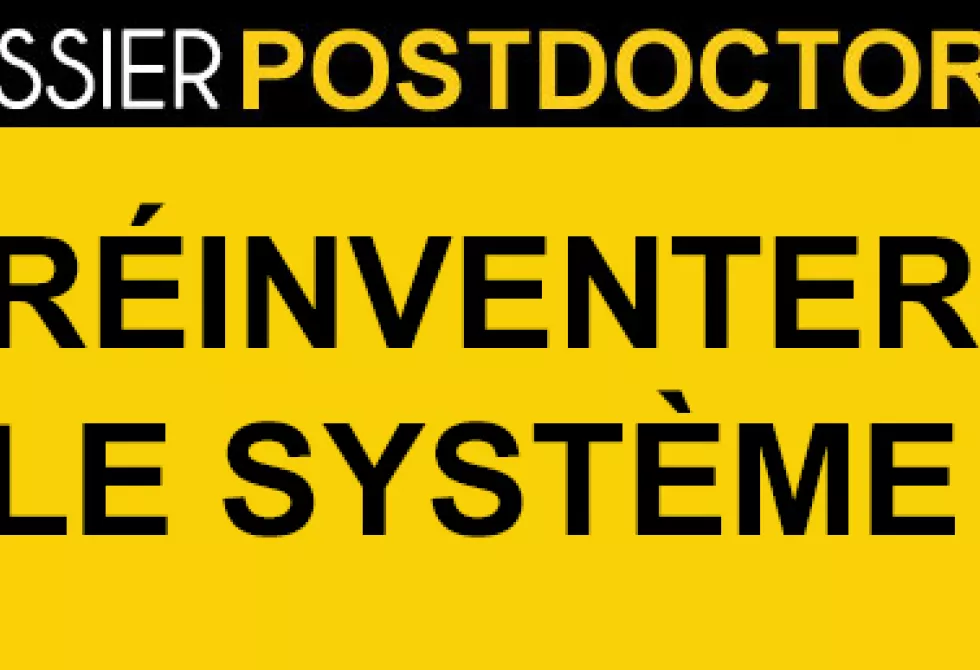 12 septembre 2018
12 septembre 2018Réinventer le système de formation postdoctorale canadien
Il y a présentement des items dans votre panier d'achat.