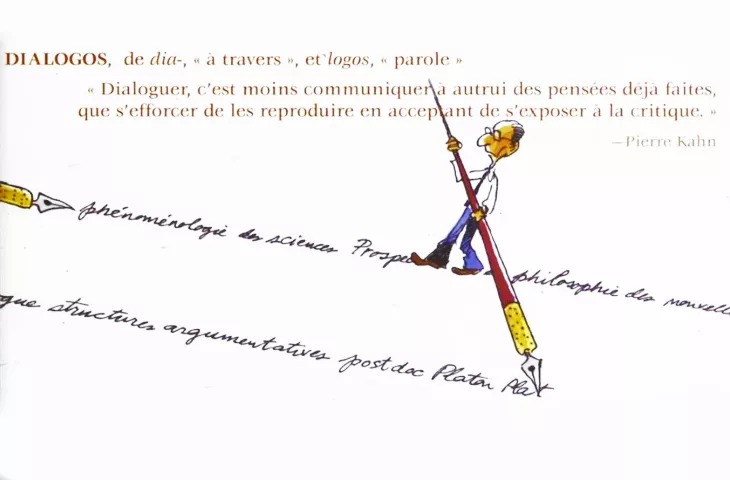La découvrabilité de la science en français sert-elle l'intérêt public? À travers une réflexion sur son rôle dans la société, une journaliste se demande comment elle peut y contribuer.
J'ai toujours aimé expliquer mon métier aux gens. Car derrière le mot « journaliste » se cachent bien des définitions. Tout dépend du statut d'emploi, de l'expérience, du type de sujet que l'on souhaite couvrir (le « beat »), et de notre imagination. Une des belles choses de ce métier, c'est qu'il peut prendre la forme qu'on arrive à lui donner.

J'appartiens pour ma part à une espèce un peu unique : les journalistes scientifiques. Nous sommes les nerds du journalisme, frétillant à la lecture d'une étude innovante, prêt·es à discuter longuement des avancées dans un domaine de pointe. Je m'y trouve comme un poisson dans l'eau à discuter de microélectronique et à disserter sur les systèmes d'intelligence artificielle. Mon sujet de prédilection, ce sont les nouvelles technologies - mais je suis trop curieuse pour m'y limiter. Ma mission, c'est de faire le pont entre celles et ceux qui fabriquent les technologies de demain et le public.
C'est pour cette raison que j'ai dit oui sans hésiter lorsqu'on m'a proposé de devenir journaliste en résidence à la Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français.
Initiée par le Fonds de recherche du Québec, la Chaire a pour tâche d'« étudier les voies potentielles d’accroissement de la production et de la découvrabilité des contenus scientifiques en français ». Découvrabilité? N'est-ce pas mon métier, justement?
Un nouveau continent
La découvrabilité – la capacité de trouver un contenu que l’on cherche, et d’en dénicher de nouveaux par hasard – suscite l’intérêt depuis les années 2010. On la trouve « sur les lèvres de bon nombre de politiciennes et politiciens et d’actrices et acteurs du champ culturel », écrivaient mes collègues de la Chaire dans une chronique parue au début de l'année. Plus récemment, ajoutent-ils, le monde de la recherche scientifique francophone a commencé à s’y intéresser, dans le but de « clarifier les enjeux en présence et d’identifier les leviers à activer pour soutenir et renforcer l’usage du français, mais aussi celui du multilinguisme ».
À travers la Chaire, je me trouve donc chargée de contribuer à cette découvrabilité. Mais dès le début de mon mandat, ce terme m'a donné du fil à retordre. Car, mis à part les scientifiques, quels sont les publics de la science? À cette question, peu de gens semblent avoir une réponse claire. Mais si on ne sait pas précisément qui elles sont, comment faciliter la découvrabilité de la science en français pour ces personnes?
La découvrabilité – la capacité de trouver un contenu que l’on cherche, et d’en dénicher de nouveaux par hasard – suscite l’intérêt depuis les années 2010. [..] dès le début de mon mandat [à la Chaire], ce terme m'a donné du fil à retordre. Car, mis à part les scientifiques, quels sont les publics de la science?
Avant de tenter de les atteindre, je me devais cependant de creuser une autre interrogation, plus hérétique : pourquoi devrions-nous faire de la science en français?
Ce réflexe de journaliste suscite parfois l'ire des gens que nous interrogeons. Demander « à quoi sert votre champ de recherche? » semble en effet renforcer l'impératif frustrant de travailler à quelque chose « d'utile ». Mais, bien sûr, il est aussi essentiel de se lancer dans des directions « inutiles » - qui mènent parfois à des résultats inattendus.
Pour moi, qui pense constamment à la personne qui lira mon texte, cette question permet de lier un projet de recherche à cette lectrice. À celle-ci, il est essentiel d'expliquer les bases. De lui montrer comment la science est liée à son quotidien, ses préoccupations. J'ai donc posé la question « à quoi sert la science en français » à Simon van Bellen, conseiller principal en recherche au Consortium Érudit. Par courriel, il m'a expliqué qu'elle sert plusieurs publics: « la société, les auteur·es, le lectorat scientifique et le lectorat non-scientifique ». Ah! Mon sourcil s'est levé à voir ce dernier type de public: c'est celui qui m'intéresse! Pour « les décideur·euses et les praticien·nes (par exemple, infirmier·ères, pompier·ères) », la science se doit d'être en français « pour atteindre un lectorat ne maîtrisant pas ou peu l’anglais ».
Voilà donc un début de réponse : la science se doit d'être accessible en français pour pouvoir être lue par un public qui ne maîtrise pas nécessairement l'anglais. Au-delà des exemples cités par Simon, on peut aussi penser à des militant·es qui s'unissent pour des causes comme la préservation de milieux naturels ou à des malades chroniques, pour qui une publication peut représenter une lueur d'espoir.
On peut tirer une autre raison de publier en français d'un communiqué de presse du gouvernement québécois soulignant la « création d'un partenariat Québec-France sur la découvrabilité des contenus scientifiques francophones ». On y lit que le recul du français dans le monde scientifique « peut entraîner des répercussions importantes, notamment sur la langue utilisée dans les institutions d'enseignement supérieur par les étudiants québécois et internationaux, sur la langue de travail dans les entreprises, sur la langue employée dans les publications scientifiques et sur l'accessibilité de la population aux résultats de la recherche ». D'autres publics à garder en tête, donc, lors de nos réflexions sur cette fameuse découvrabilité.
Olivier Bernard l'a expertement démontré dans la toute dernière saison de son balado Dérives, où il enquête sur la supposée maladie de Lyme chronique : les publics « non-scientifiques » dévorent la science, parfois de manière nocive pour eux. On peut certainement blâmer leur manque de littératie scientifique, leur incapacité à lire correctement des graphiques et à interpréter un vocabulaire complexe. Mais à ces obstacles s'ajoute certainement la langue.
La science en français est-elle alors un enjeu de santé publique?
En français, please
Je n'avais jamais assisté à un congrès de l'Acfas lorsque mes collègues de la Chaire m'ont invitée à présenter une communication au colloque 32 , intitulé « De la découvrabilité des contenus savants en français », en mai dernier. C'était pour moi l'occasion de voir concrètement ce sur quoi ils et elles travaillent. Car si le public en sait bien peu sur le métier de journaliste, je suis pour ma part parfois perdue dans les méandres de la machine universitaire. Comment ça fonctionne, dont, une chaire? Le matin du premier jour, j'avais l'impression que c'était la rentrée - j'étais fébrile et en retard (j'ai ce défaut, mea culpa). Je me suis glissée dans une salle bondée, prête à me remplir le cerveau.
Car si le public en sait bien peu sur le métier de journaliste, je suis pour ma part parfois perdue dans les méandres de la machine universitaire. Comment ça fonctionne, dont, une chaire?
Si toutes les présentations étaient stimulantes, celle de la traductrice Susanna Fiorini, de l'Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities (OPERAS), m'a jetée à terre. À la question: « les outils de traduction automatique pourraient-ils contribuer à résoudre le problème? », sa réponse était sans appel : pas encore. Dans une étude scientifique, le choix des mots et la formulation des phrases compte pour beaucoup, a-t-elle rappelé, exhibant des exemples parlants où le sens de paragraphes se voyait parfois inversé et des bouts de phrase carrément inventés par l'outil. Sa conclusion m'a surprise, convaincue que j'étais que les systèmes d'intelligence artificielle allaient bientôt rendre le métier de traducteur obsolète. Celles et ceux qui, comme moi, rêvent de voir ces outils faciliter la transmission d’information entre différentes langues ont dû réviser leurs attentes.
Chasse au trésor
Le lendemain matin, je suis arrivée au congrès prête à partir à l'aventure. J'avais consacré ma première journée à « ma » chaire, il était temps de butiner.
J'ai commencé par me glisser dans une salle où se discutait la promotion de la découvrabilité des savoirs en français, juste à temps pour entendre l'annonce d'une nouvelle plateforme de l'Acfas mettant en valeur les archives colligées lors des anciens congrès.
Cette présentation m'a fait saliver. Car dans mon métier, une des tâches qui me donne du fil à retordre est celle de dénicher des spécialistes pour discuter d'un sujet particulier. Certain·es de mes collègues y excellent (allô Monique Guilbault, la reine des recherchistes!), mais pour moi c'est toujours un défi. Je rêve d'un outil de recherche centralisé, qui regrouperait non seulement les professeur·es de toutes les universités québécoises, mais aussi les étudiant·es gradué·es, et qui me donnerait une idée de leur spécialité. Je sais que ce rêve est illusoire : qui garderait une telle base de données à jour? Pour me consoler, j'allais désormais avoir la nouvelle plateforme de l'Acfas.
J'ai ensuite passé la semaine à sauter d'une présentation à l'autre. En entrant dans la salle presque vide d'un colloque destiné à l’obsolescence, j'ai eu l'impression de gagner le gros lot. Profitant d'un temps mort, je me suis permis de poser mes questions de néophyte : c'est quoi l'obsolescence? Parle-t-on seulement d'obsolescence programmée? Les participant·es ont répondu avec enthousiasme - et j'ai eu l'impression qu'on me fournissait un article tout cuit dans le bec.
Ma liste de coups de cœur est longue, depuis un colloque sur les iniquités environnementales et un autre sur la santé autochtone. J'ai pu assister à distance à une présentation sur l'écoconception d'où j'ai tiré cette citation qui me hante : « un téléphone en obsolescence programmée aujourd'hui est un matériau médical de moins pour les générations futures ».
Malgré tous mes efforts, j'ai passé la semaine à vivre un FOMO (Fear of Missing Out) déchirant. Le prochain congrès est déjà à mon agenda, et je songe à me procurer des drogues de performance pour maximiser ma participation. Quand je serai grande, j’y proposerai mon propre colloque.
Pour le bien commun
Depuis déjà un peu plus d'un an, le mot « découvrabilité » occupe un espace conséquent dans mon esprit. J'en discute avec quiconque veut bien m'écouter. Au nom de la Chaire, j'ai rencontré de nouvelles personnes dont les métiers sont parallèles aux miens et qui ont ajouté des bûches à mon cerveau en feu.
J'ai aussi rejoint le CA de l'Association des communicateurs scientifiques (ACS), qui regroupe des gens qui, comme moi, ont fait de la découvrabilité des sciences un métier. Je vois des liens évidents entre cette organisation et la mission de la Chaire. Comment les milieux scientifiques et celui de la vulgarisation peuvent-ils mieux collaborer?
Marie-Jean Meurs, cotitulaire de la Chaire et professeure au département d'informatique de l'UQAM, m'a aussi confié un mandat qui m'occupera dans les prochains mois. « J'aimerais que tu organises des rencontres avec des gens qui joueraient le rôle de « patient·es partenaires », m'a-t-elle demandé, une tâche qui m'évoque le travail mené par l'Atelier des savoirs partagés, qui « facilitent la liaison entre les acteurs et actrices terrain impliqué·es dans des actions de vitalisation de communautés rurales et une quinzaine de chercheur·euses provenant de 8 universités ». J’irai donc à la rencontre des gens qui utilisent la science pour découvrir avec eux comment celle-ci pourrait mieux leur parvenir.
Au risque de sembler idéaliste, j’aime rappeler que la tâche première d'un·e journaliste est de servir « l'intérêt public », dixit le Conseil de presse du Québec. C’est pourquoi rendre la recherche accessible, incluant celle qui est faite ici, au Québec, et qui répond à des impératifs qui nous correspondent, est la mission que je me donne.
- Gabrielle Anctil
journaliste scientifique
Gabrielle Anctil est journaliste indépendante. On peut la lire dans les pages de Le Devoir, Continuité, Vélo mag et Québec Science où elle tient la chronique Technopop. On peut l’entendre à Moteur de recherche sur les ondes de ICI Radio-Canada première. On peut la voir à Savoir média où elle anime les émissions Bataille pour la forêt et Soif pour l’énergie. Gabrielle est l’autrice de l’essai Loger à la même adresse où elle s’intéresse aux modes de vie en communauté comme solution à divers maux de notre société.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre