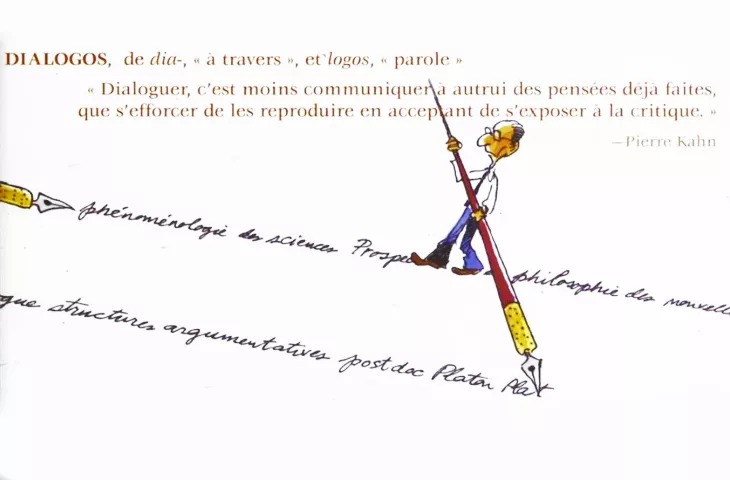Après la publication d’un article juridique sur l’interprétation bilingue des lois au Québec, une réaction inattendue est venue non pas du fond, mais d’un mot : « chercheure ». Ce billet explore ce que cette indignation révèle sur notre rapport aux normes linguistiques et à la diversité francophone.
Quand un mot prend toute la place
J’ai récemment publié un article dans Options politiques, la revue de l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP), qui portait sur l’interprétation bilingue des lois au Québec — un sujet juridique complexe, ancré dans la réalité canadienne où, bien que le français soit la seule langue officielle de la province, les lois doivent exister en versions française et anglaise également valides. L’article explorait les conséquences juridiques d’une disposition de la Charte de la langue française sur le fonctionnement du bilinguisme législatif au Québec.
À ma surprise, ce n’est pas l’enjeu juridique soulevé par mon analyse qui a suscité la réaction la plus vive, mais un mot : chercheure. Un lecteur m’a écrit pour me reprocher l’emploi de ce féminin, qu’il jugeait fautif, voire illégal.
Il qualifiait le mot de « barbarisme », en s’appuyant sur l’autorité de l’Académie française pour affirmer que j’aurais dû écrire chercheuse, forme jugée régulière et correcte. Cette critique, formulée avec assurance, mais sans égard apparent pour la réalité linguistique canadienne, trahit une vision centralisée de la langue, détachée des usages vivants et des cadres juridiques qui façonnent le français ici.
Le message ne disait rien du fond de l’analyse : il s’en prenait à une seule forme, au nom d’une conception rigide de la norme.
Ce reproche m’a fait réfléchir à ce qu’il révèle : une certaine idée de la langue française, exclusive, normative, punitive. Et sur les écarts parfois vertigineux entre l’usage, la norme… et ceux qui prétendent en être les gardiens.
Une réaction révélatrice
L’auteur du message est affilié à une organisation militante connue pour intenter des actions en justice contre des institutions publiques françaises accusées d’utiliser des anglicismes en contravention à la loi Toubon. Ce texte législatif de 1994, porté par le ministre de la Culture Jacques Toubon, impose l’emploi du français dans les actes administratifs, la publicité, la signalétique et les communications commerciales, même dans les milieux professionnels et technologiques. Il vise à protéger la langue française… parfois contre son propre usage évolutif.
Certaines poursuites intentées par cette association ont visé des universités, des collectivités territoriales, ou encore des institutions culturelles françaises dont l’identité visuelle ou les slogans contenaient trop d’anglais. L’objectif? Faire respecter la loi — ou du moins, une certaine vision de la loi, où chaque anglicisme devient un affront, et chaque mot un suspect.
On peut se demander, non sans une pointe d’ironie, si cette association se reconnaîtrait le pouvoir d’intenter une action contre une université canadienne. Le mot chercheure, importé en contrebande linguistique dans les sphères universitaires de ce côté-ci de l’Atlantique, serait-il passible d’une sanction transfrontalière? Voilà, sans doute, une question stimulante pour un séminaire de droit international public…
Mais cette posture révèle une confusion tenace entre langue comme bien commun vivant, et langue comme objet sacralisé. Elle rappelle, en miroir inversé, la Charte de la langue française au Québec — la loi 101 — qui vise elle aussi à protéger le français. La différence est cependant de taille : en France, la loi Toubon défend une langue majoritaire contre les excès de l’anglais; au Québec, la Charte défend une langue minoritaire dans un espace nord-américain largement anglophone. D’un côté, une politique de norme; de l’autre, une politique de survie.
Un mot illégal? L’accusation peut faire sourire, mais elle est révélatrice d’une certaine vision de la langue : une conception dogmatique, fermée, punitive, où chaque mot est suspect jusqu’à preuve du contraire. On ne discute plus, on surveille. On ne nuance plus, on classe. Ce n’est plus la langue comme moyen de dire le monde, mais comme instrument de contrôle.
Ce reproche illustre bien que le dogmatisme linguistique ne se limite pas à des questions de forme : c’est une posture profondément enracinée dans une vision fermée et hiérarchisée de la langue. Une vision qui refuse l’idée même de variation, et qui impose une norme unique — souvent dictée par une vision centralisée de la langue, ancrée dans les institutions parisiennes, et aveugle à la diversité des francophonies.
...le dogmatisme linguistique ne se limite pas à des questions de forme : c’est une posture profondément enracinée dans une vision fermée et hiérarchisée de la langue. Une vision qui refuse l’idée même de variation, et qui impose une norme unique — souvent dictée par une vision centralisée de la langue, ancrée dans les institutions parisiennes, et aveugle à la diversité des francophonies.
Norme, usage et pouvoir
Or, ici au Canada, le mot chercheure est bel et bien utilisé. Il figure sur les sites de plusieurs universités, dans des publications savantes, dans des signatures professionnelles. Il ne s’agit pas d’une erreur ni d’un caprice : c’est un choix, motivé par une volonté de cohérence (avec professeure, auteure, docteure) et par une exigence de visibilité.
Il est vrai que ni l’Office québécois de la langue française ni le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada ne recommandent officiellement ce mot. L’OQLF privilégie la forme chercheuse, qu’il considère comme régulière et bien ancrée. Mais il reconnaît aussi la légitimité d’usages émergents, dans une optique de respect pour la diversité linguistique. Dans un monde où la langue évolue avec ses locuteurs et locutrices, faut-il vraiment condamner ce qui s’écarte de la norme — ou plutôt s’ouvrir à ce qu’il révèle?
Car au fond, c’est cela qui me préoccupe : qu’un mot efface un message. Que l’on ignore le cœur d’un article — sur l’interprétation bilingue des lois, sur l’égalité des langues officielles, sur l’accès à la justice — pour mieux cibler une forme verbale qui dérange. Il ne s’agit plus d’amour de la langue, mais de crispation. De refus d’écouter quand le mot ne vient pas d’un lieu autorisé.
La langue française est riche, diverse, mouvante. Elle ne vit pas sous vitrine. Elle s’adapte, s’invente, se politise parfois — et c’est très bien ainsi. L’usage de chercheure ne demande pas l’approbation de l’Académie française pour exister. Il reflète simplement une réalité, ici, au Canada : celle d’une langue qui cherche à nommer justement les personnes qui la parlent.
Le français n’est pas un bloc monolithique façonné à Paris pour être exporté tel quel. C’est une langue plurielle, façonnée par les contextes, les communautés et les usages. Ici au Canada, le français s’exprime différemment d’une province à l’autre, d’un domaine à l’autre. Il s’adapte. Il respire.
Dans un tel contexte, vouloir imposer une seule norme, au nom d’une prétendue pureté linguistique, relève moins de l’amour de la langue que de l’exercice du pouvoir. C’est oublier que les mots ne sont pas neutres : ils désignent, ils invisibilisent, ils incluent ou ils excluent.
Il faut dire aussi que, dans un espace francophone minoritaire, les injonctions normatives venues de l’extérieur résonnent autrement. Elles se heurtent à une histoire marquée par l’insécurité linguistique, cette tension constante entre parler comme on parle ici… et parler comme on pense qu’il faudrait parler pour être pris au sérieux.
Mais la légitimité ne vient pas que d’en haut. Elle vient aussi de l’usage, du terrain, de l’écoute des réalités sociales. Dire chercheure, ce n’est pas mépriser le français : c’est le vivre autrement. C’est affirmer qu’il peut nommer les femmes sans s’excuser. Qu’il peut évoluer sans se trahir. Et qu’il peut refléter la société telle qu’elle est, sans renier ce qu’elle devient. C’est là une conviction que je porte personnellement.
...vouloir imposer une seule norme, au nom d’une prétendue pureté linguistique, relève moins de l’amour de la langue que de l’exercice du pouvoir. C’est oublier que les mots ne sont pas neutres : ils désignent, ils invisibilisent, ils incluent ou ils excluent.
Habiter la langue autrement
Je suis née en France, j’y ai grandi, et j’y ai appris une langue profondément liée à une culture de la norme. Mais c’est ici, au Canada, que j’ai appris à penser cette langue autrement.
Ici, le français ne se pense pas en surplomb : il se parle, il se négocie, il se défend dans un espace où il est parfois minoritaire. Et il se transforme.
C’est pourquoi je reçois d’autant plus vivement ces critiques dogmatiques venues d’ailleurs, formulées comme des rappels à l’ordre depuis une tour d’ivoire normative. Car elles ignorent, tout simplement, la réalité d’un français qui s’adapte pour continuer à exister. Mais plus encore, elles témoignent d’un danger bien réel : celui de juger sans connaître. De condamner un usage sans comprendre le contexte qui le fait naître. De parler au nom de la langue sans jamais l’avoir écoutée là où elle se vit autrement. C’est là une forme de glottophobie, cette discrimination subtile qui rejette certains usages linguistiques au seul motif qu’ils s’éloignent d’une norme perçue comme légitime, sans chercher à en comprendre l’ancrage social ou régional.
Et c’est ce français-là, vivant, situé, légitime, que j’ai choisi d’habiter pleinement.
...c’est ce français-là, vivant, situé, légitime, que j’ai choisi d’habiter pleinement.
- Karine McLaren
Université de Moncton
Karine McLaren est professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université de Moncton. Elle dirige le Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), où elle pilote des initiatives pour améliorer l’accès à la justice en français dans les provinces et territoires de common law. Sa recherche doctorale, menée à l’Université Laval, porte sur les fondements et les effets des pratiques d’interprétation judiciaire des lois bilingues au Canada, en lien avec l’égalité linguistique et la cohérence du droit.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre