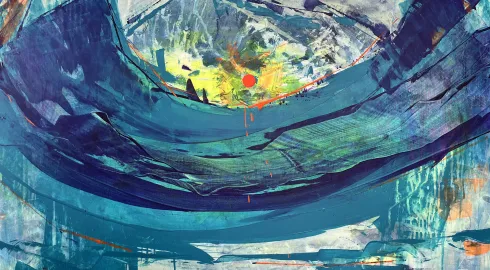Développement durable, croissance verte, Green New Deal ou transition juste, toutes ces propositions parient, de manière plus ou moins explicite, sur la possibilité d’arrêter la catastrophe écologique en cours, sans pour autant renoncer à la course à la croissance économique. Mais, un tel pari peut-il être gagné? Plusieurs études récentes viennent affermir les doutes qu’expriment à ce sujet les « objecteurs de croissance », depuis au moins deux décennies maintenant. Reste à comprendre pourquoi il ne semble décidément pas possible d’obtenir une croissance verte et à indiquer comment il serait possible de se sortir du très mauvais pas dans lequel nous sommes engagés collectivement.

« Une croissance infinie dans un monde fini n’est pas possible! », clament depuis maintenant au moins vingt ans les partisans d’une « décroissance soutenable ». L’argument semble évident, mais n’est toutefois pas aussi imparable que ne l’affirment généralement ses adeptes. Au moins tant que l’astre solaire éclairera notre planète, nos moyens d’existence les plus essentiels resteront en principe reproductibles à l’infini, tels que de l’eau buvable, de l’air respirable, des terres fertiles, des écosystèmes riches et diversifiés, etc... Ces éléments entrent dans la catégorie de ce que nous appelons des « ressources renouvelables ». Par ailleurs, il n’y a pas de limite a priori à l’inventivité humaine, notamment en ce qui concerne justement l’usage des ressources naturelles à notre disposition, sans même parler de celles qui pourraient être trouvées ailleurs qu’ici-bas.
Dès lors, n’est-ce pas possible de croître sur le plan économique, autrement dit de générer une hausse constante du produit intérieur brut (PIB) de nos États-nations, sans dégradation corrélative de la situation de notre espèce sur le plan écologique? C’est cette possibilité que font valoir, de manière plus ou moins explicite selon les cas, les promoteurs d’une croissance verte, d’un développement durable, d’une économie circulaire ou encore d’un Green New Deal. Pour la désigner, un mot savant s’est imposé depuis quelques années : le découplage. Ce terme et la promesse qu’il exprime sont promus aujourd’hui aussi bien dans les rapports de l’OCDE que dans ceux de l’International Ressource Panel (IRP), hébergé par l’ONU.
Découplage, es-tu là?
En théorie, donc, les choses se présentent bien mieux que ne l’affirment les « objecteurs de croissance ». Qu’en est-il en pratique? Des études empiriques de plus en plus nombreuses ont tenté d’apporter des réponses à cette question au cours des précédentes décennies, en mesurant à différentes échelles, dans le temps et dans l’espace, la relation entre la production de biens et de services et la consommation de ressources naturelles (ex : hydrocarbures) ou les « impacts » écologiques de cette production (ex : émissions de CO2). Et, il se trouve que plusieurs travaux de synthèse concernant ces études ont été publiés au cours des derniers mois, ce qui permet de commencer à se forger une opinion assez rigoureuse à propos de cette hypothétique décorrélation entre gains économiques et pertes écologiques1.
En théorie, donc, les choses se présentent bien mieux que ne l’affirment les "objecteurs de croissance". Qu’en est-il en pratique?
Les conclusions de ces revues de littérature sont convergentes et sans équivoque : dans le meilleur des cas, on observe un découplage relatif entre les deux catégories de phénomènes. Cela signifie que par unité de production, la quantité de ressources consommée ou de déchets émis tend à décliner. Mais, en valeur absolue, ces quantités continuent de croître du fait de la hausse continue du PIB mondial. En d’autres termes, les « pertes » sur le plan écologique augmentent moins vite que les « gains » sur le plan économique, mais augmentent tout de même au bout du compte. Or, il n’y aura de « développement durable » que dans la mesure où l’on observera un découplage absolu, c’est-à-dire une situation dans laquelle il y a croissance économique et, au minimum, stabilisation de la situation sur le plan écologique.
Certes, quelques études constatent une telle décorrélation, mais à des échelles de temps et d’espace restreintes, et sur certains aspects du problème seulement. Par exemple, on observe effectivement un découplage absolu entre les émissions de CO2 générées sur le territoire de certains pays occidentaux et le PIB de ces pays. Mais, outre le fait que les émissions de CO2 ne constituent qu’une dimension parmi bien d’autres du désastre écologique en cours, les mesures en question ne tiennent pas compte généralement des « émissions importées », c’est-à-dire des émissions générées lors de la production des biens finis ou semi-finis importés sur ces territoires. Or, faut-il le rappeler, l’effet de serre ne respecte pas les frontières de nos États-nations…
« Croissance verte » ou « développement durable » supposent que soit accompli un découplage non seulement absolu et permanent, mais aussi global, c’est-à-dire à l’échelle planétaire. S’ajoute à ces conditions la nécessité que cette dissociation entre la croissance économique et la dégradation de la situation sur le plan écologique soit suffisamment rapide et marquée pour inverser certaines dynamiques en cours particulièrement préoccupantes telles que le réchauffement global et l’érosion de la biodiversité. Si l’on en croit les synthèses récentes évoquées plus haut, nous en sommes très très loin, notamment en ce qui concerne les baisses d’émissions de CO2 requises pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 (COP 21).
Des limites biophysiques, économiques et politiques
Faut-il en conclure que le découplage est une chimère? [...] Trois raisons au moins permettent cependant de penser que la probabilité qu’un tel espoir se réalise est à peu près nulle.
Faut-il en conclure que le découplage est une chimère? L’avenir reste ouvert et inconnaissable. Il n’existe donc évidemment aucune preuve définitive de l’impossibilité d’une telle décorrélation. Rien n’empêche de caresser l’espoir que dans un proche avenir des innovations techniques « disruptives », combinées à des interventions politiques bien ciblées et bien dosées, finissent par créer les conditions de possibilité d’une vraie « croissance verte ». Trois raisons au moins permettent cependant de penser que la probabilité qu’un tel espoir se réalise est à peu près nulle2.
La quête d’un découplage bute tout d’abord sur des limites ou des contraintes biophysiques. D’une part, nos économies dépendent fortement aujourd’hui de certaines ressources non-renouvelables qui n’ont pas vraiment de substituts, sinon très imparfaits. C’est le cas en premier lieu des hydrocarbures, mais aussi du phosphore, du sable ou encore des métaux rares3. Abandonner l’usage de ces ressources impliquerait très certainement un fort ralentissement voire un arrêt de la croissance économique. Même chose s’il s’agissait d’exploiter nos ressources renouvelables à un rythme permettant qu’elles se renouvellent effectivement, ce qui est de moins en moins le cas4. D’autre part, les gains d’efficacité que nous pouvons obtenir dans l’usage des ressources naturelles ne sont pas illimités. L’ampoule LED, par exemple, convertit d’ores et déjà en lumière 100 % du courant électrique qu’elle reçoit. Par ailleurs, le recyclage parfait n’existe pas et il suppose de mobiliser de l’énergie et de la matière. Quant aux activités de services, outre qu’elles ne se substituent pas aux activités industrielles, qui ont simplement été délocalisées, elles présentent pour leur part une empreinte écologique non négligeable, a fortiori depuis qu’elles prennent appui sur le numérique, dont le développement s’avère très consommateur de ressources énergétiques et matérielles. Comme nous venons de le souligner, des innovations radicales restent possibles bien sûr. Mais, leur déploiement à l’échelle requise réclamera du temps. Or, le temps nous manque justement. Il s’agit là sans doute de la principale limite physique qui s’impose à nous aujourd’hui.
La seconde série de raisons pour lesquelles les découplages observés dans le passé n’ont jamais été que relatifs tient à ce que l’on appelle communément les « effets rebond », terme générique par lequel on désigne la consommation d’une ressource induite, directement ou indirectement, par un moyen permettant de réduire la consommation de cette ressource. C’est ce qui se passe par exemple quand l’acquéreur d’une voiture moins énergivore en profite pour parcourir plus de kilomètres qu’auparavant sans que sa facture d’essence n’augmente (rebond direct) ou pour économiser de l’argent sur ses déplacements quotidiens et s’acheter ainsi un billet d’avion pour Cuba en fin d’année (rebond indirect). Dans un cas comme dans l’autre, la quantité d’essence consommée finalement n’a pas diminué. Elle a même augmenté dans le second cas de figure. Dans nos économies dont le « bon fonctionnement » requiert une hausse constante de la production et de la consommation, de tels effets secondaires sont légions et peuvent entraîner des réactions en chaîne de très grande ampleur, qui s’avèrent tout à fait bénéfiques pour la croissance du PIB, mais désastreuses sur le plan écologique. L’exemple paradigmatique d’un tel phénomène reste celui de la hausse pharamineuse de la consommation de charbon induite par les progrès de la machine à vapeur au cours du XIXe siècle, mise en évidence par le grand économiste britannique Stanley Jevons dans : The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines (1865). Mais on peut évoquer aussi les gains d’efficacité dans le domaine des techniques de réfrigération, qui ont réduit les coûts d’utilisation des appareils utilisant ces techniques (frigos, congélateurs) et stimulé ainsi le développement de l’industrie des produits alimentaires surgelés ou à consommer glacés, ce qui a nécessité une prolifération de machines destinées à maintenir la « chaîne du froid »5.
A défaut de pouvoir s’en remettre aux innovations techniques pour réduire les pertes écologiques occasionnées par l’activité économique, il reste possible en principe de tenter d’orienter celle-ci à l’aide d’interventions politiques reposant notamment sur le principe du pollueur-payeur. Le problème d’une telle stratégie est que, dans nos sociétés caractérisées par une « lutte des places »6 constante, personne évidemment n’a intérêt à payer plus cher aujourd’hui pour la consommation de ressources naturelles qu’il serait raisonnable de protéger ou d’économiser en prévision de l’avenir. Et, compte tenu du fait que nos élus n’ont aucun intérêt de leur côté à contrarier leurs électeurs, il est à peu près certain que leurs décisions en la matière n’iront guère au-delà de mesures essentiellement symboliques. Quand ce n’est pas le cas, ils doivent bien souvent faire marche arrière face aux protestations qu’ils suscitent, comme on l’a vu par exemple au cours de l’été 2018 lorsque les plus gros émetteurs de CO2 canadiens ont contraint le gouvernement Trudeau à réviser à la baisse son projet de taxe sur le carbone.
Produire moins, partager plus, décider ensemble
Que faire alors? Force est d’admettre qu’en continuant à entretenir l’espoir d’un possible découplage dans l’avenir, comme s’y emploient les partisans d’une « croissance verte » ou même d’un « Green New Deal », on justifie aujourd’hui la poursuite de la catastrophe écologique en cours.
Que faire alors? Force est d’admettre qu’en continuant à entretenir l’espoir d’un possible découplage dans l’avenir, comme s’y emploient les partisans d’une « croissance verte » ou même d’un « Green New Deal », on justifie aujourd’hui la poursuite de la catastrophe écologique en cours. La seule manière sûre, donc, de cesser d’aggraver cette catastrophe est de produire moins de biens et de services qu’on ne le fait actuellement et de fixer des limites à la quantité de matière et d’énergie que nous consommons, ainsi qu’à la quantité de déchets que nous générons. En bref, il faut renoncer à la croissance, c’est-à-dire à cette course folle à la production de marchandises dans laquelle l’humanité entière s’est trouvée embarquée progressivement depuis trois siècles, et en mode accéléré depuis les années 1950.
Mais, fixer des limites à la production, donc à la consommation, dans un monde profondément inégalitaire, où un nombre considérable d’êtres humains n’ont pas de quoi vivre dignement, est indéfendable moralement et suicidaire politiquement. Cette décroissance suppose aussi par conséquent que nous partagions bien davantage nos moyens d’existence, à la fois au sein de nos sociétés et entre sociétés, ainsi qu’entre les humains et les autres êtres vivants. Évidemment, l’idée va déplaire à ceux qui ont tout. Cependant, on doit s’attendre à ce que les plus démunis n’acceptent pas en silence de voir leurs rangs grossir et leurs conditions d’existence se dégrader encore plus à cause de mesures visant en principe à « sauver la planète ». Le cas du mouvement des « Gilets jaunes » en France en témoigne. La bonne nouvelle est que, bien davantage que la hausse du PIB, la réduction des inégalités socioéconomiques semble constituer un puissant facteur d’amélioration du bien-être de tout le monde!7
Enfin, si nous voulons rester fidèles à l’idéal de liberté qui est censé être le nôtre, il est essentiel que nous puissions décider ensemble de ces limites à fixer à la production et de la manière de partager ce dont nous avons besoin pour vivre. Cela suppose en premier lieu une démocratisation radicale de nos institutions politiques, dont l’une des conséquences pourraient bien être d’ailleurs la remise en question du modèle de l’État-nation. Mais, nous ne pourrons reconquérir le pouvoir de décider de nos manières de vivre qu’à la condition aussi de nous « débrancher » des vastes systèmes économiques et techniques dont dépendent étroitement nos vies aujourd’hui. Concrètement, il va falloir relocaliser l’essentiel de nos activités de production, sans forcément se couper du reste du monde, et adopter des techniques moins puissantes, mais dont nous aurons la maîtrise, contrairement à ce qu’il se passe actuellement.
La mise en œuvre de ces trois principes n’ira pas sans difficultés. Néanmoins, ils présentent l’avantage d’offrir un contenu clair et cohérent à cette notion bien trop vague de « transition écologique » qui, à l’instar de celle de « développement durable », fait actuellement l’objet de toutes sortes d’interprétations oiseuses.
...nous ne pourrons reconquérir le pouvoir de décider de nos manières de vivre qu’à la condition aussi de nous « débrancher » des vastes systèmes économiques et techniques dont dépendent étroitement nos vies aujourd’hui. Concrètement, il va falloir relocaliser l’essentiel de nos activités de production, sans forcément se couper du reste du monde, et adopter des techniques moins puissantes, mais dont nous aurons la maîtrise, contrairement à ce qu’il se passe actuellement.
- 1Je me réfère ici en particulier aux études suivantes : Jason Hickel et Giorgos Kallis, « Is Green Growth Possible ? », New Political Economy, 2020, 25:4, p. 469-486. ; Timothee Parrique et al., Decoupling Debunked : Evidence and Arguments Against Green Growth as a Sole Strategy for Sustainability, European Environment Bureau, July 2019, 78 p. ; « Decoupling for ecological sustainability: A categorisation and review of research literature », Environmental Science & Policy, Volume 112, October 2020, Pages 236-244.
- 2Ce que confirmait encore, une décennie après les travaux de Tim Jackson sur la question (« Le mythe du découplage », in Prospérité sans croissance, Étopia, 2010), cet article publié en juin dernier : T. Vadén , V. Lähde , A. Majava , P. Järvensivu , T. Toivanen & J.T. Eronen, « Raising the bar: on the type, size and timeline of a ‘successful’ decoupling », Environmental Politics, 2020.
- 3Sur la question énergétique, voir en particulier : Richard Heinberg et David Fridley, Un futur renouvelable. Tracer les contours de la transition énergétique, Montreal, Ecosociete, 2019. Sur l’étonnant problème du sable, voir l’excellent documentaire de Denis Delestrac : « Le sable, enquête sur une disparition » (2013).
- 4Pour une synthèse récente : Aurélien Boutaud, Natacha Gondran, Les limites planétaires, La Découverte, 2020, 126 pages.
- 5Pour une bonne vulgarisation de ces phénomènes : David Owen, Vert paradoxe. Le piège des solutions écoénergétiques, Écosociété, 2013. L’exemple des appareils de réfrigération est développé par Owen.
- 6Même si, dans nos sociétés, certaines personnes ont moins que d’autres à craindre de voir leur position sociale se dégrader, il reste que la mise en concurrence généralisé que nous y subissons rend possible une telle éventualité pour tout le monde. Tocqueville le soulignait déjà dans De la démocratie en Amérique (tome 2, 1840). Mais c’est encore plus vrai depuis le tournant néolibéral des années 1980.
- 7On renvoie ici notamment aux travaux des épidémiologistes Wilkinson et Pickett, et en particulier à leur premier ouvrage : L’égalité, c’est mieux. Pourquoi les écarts de richesse ruinent nos sociétés, Écosociété, 2013.
- Yves-Marie Abraham
HEC Montréal
Yves-Marie Abraham est professeur de sociologie à HEC Montréal, où il enseigne et mène des recherches actuellement sur le thème de la « décroissance soutenable ». Il vient de publier chez Écosociété un ouvrage de synthèse sur le sujet, intitulé Guérir du mal de l’infini (2019)
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre