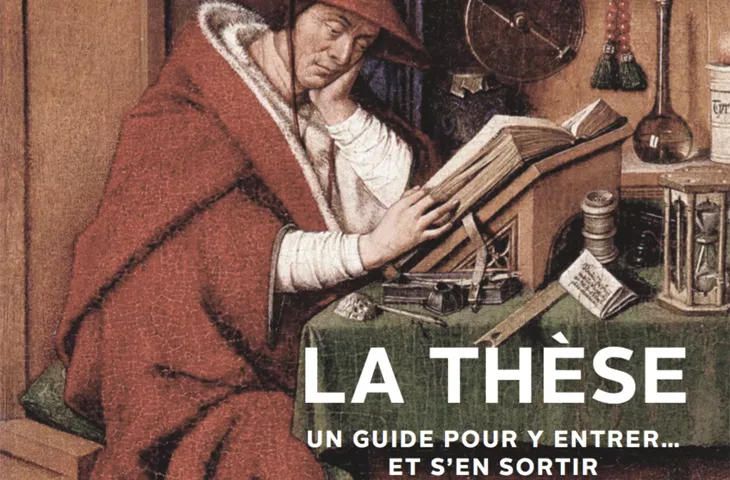Nous avons dirigé l’ouvrage Initiation au travail intellectuel et à la recherche : pratique réflexive de recherche scientifique pour répondre à un besoin fondamental au sein du milieu universitaire : outiller les étudiant·es et chercheur·euses en sciences sociales quant à leur démarche scientifique, dans un contexte de recherche universitaire en métamorphose. Bien que les compétences acquises aux cycles supérieurs soient utiles dans divers milieux professionnels, c’est dans les universités que la recherche scientifique progresse le plus activement les professeur·es et étudiant·es de maîtrise et de doctorat contribuant de manière significative à l’avancement des connaissances.

Texte écrit par Dominique Lametti en collaboration avec Jason Luckerhoff
et Mireille Lalancette de la Chaire de recherche du Québec sur la démocratie,
le vivre-ensemble et les valeurs communes
Le parcours typique d’un·e étudiant·e-chercheur·euse passe, au premier cycle, par une initiation à la méthodologie, suivie d’un mémoire de maîtrise, puis d’une thèse de doctorat, qui elle, doit apporter une contribution originale à la science. Ce processus implique une socialisation aux normes et aux pratiques du milieu scientifique, souvent complexes et implicites. Nous avons voulu que cet ouvrage contribuer à cette socialisation en démystifiant la construction de la connaissance et le milieu académique. L’ouvrage s’adresse ainsi à un public large : étudiant·es du premier cycle aux cycles supérieurs, enseignant·es, chercheur·euses, professionnel·les de l’enseignement supérieur, et étudiants internationaux souhaitant s’initier aux pratiques de recherche au Québec. Le livre Initiation au travail intellectuel et à la recherche vise à combler un vide dans la littérature francophone en proposant une vision transdisciplinaire et réflexive de la recherche.
Les normes et pratiques traditionnelles du milieu scientifique sont présentement en transformation. La vulgarisation scientifique, la mobilisation des connaissances et les recherches partenariales accroissent en importance, promouvant la coconstruction des connaissances et la valorisation des savoirs autres que strictement scientifiques1. Cette croissance exige une adaptation dans l’enseignement des démarches du travail intellectuel, qui ne peut plus simplement se concentrer sur les méthodes de recherche. La recherche scientifique se fait maintenant avec de nombreux acteur·trices et partenaires, même si le cœur demeure encore la production de connaissances scientifiques évaluées par les pairs, dans le cadre de paradigmes épistémologiques reconnus.
Dans l’introduction du livre, nous évoquons les défis, voire parfois de réelles difficultés, rencontrées par les étudiant·es face à ces codes implicites, et nous proposons une posture réflexive comme solution. Cette posture consiste à interroger continuellement ses choix théoriques et méthodologiques, à les adapter au contexte et aux découvertes, et à envisager la recherche comme un processus vivant et évolutif. Nous avions l’impression que les ouvrages méthodologiques traditionnels présentaient la recherche comme une simple boîte à outils. Dans ce livre, nous voulions proposer une approche qui dépasserait les recettes toutes faites et inviterait à une compréhension nuancée du processus scientifique. C’est pour cela que nous avons divisé le livre en trois grandes parties: penser, faire et communiquer la recherche.
Le rôle des professeur·es et les normes du milieu scientifique
Le rôle principal des professeur·es universitaires en recherche est avant tout définit par l’avancement de la connaissance. Il s’agit habituellement d’une connaissance scientifique, c’est-à-dire produite dans une posture épistémologique donnée selon des critères propres à une ou des méthodes de recherche reconnues. Sera considérée comme scientifique une publication qui aura été évaluée par les pairs, souvent dans un processus en double aveugle. Cela signifie que le texte anonymisé est envoyé pour évaluation à deux professeur·es spécialistes du champ. Le retour auprès des auteur·trices du texte se fait par la direction de la revue ou de la publication – qui ajoute également des commentaires – sans mentionner le nom des évaluateurs. Finalement, une révision linguistique professionnelle du texte est habituellement réalisée.
La recherche scientifique se fait au sein d’un paradigme, comme l’a démontré le philosophe américain Thomas Kuhn, dans son célèbre ouvrage de 1962, The Structure of Scientific Revolutions. Ce paradigme peut être considéré comme une activité sociale selon la définition de Kuhn : ensemble de croyances, de valeurs et de techniques qui sont partagées par les membres d’une communauté scientifique au cours d’une période de consensus théorique. Apprendre à faire de la science, c’est aussi être socialisé aux manières d’une communauté de recherche. La personne candidate à la maîtrise ou au doctorat qui ne connaît pas les codes aura de la difficulté à comprendre les textes à lire, mais aussi les façons de faire.
[Selon le philosophe américain Thomas Kuhn, le paradigme au sein d'un champ de recherche peut être définit comme] un ensemble de croyances, de valeurs et de techniques qui sont partagées par les membres d’une communauté scientifique au cours d’une période de consensus théorique.
Dans ce contexte, cet ouvrage apparaît donc comme une boussole les accompagnant du baccalauréat jusqu’au doctorat. Il propose une approche progressive et structurée du processus de recherche, adapté aux normes en évolution du milieu scientifique. De plus, l’ouvrage s’inscrit comme un outil utile à perpétuité, grâce à la place accordée à la pratique réflexive. En effet, il ne se limite pas à transmettre des méthodes de recherche contemporaines, il encourage une réflexion critique des gestes scientifiques. Les enjeux de nature épistémologiques, méthodologiques et éthiques, liés à la production des savoirs y trouvent en bel éclairage
Notre livre réconcilie notamment les approches qualitatives, quantitatives et mixtes en présentant leurs tenants et aboutissants. Plus encore, plusieurs chapitres abordent des aspects de la recherche souvent négligés dans d’autres ouvrages. Pensons ici à la problématique, à ce qui distingue concepts, théories et paradigmes, aux revues systématiques, à la gestion des données, à la netnographie, à la coconstruction de devis de recherche et à la mobilisation des connaissances.
L'ouvrage apparaît ainsi comme une ressource pédagogique complète. Chaque chapitre suit une structure commune (explications, exemples, exercices), facilitant sont utilisation en contexte d’enseignement. Cela en fait un outil tant pour les cours universitaires que pour les formations en recherche, diversité disciplinaire et méthodologique à l’appui. Plus de 40 chercheur·euses ont contribué à l’ouvrage, ce qui permet de couvrir un large éventail de méthodes (qualitatives, quantitatives, mixtes), de techniques (netnographie, entrevue, observation), et de thématiques (problématisation, gestion des données, éthique).
Conclusion
En somme, ce livre vise à démystifier le travail intellectuel et à rendre la recherche accessible tout en la situant dans une perspective critique et réflexive. Cette posture offre un regard sur l’ensemble du processus scientifique, de l’interrogation initiale à la en passant par la formulation des questions de recherche, les choix des méthodes et la diffusion des résultats dans des colloques ou conférences. Nous considérons que cet ouvrage comble un besoin important quant aux manières de penser, de faire et de communiquer ses recherches. Au-delà d’un guide pratique, il aspire à former des chercheur·euses capables de porter un regard critique sur les questionnements scientifiques et les choix méthodologiques.
- 1
Outre les connaissances issues de la recherche scientifique, il est possible d’intégrer dans un travail de recherche divers savoirs non scientifiques qui enrichissent l’analyse. Les savoirs expérientiels, issus du vécu des personnes directement concernées, permettent de saisir la dimension subjective et incarnée des phénomènes étudiés. Les savoirs pratiques ou professionnels, développés dans l’exercice d’un métier ou d’une fonction, offrent une compréhension fine des logiques d’action et des contraintes du terrain. De leur côté, les savoirs communautaires ou citoyens, produits au sein de groupes et d’organisations locales, ancrent la réflexion dans des contextes sociaux et territoriaux spécifiques. On peut également mobiliser les savoirs traditionnels et autochtones, transmis oralement entre générations, qui reposent sur des visions du monde et des rapports au vivant distincts des cadres scientifiques occidentaux. Enfin, les savoirs culturels et médiatiques, véhiculés par les récits, les représentations symboliques et les discours publics, révèlent les imaginaires collectifs à l’œuvre dans la société. Ensemble, ces formes de savoirs contribuent à diversifier les perspectives, à contextualiser les enjeux et à reconnaître la pluralité des manières de produire et de transmettre des connaissances.
- Dominique Lametti
Chaire de recherche du Québec sur la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes
Diplômée en science politique à McGill, Dominique Lametti a joint l’équipe de la Chaire de recherche du Québec sur la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes en juin 2025 à titre de médiatrice scientifique. Elle y consacre son talent à vulgariser les travaux des 26 cochercheurs et à présenter la recherche sous un angle nouveau et stimulant à travers les médias sociaux de la Chaire.
- Mireille Lalancette
UQTR
Mireille Lalancette est professeure titulaire de communication politique à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Cotitulaire de la Chaire de recherche du Québec sur la démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes au Québec (avec Éric Bélanger, McGill). Elle est membre du Collège des nouveaux chercheurs, artistes et scientifiques de la Société royale du Canada (SRC), du Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD) et du Groupe de recherche en communication politique (GRCP), dont elle est chercheuse principale depuis le 1er juillet 2024. Elle est aussi cochercheuse à la Chaire Jarislowsky sur la confiance et le leadership politique de l’UQTR. Elle offre aussi des formations et conférences grand public en lien avec ses travaux de recherche. Son expertise est régulièrement sollicitée par des médias tels Le Devoir, La Presse, le New York Times, CBC ou Radio-Canada afin d’analyser des phénomènes et des questions politiques.
- Jason Luckerhoff
UQTR
Formé en communication (B. A., M. A. et Ph. D.), en administration publique (DESS et MAP), en droit (programme court) et en stratégie (formations pour gestionnaires), Jason Luckerhoff est professeur titulaire en communication à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il est en outre administrateur agréé (Adm. A.) et conseiller en ressources humaines agréé (CRHA). Il dirige actuellement la revue Minorités linguistiques et société, après avoir fondé les revues Approches inductives et Enjeux et société. Jason Luckerhoff a participé à la création de l’Université de l’Ontario français (UOF). Il est chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l’enseignement supérieur (LIRES) et aussi chercheur à la Chaire de recherche du Québec sur la démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes au Québec.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre