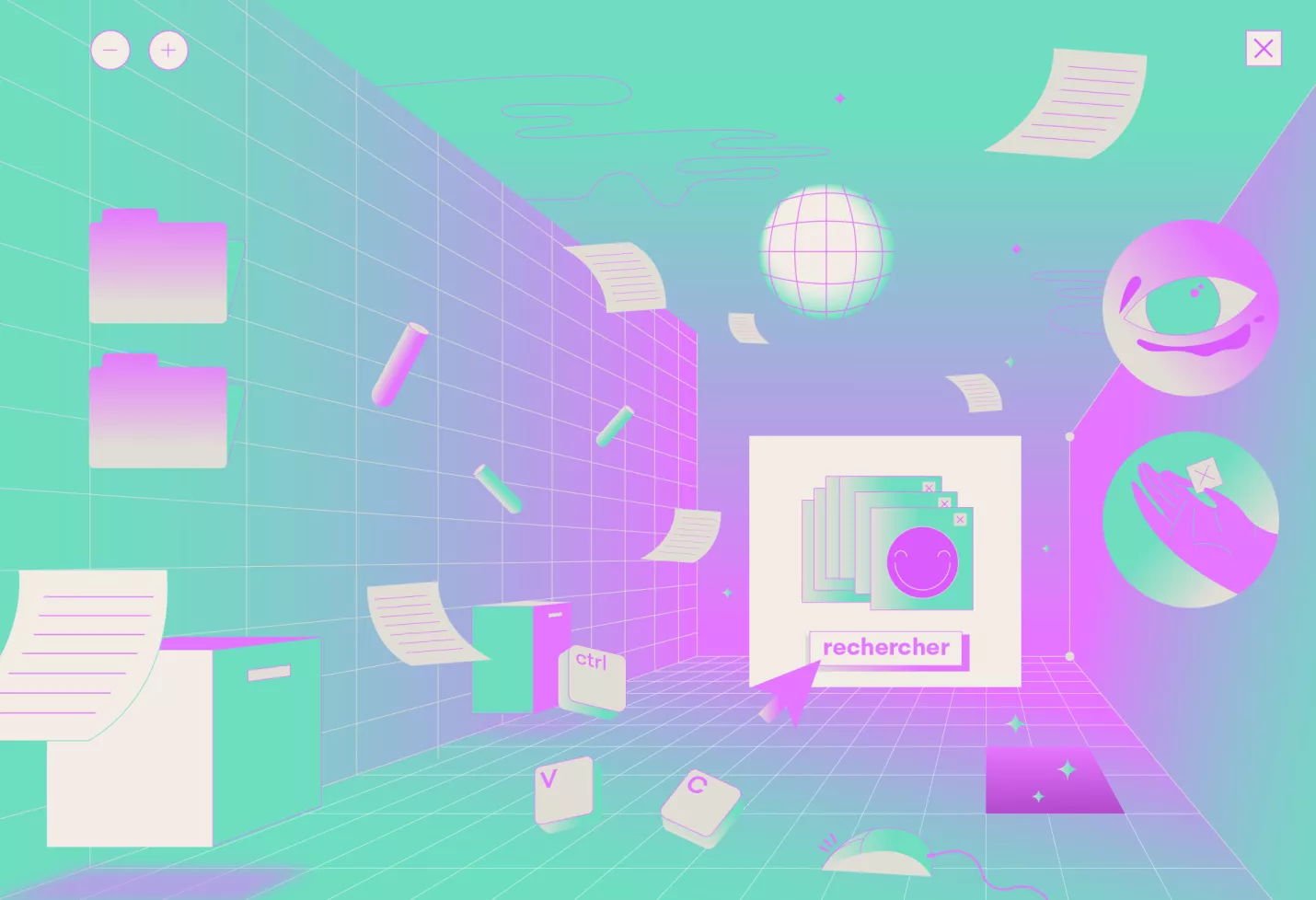Près de trois ans après la mise à disposition publique de ChatGPT, le ministère de l’Enseignement supérieur reconnaît que l’IA générative est désormais une composante essentielle du paysage collégial et universitaire au Québec et qu'il demeure impossible de garantir qu'elle ne remplacera jamais certaines tâches humaines.
En août dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a publié le cadre de référence élaboré par l’instance de concertation nationale sur l’intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur. Cette instance, créée en 2024, répondait à une recommandation du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et de la Commission de l’éthique en science et en technologie (CEST) formulée dans leur rapport intitulé Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques (CSE et CEST, 2024). Ce rapport avait été annoncé à la suite de la journée sur l’intelligence artificielle en enseignement supérieur organisée au printemps 2023.
L’un des mandats de l’instance consistait à développer une vision commune et à définir des principes directeurs pour l’utilisation responsable, éthique, durable et sécuritaire de l’IA générative dans l’enseignement supérieur. Ce mandat s’inscrivait dans le contexte de la mise à disposition publique de ChatGPT à la fin de 2022, qui a soulevé de nombreux enjeux spécifiques dans le secteur de l’enseignement supérieur.
Près de trois ans après le lancement de l'agent conversationnel, le cadre de référence reconnaît que cette technologie est désormais une composante incontournable du paysage collégial et universitaire au Québec et qu'il demeure impossible de garantir qu'elle ne remplacera jamais certaines tâches humaines. Sur cette base, il propose la vision suivante :
« Fédérer la communauté de l’enseignement supérieur autour de la démocratisation de l’IA afin d’en promouvoir une utilisation efficace, critique, responsable, cohérente et éthique, d’assurer la qualité de la formation pour tous et de viser l’excellence en recherche, tout en respectant l’autonomie des établissements, l’autonomie professionnelle et la liberté académique. »
Près de trois ans après le lancement de l'agent conversationnel [ChatGPT], le cadre de référence reconnaît que cette technologie est désormais une composante incontournable du paysage collégial et universitaire au Québec et qu'il demeure impossible de garantir qu'elle ne remplacera jamais certaines tâches humaines.
Une utilisation éthique et légale
Alors que certains États et établissements d'enseignement supérieur ont interdit ChatGPT (UNESCO, 2023), le MES adopte une stratégie opposée : outiller les établissements afin qu’ils puissent faire « des choix éclairés » à l’égard de l’IA générative et développer « une saine gouvernance1 » en la matière. Ainsi, dans le guide qui accompagne le cadre de référence, il suggère aux établissements « de veiller à optimiser les effets bénéfiques de l’IA, tout en réduisant les risques qui y sont associés et ses impacts indésirables; de porter une forte attention aux différents enjeux éthiques liés au déploiement de l’IA, comme la responsabilité des utilisateurs, la fiabilité des données, l’explicabilité des décisions, la transparence (le recours à l’IA ne se fait pas en secret), etc.; de prendre des mesures concrètes pour favoriser l’utilisation efficace et responsable de l’IA au sein de la communauté de l’ES ».
À ces lignes directrices s’ajoutent bien entendu les obligations légales de tout un chacun en matière de cybersécurité, de protection des renseignements personnels et de respect de la propriété intellectuelle, telles que prévues par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (la LGGRI) et la loi 25. Ces balises obligent notamment à considérer comme public tout renseignement transmis à un outil d’IA générative, en l’absence d’une connaissance approfondie des conditions d’utilisation de l’outil et de ses différentes mises à jour.
Alors que certains États et établissements d'enseignement supérieur ont interdit ChatGPT, le MES adopte une stratégie opposée : outiller les établissements afin qu’ils puissent faire « des choix éclairés » à l’égard de l’IA générative et développer « une saine gouvernance » en la matière.
Comme nul ne peut se défaire de ses responsabilités en prétextant ne pas connaître ses obligations, il est précisé que « la formation à l’IA concerne l’ensemble des acteurs de l’ES ». Toutes les parties prenantes doivent ainsi développer une littératie de l’IA générative, c’est-à-dire « une bonne compréhension de son fonctionnement, de son potentiel et des risques liés à son utilisation ». Un aperçu de l’ensemble des formations actuellement disponibles dans les établissements et leurs communautés devrait être disponible d’ici la fin de 2026. Les outils d’IA générative ne se limitant toutefois pas aux usages interactifs (ils peuvent également être intégrés de manière discrète dans les environnements numériques), il sera tout aussi important de sensibiliser les communautés aux enjeux liés aux utilisations moins « évidentes ».
Priorité aux instances existantes
À ce sujet, le MES est clair : pas question d’interférer avec l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur, ni de se substituer aux instances de gouvernance déjà en place dans certains établissements.
« En matière de gouvernance d’IA, il n’y a pas de solution unique » et « chaque établissement devrait pouvoir prendre des décisions concernant l’intégration de l’IA générative selon des approches adaptées à ses réalités, développer ses propres guides et balises pour une utilisation efficace et éthique de celle-ci, et actualiser ses politiques institutionnelles et ses programmes d’études dans un esprit d’expérimentation et d’innovation ».
Dans ce contexte, le rôle du MES se limite à formuler des orientations et des principes directeurs pouvant encadrer l’intégration de l’IA générative en enseignement supérieur. Ces principes directeurs, les établissements sont libres de les adopter ou non dans l’élaboration ou la révision de leurs propres balises.
[...] le rôle du MES se limite à formuler des orientations et des principes directeurs pouvant encadrer l’intégration de l’IA générative en enseignement supérieur. Ces principes directeurs, les établissements sont libres de les adopter ou non dans l’élaboration ou la révision de leurs propres balises.
Les établissements sont surtout invités à susciter l’adhésion des corps professoraux, des personnes étudiantes et du personnel administratif en valorisant leur propre expertise en la matière. « Chaque département devrait ainsi pouvoir contribuer à l’élaboration de ses orientations et balises ainsi qu’à la vision commune de l’IA qui prévaudra au sein de l’établissement qui l’héberge. » Ici encore, le MES devrait rendre disponible d’ici la fin de 2026 une boîte à outils pour mutualiser certaines ressources entre les établissements et ainsi éviter la duplication inutile des efforts. Si cette approche décentralisée coïncide avec celle préconisée par l’UNESCO — qui a déjà créé et rendu disponibles plusieurs guides et documents de référence —, on peut toutefois se demander dans quel cas les départements ont les connaissances et les compétences requises pour juger de l’utilisation appropriée et durable de ces technologies, ainsi que de leurs incidences sur les droits humains, la démocratie, la justice sociale et l’environnement.
Alors qu’à l’échelle de l’Europe et de l’Amérique du Nord, 70 % des établissements d’enseignement supérieur accueillant une Chaire UNESCO ou faisant partie d’un réseau UNITWIN auraient déjà élaboré leurs propres balises en matière d’IA générative ou seraient en train de les élaborer (UNESCO, 2025), celles et ceux qui parmi nous espéraient une réglementation plus claire peuvent encore attendre.
L’excellence en recherche
Pendant ce temps, les usages continuent de progresser et les technologies, d’évoluer. La récente enquête de l’UNESCO (2025) révèle que 90 % des personnes interrogées utilisent des outils d’IA générative « dans le cadre de leur travail, le plus souvent pour des tâches de recherche ou d’écriture ». Au Québec, les enquêtes internes menées au sein de différents établissements d’enseignement supérieur montrent que les personnes étudiantes apprécient particulièrement ces outils du fait qu’ils leur permettent de formuler des requêtes en langage naturel et d’alléger certaines tâches apparemment fastidieuses comme la recherche d’information.
Le cadre de référence présenté par le MES s’applique indistinctement aux volets de la formation, de la recherche et de l’administration. Nous constatons que, bien que le MES reconnaisse que les outils d’IA générative ont le potentiel de transformer profondément « la manière de faire de la recherche », y compris « les processus utilisés pour produire des contenus scientifiques », très peu d’attention a été accordée aux cas d’utilisation afférents2.
Nous aurions certainement pu espérer qu’une attention plus grande soit portée par le MES à la manière dont les outils d’IA générative ont le potentiel de transformer les pratiques de recherche d’information en tant que telles et donc, la manière dont les contenus scientifiques sont et seront découverts. Quelle prise les établissements ont ou auront-ils sur ces pratiques? Quels enjeux ces usages soulèvent-ils pour la découvrabilité des contenus scientifiques en français? L’usage de tels outils est-il compatible avec l’excellence en recherche? Est-il réellement souhaitable d’y recourir pour gagner du temps si cela conduit à une surproduction de contenus peu fiables, erronés ou incomplets, notamment à cause des « hallucinations » et du manque d'exhaustivité associés à leur utilisation?
Dans les faits, si l’on vise l’excellence en recherche comme le soutient le MES, on admettra que celle-ci ne peut être compatible avec l’utilisation de bibliographies générées en quelques secondes par des outils d’IA générative qui ne garantissent ni la pertinence ni la véracité des informations produites. Elle demande au contraire de prendre le temps de lire les articles que l’on cite, sous peine de diminuer l'esprit critique et la capacité d'analyse nécessaire pour évaluer les informations et préserver l'indépendance intellectuelle. Préserver ces principes fondamentaux de la science devrait faire partie de l’agenda de tout ministère de l’Enseignement supérieur.
Nous aurions certainement pu espérer qu’une attention plus grande soit portée par le MES à la manière dont les outils d’IA générative ont le potentiel de transformer les pratiques de recherche d’information en tant que telles et donc, la manière dont les contenus scientifiques sont et seront découverts.
Ces travaux sont soutenus par le Fonds de recherche du Québec grâce au soutien financier du ministère de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du programme Actions concertées.
- 1
Dans le contexte des établissements d’enseignement supérieur, la gouvernance de l’IA générative désigne l’ensemble des règles et des processus institutionnels qui encadrent le développement et le déploiement des systèmes d’IA générative. Elle vise à garantir l’efficacité de ces systèmes ainsi que leur conformité aux valeurs, aux objectifs pédagogiques et aux normes éthiques de l’établissement.
- 2
Ceux-ci ne concernent que la synthèse automatisée d’écrits scientifiques, la génération d’hypothèses, la détection de corrélations dans des corpus massifs, la génération de données synthétiques pour pallier le manque de données réelles, l’analyse de grands ensembles de données, l’extraction d’informations structurées, l’annotation automatique, l’extraction de modèles difficilement accessibles à l’humain, le soutien à l’évaluation par les pairs, la prédiction de la robustesse et de la réplicabilité des études et la détection des biais dans les décisions d’évaluation.
- Julie Francoeur, Gaëlle Laperrière, Julien Vallières, Émilie Paquin et Marie-Jean Meurs
Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre