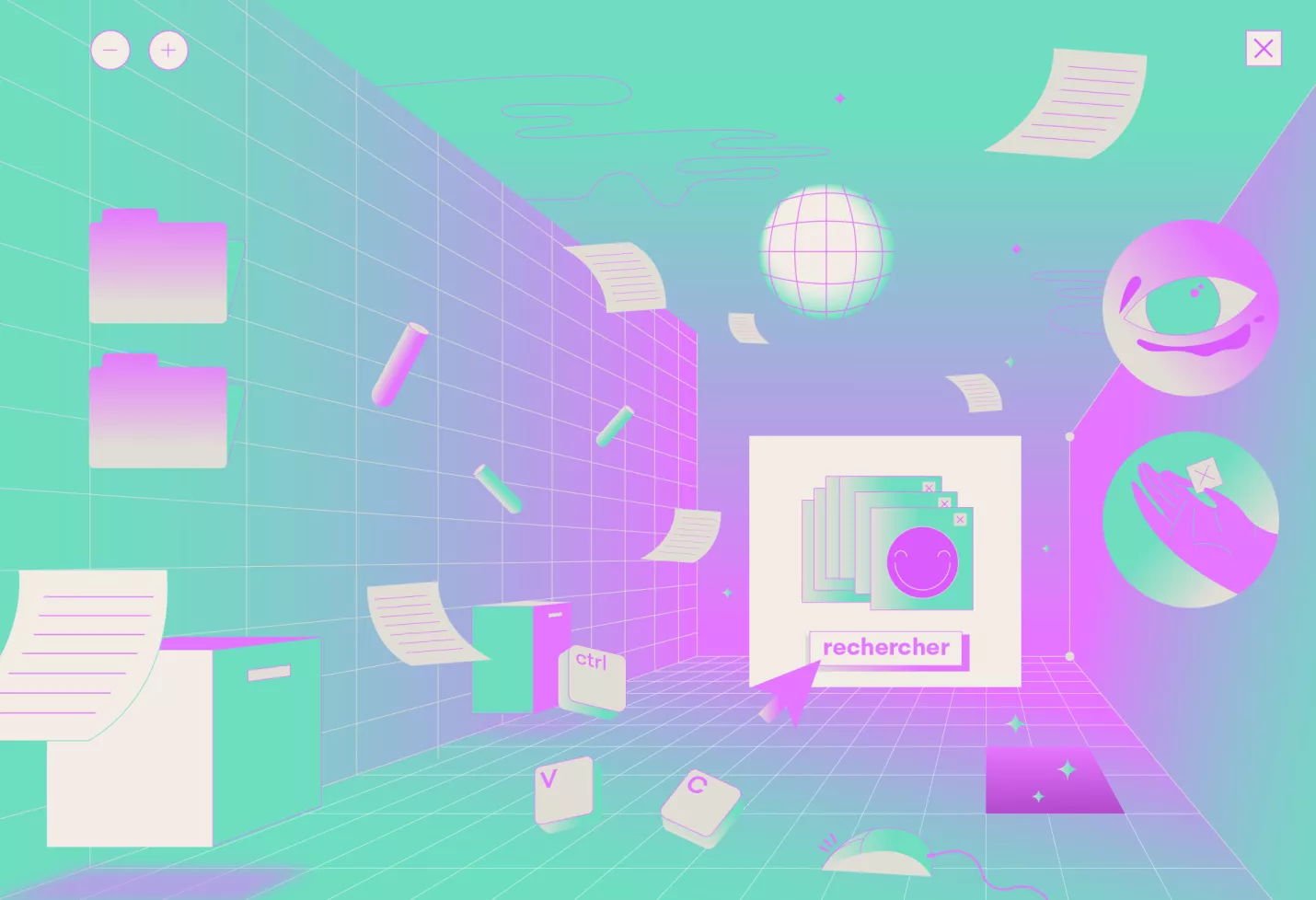La littérature révèle l'existence d'une perception répandue parmi les chercheur·euses d'une obligation de publier en anglais pour assurer la progression de leur carrière. Mais d’où vient une telle perception?
L'expression « Publish or Perish » et le phénomène qu'elle décrit trouvent leurs origines dans l'université américaine du milieu du 20e siècle (Garfield, 1996). L'expression elle-même apparaît pour la première fois en 1942 avec la parution de l'ouvrage The Academic Man: A Study in the Sociology of a Profession, qui décrit la pression exercée sur les universitaires pour publier. Le concept s'institutionnalise progressivement après la Seconde Guerre mondiale, porté par l'expansion du système universitaire américain.
La suite de cette évolution est bien documentée. La métrification de l'évaluation scientifique s'accélère dans les décennies suivantes avec la première édition (1963) du Science Citation Index, rapidement suivie par l'émergence du facteur d'impact des revues au milieu des années 1970 et de l’indice h des chercheur·euses dans les années 2000. Cette quantification progressive de l'impact scientifique engendre des effets pervers qui dépassent largement les frontières des États-Unis : l'inflation du nombre de publications, le développement d'un marché éditorial qui favorise structurellement l'anglais, le détournement de l’étude de sujets locaux; autant de phénomènes qui conduisent les chercheur·euses à privilégier la publication en anglais, y compris lorsque leurs travaux pourraient avoir davantage d'impact dans leur langue nationale.
Cette quantification progressive de l'impact scientifique engendre des effets pervers qui dépassent largement les frontières des États-Unis : l'inflation du nombre de publications, le développement d'un marché éditorial qui favorise structurellement l'anglais, le détournement de l’étude de sujets locaux; autant de phénomènes qui conduisent les chercheur·euses à privilégier la publication en anglais, y compris lorsque leurs travaux pourraient avoir davantage d'impact dans leur langue nationale.
D'abord adopté pragmatiquement pour maximiser la diffusion des résultats de recherche, l'anglais a progressivement acquis une dimension symbolique qui en a fait un marqueur d'excellence et un gage de légitimité. Ce glissement de la fonction instrumentale de l’anglais vers sa valeur symbolique serait devenu particulièrement manifeste dans les pratiques d'évaluation de la recherche au sein des universités. Par exemple, en Chine, la diplomation doctorale (Quan et al., 2023) et les promotions (Shu et al., 2020) sont essentiellement déterminées par la publication en anglais au sein des revues internationales.
Face à cette problématique et à l’importance qu’elle revêt pour l'avenir de la recherche francophone au Québec, la Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français a entrepris d'établir l'origine de cette perception si répandue dans de nombreuses disciplines. Existe-t-il une obligation formelle de publier dans une langue spécifique dans nos universités? Les critères d'évaluation de la recherche des établissements universitaires francophones privilégient-ils explicitement certaines revues ou bases de données anglophones? Intègrent-ils le facteur d'impact ou l’indice h?
Une absence d'obligation formelle
Premier constat : il n'existe aucune mesure contraignante en matière de langue de publication de la recherche dans nos universités.
Les politiques linguistiques institutionnelles, qui découlent de la Charte de la langue française (chapitre VIII.1), et les conventions collectives des corps professoraux, qui définissent concrètement les conditions d'exercice professionnel et peuvent comporter des exigences ou des incitatifs liés à la langue de publication, reposent essentiellement sur des encouragements et des énoncés de principes privilégiant une approche fondée sur la responsabilisation des communautés de recherche.
Politiques linguistiques
Contrairement aux langues d'enseignement et de travail, qui font l'objet de prescriptions explicites dans les politiques linguistiques institutionnelles, le vocabulaire employé pour la langue de publication de la recherche demeure délibérément non prescriptif. Cette approche reflète le souci des institutions de préserver la liberté académique garantie par la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire.
Dans les politiques linguistiques, l’ensemble des universités se contente ainsi d’« encourager », de « soutenir », de « promouvoir », de « préconiser », de « reconnaître l'importance de » ou d’« inciter », voire d’« inciter fortement » la publication des résultats de recherche en français. Cette rhétorique incitative, dépourvue de caractère contraignant, maintient de facto le choix de la langue de publication à la discrétion des professeur·es, dont les décisions demeurent principalement guidées par les critères disciplinaires.
Contrairement aux langues d'enseignement et de travail, qui font l'objet de prescriptions explicites dans les politiques linguistiques institutionnelles, le vocabulaire employé pour la langue de publication de la recherche demeure délibérément non prescriptif.
La référence récurrente à « la langue appropriée aux disciplines », aux « réseaux scientifiques », aux « auditoires » ou aux « lectorats » légitime l'usage de l'anglais lorsque celui-ci constitue la norme dans le domaine concerné, cette langue dominant les revues prestigieuses et les réseaux de recherche internationaux dans la plupart des disciplines (Pradier, Céspedes et Larivière, 2025). De même, l'encouragement à accompagner les publications ou les demandes de financement de résumés substantiels en français suggère implicitement que les publications sont rédigées dans une autre langue, en l'occurrence l'anglais1.
Conventions collectives des corps professoraux
Négociées entre les syndicats de professeur·es et les directions d’établissement, les conventions collectives renforcent cette absence d’obligation formelle en accordant une flexibilité maximale aux départements dans l’établissement des critères d’évaluation de la composante « recherche » de la tâche professorale.
Cette approche décentralisée facilite l'adoption de critères d'évaluation alignés sur les pratiques disciplinaires internationales, structurellement favorables à la publication en anglais.
Formation à la recherche
Les règlements des études aux cycles supérieurs confirment également cette logique d'absence d'obligation formelle en instaurant un régime d'autorisation qui facilite l'usage de l'anglais pour les travaux de recherche étudiants (mémoires et thèses). Bien que ces règlements stipulent que les travaux de recherche doivent être rédigés et soutenus en français, ils prévoient systématiquement des mécanismes d'exception qui, dans la pratique, normalisent l'usage de l'anglais.
Cette logique d’accommodement se retrouve aussi dans les dispositions relatives aux mémoires et thèses par articles. Plusieurs établissements autorisent cette modalité, le travail devant alors s’accompagner d’un résumé, ou d’une introduction et conclusion générales en français, ce qui suggère encore une fois que les articles sont rédigés en anglais.
Bien que ces règlements stipulent que les travaux de recherche doivent être rédigés et soutenus en français, ils prévoient systématiquement des mécanismes d'exception qui, dans la pratique, normalisent l'usage de l'anglais.
Quelques établissements vont plus loin en prévoyant des obligations de rédaction en anglais lorsque la discipline d’études de la personne étudiante ou son sujet de recherche l’exigent. C’est le cas de l’Université de Montréal, où la personne doyenne peut obliger une personne étudiante à présenter son travail dans une autre langue que le français « lorsqu’[elle] estime que les études de ce[tte] derni[ère] dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l’exigent » (2025, section XXIV-88). À l’UQTR, cette obligation peut émaner du comité de programme, sur recommandation de la direction de recherche, « lorsque le sujet de recherche l’exige » (2025, p. 77). L’UQO et l’UQAT précisent que « lorsqu’un programme est offert dans une langue autre que le français, la langue de rédaction est la même que celle du programme » (UQO, 2022, p. 9 ; UQAT, 2025, p. 31).
Que faut-il en comprendre?
L’analyse des orientations institutionnelles et des contraintes réglementaires relatives aux choix linguistiques des chercheur·euses au sein des établissements universitaires francophones du Québec révèle qu’aucun dispositif, à l’exception des obligations de rédaction en anglais prévues par certains établissements lorsque la discipline d'études ou le sujet de recherche de la personne étudiante l'exigent, n’oblige formellement les chercheur·euses à publier en anglais, pas plus qu’il ne les contraint à privilégier le français.
La pression à publier en anglais ne s'exerce donc pas au niveau institutionnel, comme c'est le cas ailleurs dans le monde, mais trouve sa source dans les pratiques départementales, elles-mêmes déterminées par les exigences disciplinaires. Cette pression émane paradoxalement des chercheurs eux-mêmes, qui privilégient certaines revues anglophones et leur facteur d'impact.
[...] aucun dispositif, à l’exception des obligations de rédaction en anglais prévues par certains établissements lorsque la discipline d'études ou le sujet de recherche de la personne étudiante l'exigent, n’oblige formellement les chercheur·euses à publier en anglais, pas plus qu’il ne les contraint à privilégier le français. [...] Cette pression émane paradoxalement des chercheurs eux-mêmes, qui privilégient certaines revues anglophones et leur facteur d'impact.
L'ironie de cette situation tient au fait que ces indicateurs bibliométriques, initialement développés pour objectiver l'évaluation scientifique et contourner les limites de l'évaluation par les pairs, sont aujourd'hui adoptés par ces mêmes pairs qui possèdent pourtant l'expertise disciplinaire nécessaire pour juger de la qualité des travaux. Cette délégation de l'expertise vers des métriques standardisées nourrit la logique du Publish or Perish et contribue à l'inflation du nombre de publications en anglais au détriment de leur pertinence ou de leur découvrabilité locale.
Ce constat suggère une prise de conscience nécessaire de la part de nos communautés de recherche quant à l'origine réelle des pressions linguistiques qu'elles subissent.
Ces travaux sont soutenus par le Fonds de recherche du Québec grâce au soutien financier du ministère de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du programme Actions concertées.
- 1
Quelques établissements énoncent des recommandations concrètes vis-à-vis du français : développement de terminologies scientifiques, usage du français pour les demandes de financement, transfert de connaissances en français et participation aux comités éditoriaux francophones. Cependant, le caractère facultatif de ces recommandations en réduit considérablement la portée.
- Mariane Rail, Julie Francoeur, Émilie Paquin et Vincent Larivière
Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre