« Il faudrait d’abord cesser d’imiter ce qui se fait ailleurs avec des moyens infiniment plus considérables. […]
Aux petits reviennent les ressources de l’astuce où de nobles paroles ont des chances de s’attacher
à ces questions plus profondes auxquelles ne s’attardent guère les grandes manœuvres et les grands équipages ».
Fernand Dumont, La vigile du Québec, Montréal, HMH, 1971, p. 97.
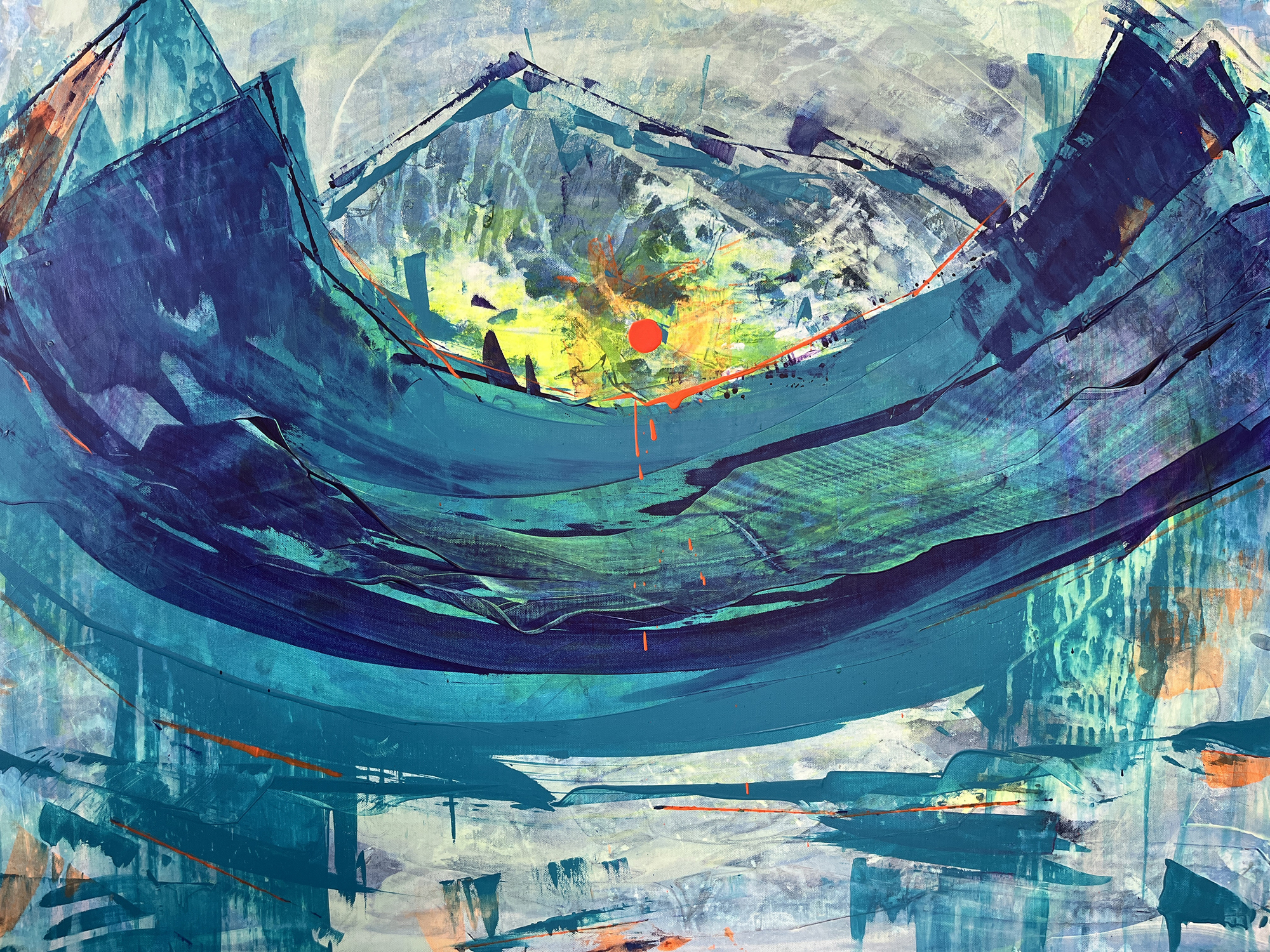
Depuis quelques années, l’université doit répondre aux profondes transformations qui marquent nos sociétés : crise climatique, polarisation sociale et politique, montée des inégalités, pluralisme croissant, révolution numérique, postvérité, érosion démocratique, crise des finances publiques… Ces défis impactent tous les secteurs de l’enseignement supérieur – allant de la recherche à la gouvernance, en passant par les stratégies de recrutement, la pédagogie et les modes de financement – obligeant ainsi l’université à réinterroger sa mission et ses principes fondamentaux.
Au Québec, ce chantier est déjà bien amorcé, entre autres grâce aux réflexions menées en 2017 dans le cadre du 50e anniversaire du réseau de l’Université du Québec1 et en 2020 par un groupe de travail présidé par le scientifique en chef du Québec2, initiatives auxquelles s’est ajoutée la publication du rapport de la Commission Cloutier sur la liberté académique3 et la sortie de divers ouvrages-bilan sur l’université au Québec4. Toutefois, les universités en région, qui incarnent certains des grands principes instituants du projet universitaire québécois comme l’accessibilité, l’égalité et l’inclusion, ainsi que le développement régional, ont reçu une attention somme toute limitée dans cette discussion. À tout le moins, rarement sont-elles appréhendées comme des institutions à part entière, avec la particularité de leur mission et de leurs défis.
Pourtant, les enjeux propres aux universités en région apparaissent peut-être plus visibles que jamais, alors qu’elles se trouvent singulièrement fragilisées par l’internationalisation de l’enseignement supérieur et le déploiement accéléré du numérique, mais, aussi, par les défis propres aux régions elles-mêmes, qu’il s’agisse de la transition industrielle et énergétique, des contrecoups de la guerre tarifaire avec les États-Unis ou encore, du déclin démographique. À ce compte, les établissements universitaires en région ne sont-ils pas, comme le souligne Martin Maltais dans le présent dossier, les « vigies les plus précieuses », celles qui « annoncent, expérimentent et parfois anticipent les mutations qui redéfiniront l’avenir de toutes les universités »? Au-delà de ces grands enjeux, rappelons que ces établissements se heurtent aussi à une série de défis locaux qui leur sont propres : dispersion territoriale, rétention des étudiants de première génération, croissance des populations étudiantes autochtones, essor du recrutement international, faiblesse relative des effectifs ou encore compétitivité défavorable induite par les formules actuelles de financement des universités et de la recherche.
Ces défis évoquent, du même souffle, la spécificité du projet de l’université en région québécoise et de ses intentions fondamentales. Pensons notamment ici à son articulation à un réseau scolaire et d’enseignement supérieur national, territorial et public, à sa mission d’accessibilité au savoir ou encore à sa double vocation, à la fois communautaire (celle de l’université régionale, de laquelle on attend un rayonnement et une offre de service public) et généraliste (celle de l’université en région, qui doit ouvrir sur l’universel de la connaissance). Si leur rôle est crucial pour la vitalité des communautés locales, elles constituent aussi de véritables interfaces de la diversité territoriale, intellectuelle et scientifique du Québec.
Si [le rôle des universités en région] est crucial pour la vitalité des communautés locales, elles constituent aussi de véritables interfaces de la diversité territoriale, intellectuelle et scientifique du Québec.
Ces constats nous ont poussé à entreprendre une réflexion synthétique et actualisée sur l’institution universitaire en milieu régional au Québec et ailleurs, au regard de ce qu’elle fut et de ce qu’elle pourrait devenir. Car à titre d’universitaires œuvrant dans ces institutions, il est de notre conviction que ce n’est pas par de quelconques stratégies de substitution ou par simple mimétisme des grandes institutions d’enseignement que ces établissements s’actualiseront. C’est plutôt, nous semble-t-il, en réapprivoisant leurs fondements, leur spécificité et leurs raisons fortes qu’elles assureront leur pertinence en même temps que leur pérennité. Telle fut l’ambition d’un vaste colloque que nous avons organisé en mars 2025 au campus de l’UQAR à Lévis, et qui a rassemblé une grande diversité d’acteurs des milieux de la recherche et de l’enseignement. Afin de prolonger et de pérenniser ces réflexions, nous avons proposé la présente collaboration au Magazine de l’Acfas. Le lecteur y découvrira une pluralité d’études, de réflexions et de témoignages sur les enjeux, les défis et l’avenir des universités et de la recherche en région au Québec. Évidemment, le sujet est loin d’être clos et plusieurs dimensions n’ont pu être abordées, notamment la réalité des cégeps, acteurs majeurs du réseau postsecondaire en région, ou encore celle des établissements de langue anglaise.
Nous tenons à remercier chaleureusement les autrices et auteurs qui ont accepté de publier un texte dans le présent dossier, de même que l’équipe éditorial du Magazine, en particulier Johanne Lebel, pour sa confiance, son ouverture et sa collaboration. Un grand merci également à tous les partenaires associés à ce chantier réflexif : l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Université du Québec, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ), l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l’Observatoire du la réussite en enseignement supérieur (ORES), le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l’enseignement supérieur (LIRES) et le Fonds de recherche du Québec. Nos remerciements vont aussi à Sonny Rousseau pour son soutien à la direction du présent numéro.
François-Olivier Dorais, Olivier Lemieux et Jean Bernatchez
- 1
Voir Pierre Doray (et al.), L'Université du Québec. 1968-2018. 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au développement du Québec, Montréal, PUQ, 2018, 676 p.
- 2
L’Université québécoise du futur : Tendances, enjeux, pistes d’action et recommandations, 15 septembre 2020. https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/UduFutur-FRQ-1.pdf
- 3
Reconnaître, protéger et promouvoir la liberté universitaire. Rapport de la commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, décembre 2021, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/organismes-lies/Rapport-complet-Web.pdf?1639494244.
- 4
Voir notamment Stéphane Allaire et Frédéric Descheneaux (dir.), L’université du futur. Idées et réflexions à l’intention des professeurs de demain, PUQ, 2024, 192 p.; Louis-Philippe Lampron et Simon Viviers, En toute collégialité ! Chroniques d’une aventure syndicale universitaire, Montréal, Somme toute, 2025, 336 p.; L'université Au Québec - Enjeux Et Défis, Montréal, Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l’enseignement supérieur (LIRES), 2025, 925 p.; Claude Lessard et Pierre Doray (dir.), 50 ans d’éducation au Québec, Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 2016, 308 p.
- François-Olivier Dorais
UQAC
Professeur agrégé à l’Université du Québec à Chicoutimi, François-Olivier Dorais enseigne l’histoire du Québec et du Canada aux XIXe et XXe siècles, l’histoire régionale, l’historiographie et l’initiation à la recherche historique. Ses recherches se partagent entre l’histoire culturelle et intellectuelle au Québec, l’historiographie, l’histoire de la culture savante et l’histoire des francophonies minoritaires au Canada. Membres des comités de rédaction des revues Mens et Recherches sociographiques et co-directeur de la collection « Fabrique d’histoire » aux Presses de l’Université Laval, il est notamment l’auteur de L’école historique de Québec. Une histoire intellectuelle (Boréal, 2022) et co-auteur (avec Louise Bienvenue) de Profession historienne? Les femmes dans la production et la diffusion des sciences historiques, XIXe-XXe siècles (PUL, 2023).
- Olivier Lemieux
UQAR
Professeur en administration et politiques de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis), Olivier Lemieux s’intéresse principalement à l’analyse politique de l’éducation et de l’histoire de l’éducation au Québec. Il a obtenu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour ses travaux de maîtrise, le Prix commémoratif Cathy James pour ses travaux de doctorat et le prix Publication en français Louise-Dandurand du Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour son ouvrage Genèse et legs des controverses liées aux programmes d’histoire du Québec (1961-2013), publié aux Presses de l’Université Laval en 2021. Il est notamment membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) et du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE).
- Jean Bernatchez
UQAR
Jean Bernatchez est professeur-chercheur à l'UQAR. Politologue, il détient un doctorat en administration et politique scolaires de l'Université Laval. Il possède en outre une expérience préalable de 25 ans en gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il dispense ses cours dans le contexte du DESS en administration scolaire et de la maîtrise en sciences de l'éducation. Membre du comité de direction du réseau PÉRISCOPE sur la persévérance et la réussite scolaires, il est aussi membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est du Québec (GRIDEQ), membre du Laboratoire interdisciplinaire sur l'enseignement supérieur (LIRES), chercheur associé au Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) et membre de l'Équipe de recherche et d'intervention sur l'organisation du travail des directions d'établissement d'enseignement (GRIDE). Il publie et communique les résultats de ses travaux au Québec et à l'étranger. Père de quatre jeunes adultes, il est sept fois grand-père et se révèle un citoyen engagé.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre



