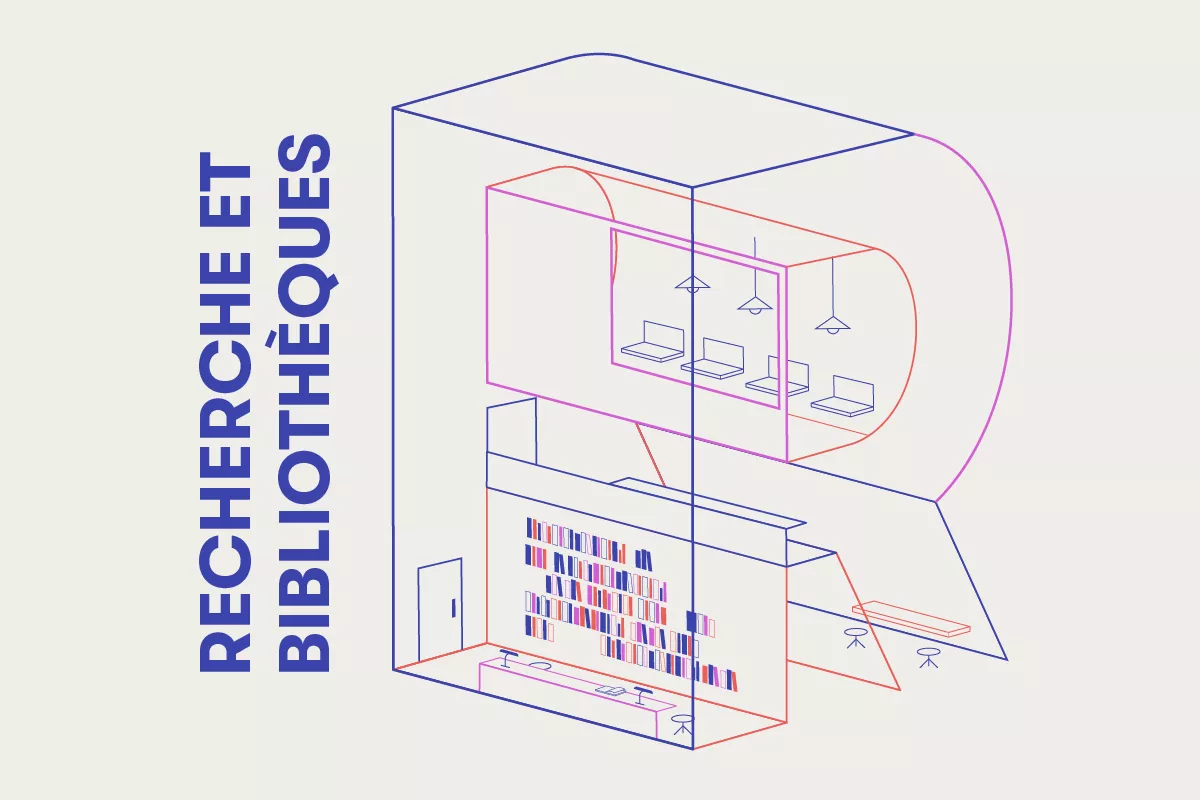À partir de sa création en 1968, la Bibliothèque nationale du Québec s’est consacrée à l’acquisition, au traitement et à la conservation de l’ensemble de l’édition québécoise, tout en veillant à mettre en valeur ses collections. À la suite de la fusion avec les Archives nationales en 2006, une nouvelle institution, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), a pris le relais. Ce cadre législatif favorisera la réalisation d’une myriade de visées comme l’accès démocratique au savoir et le progrès des connaissances.
Toute la valeur des missions d’une bibliothèque nationale se réverbère à travers le prisme de la recherche – qu’elle se présente comme un besoin ou un processus. La recherche est comme une étincelle : elle conduit les chercheur·euses vers les salles de consultation, elle apporte un éclairage nouveau aux documents, elle sollicite l’expertise des bibliothécaires, elle stimule l’amélioration des outils ou encore, elle génère des partenariats enrichissants.
Ce texte explore quelques facettes du lien réciproque et prolifique entre les activités de l’équipe de la Bibliothèque nationale et la recherche. Cette connexion historique trouve ses origines dans la bibliothèque Saint-Sulpice, qui a ouvert ses portes en 1915 pour servir, entre autres, la communauté universitaire. Aujourd’hui, cette relation s’inscrit et se déploie au sein d’un carrefour de connaissances ouvert à tous : BAnQ.

Consolider notre patrimoine publié
Matière première des chercheur·euses, les collections de la Bibliothèque nationale s’enrichissent principalement grâce au dépôt légal. Le règlement oblige les éditeurs québécois à remettre – généralement en deux exemplaires – leurs publications à BAnQ. Par ailleurs, l’équipe de la Bibliothèque nationale acquiert, par achats et dons, les œuvres publiées hors Québec qui sont d’intérêt québécois. Les documents plus anciens, reçus avant l’instauration du dépôt légal, complètent les collections.
Ainsi, les collections de la Bibliothèque nationale comprennent la quasi-totalité de l’édition québécoise depuis le début de l’imprimerie au Québec en 1764. Ce patrimoine publié inclut des livres, des revues, des journaux, des cartes géographiques, des affiches, des partitions musicales, des cartes postales, des programmes de spectacles, des livres d’artistes, des livres anciens, des publications gouvernementales et des estampes. Tantôt sources primaires, tantôt sources secondaires, ces documents témoignent de l’histoire culturelle, littéraire, sociale, politique, économique ou scientifique du Québec.
Le mandat particulier d’une bibliothèque nationale permet de réunir des conditions propices à la recherche : le caractère perpétuel du dépôt légal, jumelé aux autres efforts soutenus d’exhaustivité, offre un panorama incomparable, représentatif et intègre de la production nationale du Québec. Des travaux tels le catalogue des manuels scolaires de Paul Aubin, chercheur autonome affilié au Centre universitaire d’études québécoises1, et les écrits sur les almanachs du Québec du professeur allemand Hans-Jürgen Lüsebrink2 mettent en lumière cette nature.
Encore faut-il que les collections soient accessibles. Celles de la Bibliothèque nationale sont réparties entre le site Grande Bibliothèque et le site Rosemont, à Montréal. Le public peut consulter quelque 800 000 titres à ces deux endroits. Fait à souligner, la grande majorité des exemplaires de diffusion sont en accès libre au site Grande Bibliothèque; une telle proximité immédiate, au bénéfice des chercheur·euses, ne se rencontre guère dans toutes les bibliothèques nationales.
Plus encore, environ 10 % de ces documents sont accessibles en ligne via la plateforme BAnQ numérique, ce qui décuple les moyens de recherche. En arrière-scène, les efforts pour rehausser la découvrabilité sont continus : numérisation de corpus inusités, libération de droits d’auteur et développement d’un modèle de reconnaissance de l’écriture manuscrite, entre autres.
Révéler les contenus et valoriser leur potentiel
Bien qu’elles recèlent d’extraordinaires richesses de fonds et de formes, les précieuses collections de la Bibliothèque nationale sont peu connues, autant de la part du grand public que du milieu universitaire. À la fois diversifiés, universels, étonnants et inspirants, ces documents publiés sont les témoins de l’histoire collective du Québec. Grâce aux initiatives mettant en relation les documents et les chercheur·euses de tous horizons, les collections prennent vie et alimentent la curiosité.
Les salles de consultation de la Bibliothèque nationale et le service de référence à distance sont l’un des points de départ pour les chercheur·euses désirant satisfaire leur soif d’apprendre. Les questions posées peuvent être complexes et représenter un défi de taille : les citoyens-chercheur·euses se tournent généralement vers BAnQ pour dénouer l’impasse. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de demandes, aussi intéressantes que diversifiées, qui obtiennent des réponses. Au gré des échanges avec un professionnel de l’information naissent parfois des passions qui prennent la forme de véritables quêtes. De la sorte, une découverte inédite dans un journal d’époque concernant une personne peut ouvrir la voie à une démarche microhistorique, tout comme une simple interrogation sur un édifice peut conduire à une première consultation de répertoires municipaux et de cartes anciennes.
À ces services qui comblent les besoins de recherche individuels s’ajoute une offre d’accueil de groupes, de formations, de conférences et d’événements spéciaux ouverts au grand public. Ces activités gratuites, conçues et animées par des membres du personnel de BAnQ en collaboration avec des chercheur·euses universitaires, des auteurs et des artistes, favorisent la découverte en mettant en lumière des documents avec lesquels le public n’est pas nécessairement familier. Ces approches, tour à tour thématiques ou historiques, offrent aux citoyens l’occasion de voir les œuvres de près et de les comprendre.
Enfin, la publication de livres et d’articles, sur les plateformes de BAnQ ou dans des revues spécialisées, et la contribution à des initiatives de diffusion, comme des balados ou des conférences, font rayonner les corpus uniques à l’extérieur des murs des deux sites de la Bibliothèque nationale. Parmi ces initiatives figurent L’Île aux démons3 ainsi que Monstres et merveilles du monde4, deux ouvrages publiés par Alban Berson, cartothécaire à BAnQ. À cela s’ajoute le Wikithon, un événement annuel tenu à la Bibliothèque nationale, qui rassemble des adeptes de la culture libre œuvrant à l’enrichissement du contenu francophone sur Wikipédia, Wikidata et Wikimedia Commons.
Accompagner les chercheurs et les chercheuses
En 2002, un programme de bourses a été mis sur pied afin de soutenir financièrement les chercheur·euses universitaires ayant recours aux collections. Ainsi, de sa création jusqu’à 2024, le programme de bourses a été piloté par l’équipe de la Bibliothèque nationale. En 20 ans, ce sont près de 800 candidatures qui ont été reçues et évaluées et une centaine de boursiers, principalement des historiens et des littéraires, qui ont bénéficié d’un soutien financier pour approfondir leurs projets. Au cours des dernières années, le programme a évolué, faisant place à d’autres thématiques et s’intégrant encore davantage au milieu de la recherche. En effet, depuis 2025, le processus d’octroi des bourses, renommées bourses FRQ-Fondation de BAnQ, est régi par les règles de programme des Fonds de recherche du Québec. Ces bourses sont financées par le FRQ et la Fondation de BAnQ.
Les chercheur·euses qui fréquentent la Bibliothèque nationale (site Grande Bibliothèque) peuvent réserver un local de recherche fermé pour la durée de leurs travaux. Obtenir ainsi un endroit tranquille propice à la concentration au cœur des collections et à deux pas de l’expertise du personnel est très apprécié.
Mu également par le désir d’encourager la relève, le personnel de BAnQ accueille des étudiants du Québec et des stagiaires du monde entier, les accompagnant dans la réalisation de leurs projets de recherche. Ces initiatives se réalisent généralement en collaboration avec des institutions universitaires ou des équipes comme le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal. Par exemple, il peut s’agir de projets en humanités numériques mettant à contribution des chercheur·euses en histoire, en géographie ou en bibliothéconomie, autour de documents issus des collections sur différentes plateformes numériques telles que Montréal d'un autre siècle : cartographie des images des albums de rues E.-Z. Massicotte5 et Théâtre à Montréal, 1825-19306.
Enfin, le volet recherche s’incarne aussi à travers les liens que l’équipe de la Bibliothèque nationale développe avec les universités, que ce soit en siégeant à des comités de groupes de recherche ou en s’impliquant dans le comité scientifique d’événements.
En conclusion
La pertinence d’une bibliothèque nationale pour la recherche repose sur les services qu’elle offre, sur l’expertise et les connaissances des personnes qui y œuvrent et sur la profondeur de ses collections. Au Québec, comme elle compose une seule institution avec les Archives nationales, elle offre un terrain de jeu qui n’a de limites que la créativité des personnes qui pénètrent cet univers beaucoup plus accessible qu’il ne peut paraître à première vue.
Rassemblant la mémoire publiée des Québécois, la Bibliothèque nationale est un écrin qui accueille les chercheur·euses, qu’ils soient associés à une institution universitaire ou non, ainsi que les citoyens curieux. À la Bibliothèque nationale, dont la mission dessert le milieu de la recherche dans son ensemble, tout le monde est un chercheur ou une chercheuse. C’est pourquoi il est essentiel de poursuivre les efforts pour faire connaître cet héritage qui appartient à tous.

- 1
AUBIN, Paul, Les manuels scolaires québécois, https://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/ (consulté le 1er avril 2025).
- 2
LÜSEBRINK, Hans-Jürgen, « Le livre aimé du peuple » : Les almanachs québécois de 1777 à nos jours, Québec, Presses de l'Université Laval, 2014, 422 pages.
- 3
BERSON, Alban, L'île aux Démons : et autres mirages cartographiques de l'Amérique du Nord : 1506-1647, Québec, Septentrion, 2022, 150 pages.
- 4
BERSON, Alban, Monstres et merveilles du monde : huit siècles de cartes ornées, Québec, Septentrion, 2025, 190 pages.
- 5
Montréal d'un autre siècle: cartographie des images des albums de rues E.-.Z. Massicotte, https://numerique.banq.qc.ca/p/cartographie_massicotte.html (consulté le 1er avril 2025).
- 6
Théâtre à Montréal, 1825-1930, https://arcg.is/0iXvrT (consulté le 1er avril 2025).
- Geneviève Gamache-Vaillancourt et Marie-France Leclerc
Bibliothèque nationale du Québec
Marie-France Leclerc est bibliothécaire à la Bibliothèque nationale (site Grande Bibliothèque). Elle est titulaire de deux maîtrises, l'une en histoire et l'autre en sciences de l'information, obtenues à l'Université de Montréal. Elle travaille à BAnQ depuis 2014.
Geneviève Gamache-Vaillancourt est directrice de la recherche et de la diffusion des collections à la Direction générale de la Bibliothèque nationale à BAnQ. Bibliothécaire de formation, elle a œuvré en milieu universitaire pendant près de 14 ans avant de se joindre à BAnQ, en 2018.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre