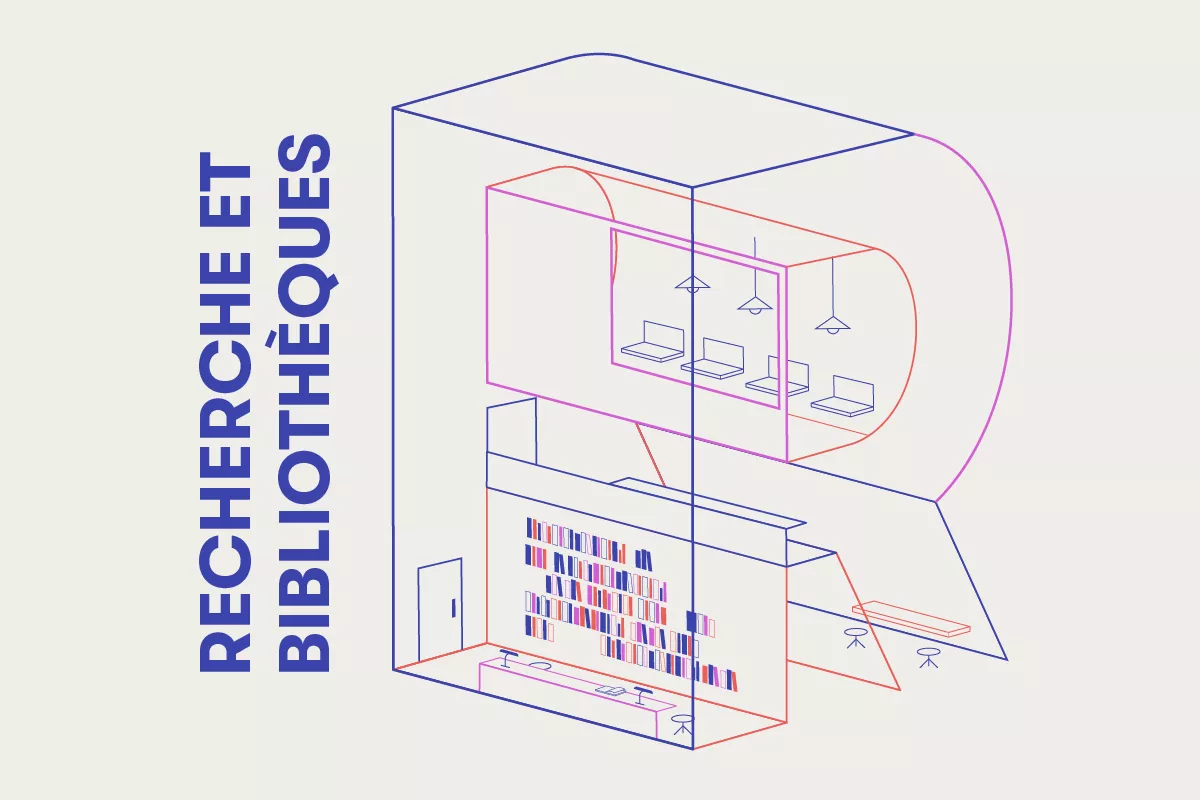Lorsqu’on évoque une bibliothèque, l’image qui vient à l’esprit est celle d’un espace de lecture, de recherche et de préservation du savoir. C’est bien le cas aussi pour les bibliothèques parlementaires, mais elles ont de plus un rôle essentiel quant au bon fonctionnement de nos institutions démocratiques. C’est le cas de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec, véritable pivot entre la construction du savoir et la prise de décision politique, elle assure aux parlementaires un accès rapide, précis et documenté à l’information.

Une institution incontournable au cœur de la démocratie
Fondée en 1802, la Bibliothèque a traversé plus de deux siècles au rythme des transformations politiques et sociales du Québec. Sa mission n’a pas changé, elle consiste toujours à favoriser la vitalité démocratique par la production, la conservation, la valorisation et la diffusion d’information et de connaissances qui font autorité. Si elle répond en priorité aux besoins informationnels des parlementaires, son rôle dépasse largement la simple gestion d’une collection de documents législatifs. Elle est également responsable de la conservation d’un patrimoine documentaire et mobilier unique et de la diffusion des connaissances auprès d’un public varié, contribuant ainsi au rayonnement du savoir et à l’enrichissement du débat démocratique
Production d’information : recherche fondamentale et soutien aux parlementaires
La Bibliothèque de l’Assemblée nationale joue un rôle essentiel dans la production d’information, à la fois par ses activités de recherche fondamentale et par son soutien direct aux parlementaires.
D’une part, deux historiens mènent des recherches fondamentales sur l’histoire du parlementarisme, sur l’évolution des institutions et sur les pratiques législatives. En produisant des études, ils documentent les transformations du système démocratique québécois et enrichissent la connaissance des institutions parlementaires. Nous pouvons citer les travaux qui mènent à la publication de l’Encyclopédiedu parlementarisme québécois ou encore à la publication de l’article Pour en finir avec 18481. Ces travaux constituent une ressource précieuse pour toute personne s’intéressant au fonctionnement du Parlement. On peut dire, en effet, que les historiens œuvrent entre le monde académique et le milieu parlementaire, facilitant l’accès aux connaissances favorisant leur diffusion.
D’autre part, nous offrons un soutien direct aux parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions législatives, de contrôle et de représentation. Nos analystes répondent aux besoins d’information en réalisant des recherches ciblées et des analyses adaptées à leurs mandats. Leur rôle est particulièrement important dans le cadre des commissions parlementaires, où ils produisent et fournissent des documents de soutien contribuant ainsi à éclairer les débats.
En combinant ces deux mandats, la Bibliothèque assure à la fois le développement et la préservation du savoir sur le parlementarisme et l’accompagnement des parlementaires dans leurs responsabilités. Elle renforce de cette façon l’efficacité et la crédibilité du processus démocratique québécois.
Conservation d’un patrimoine unique : l’évolution du parlementarisme
Du côté de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine documentaire lié à la vie parlementaire et politique québécoise, la Bibliothèque joue un rôle essentiel bien que peu visible. Institution de mémoire, elle préserve des collections riches et diversifiées2, qui constituent une ressource prisée pour les chercheurs et chercheures universitaires. Elles couvrent un large éventail de documents, allant des publications officielles du gouvernement québécois aux études spécialisées, en passant par des ouvrages rares qui témoignent de l’évolution du parlementarisme au Québec. À titre d’exemple, on retrouve le premier règlement de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada (1793) ou la première traduction française du recueil de droit parlementaire publié à Londres en 1690, le Lex Parliamentaria (1803).
Par la conservation des archives parlementaires, elle garantit la préservation de la mémoire de l’Assemble nationale. Ces archives regroupent des documents législatifs, des rapports et autres documentations, offrant aux chercheurs et chercheuses un accès unique à l’histoire politique québécoise. Elles permettent d’analyser les décisions politiques, d’étudier l’évolution des lois et d’explorer les transformations institutionnelles qui ont marqué le Québec. Ce riche ensemble constitue une source incontournable pour comprendre les dynamiques parlementaires et les grandes tendances prises par le gouvernement québécois au fil du temps.
Valorisation de l’information : un pont entre savoir parlementaire et recherche universitaire
Au-delà de sa mission de conservation, la Bibliothèque rend accessible un vaste corpus de connaissances essentielles à la compréhension de la vie politique québécoise. À travers la création et le maintien de bases de données spécialisées, elle offre gratuitement des outils pour explorer l’histoire législative et les débats parlementaires. Ces outils, par exemple la banque Myrand3 des débats de l’Assemblée nationale ou le guide thématique sur les femmes en politique au Québec, facilitent l’analyse des discours politiques et des enjeux institutionnels sur plusieurs décennies.
L’un des défis majeurs est de renforcer les liens entre le monde de la recherche et celui de la politique. Les universités produisent une quantité impressionnante de connaissances dans des domaines variés, qui se retrouvent immanquablement au cœur des débats parlementaires. Pourtant, ces savoirs restent parfois cloisonnés et peinent à se frayer un chemin jusqu’aux parlementaires.
Pour remédier à cette déconnexion, le personnel de la Bibliothèque travaille en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche afin d’y jouer un rôle de médiation. Sa participation au programme de scientifique en résidence du Fonds de recherche du Québec permet d’intégrer directement un ou une scientifique au sein de l’institution. Cette initiative favorise une meilleure compréhension des réalités parlementaires et un dialogue plus fluide entre les milieux universitaires et politiques.
Diffusion de l’information : un accès privilégié aux savoirs parlementaires
Par son rôle de diffuseur d’information, la Bibliothèque rend disponibles des contenus qui éclairent les enjeux politiques du Québec. Grâce à ses publications spécialisées, elle contribue à la diffusion des connaissances parlementaires et facilite l’accès à des analyses rigoureuses.
Parmi ces initiatives, la revue en ligne Première lecture occupe une place centrale. Dans un objectif de vulgarisation et destinée à un large lectorat, elle offre une vitrine sur l’institution et ses expertises. En croisant les perspectives de spécialistes, de scientifiques et du personnel, cette revue et son ancêtre, le Bulletin de la Bibliothèque, constituent depuis 1970 des ressources pour comprendre les dynamiques politiques et institutionnelles québécoises.
En complément, les Coups d’œil parlementaires offrent une synthèse des travaux de l’Assemblée nationale selon les secteurs d’activité de la société et de l’État. Ils permettent de saisir la complexité de la société québécoise à travers le prisme du pouvoir législatif. Afin de brosser un portrait aussi complet que possible, ces documents rassemblent autant les projets de loi que les interpellations, les motions et les pétitions. Ils témoignent de l’étendue du travail accompli par les parlementaires.
En multipliant ces initiatives, la Bibliothèque rend accessible une information de qualité et permet de mieux comprendre les enjeux qui façonnent la société.
Démocratie et accès libre
La Bibliothèque de l’Assemblée nationale est un établissement de recherche, un lieu de conservation de collections et de fonds d’archives. Elle incarne l’idée que la démocratie repose sur un accès libre et éclairé à l’information. Par ses services, son rôle d’intermédiaire entre le monde universitaire et la sphère politique, ainsi que l’expertise de son personnel, elle est une ressource incontournable. Véritable interface entre le savoir et le pouvoir, elle joue un rôle fondamental en matière de transmission du savoir auprès des parlementaires et de leur personnel.
Les bibliothèques parlementaires méritent d’être reconnues comme des institutions essentielles au fonctionnement de nos démocraties ainsi que pour leur contribution à l’accès aux connaissances. En ce sens, elles représentent l’idéal d’une société où l’information et la connaissance sont des piliers de la prise de décision collective.
- 1
Christian Blais. Pour en finir avec 1848. Cahier des Dix, no 74, 2020, p.135-190 ; no 75 2021, p. 201-256.
- 2
Véronique Cormier et Marise Falardeau. La gestion des collections en contexte parlementaire : un aperçu du corpus documentaire de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Documentation et bibliothèques, Volume 70, numéro 4, octobre-décembre 2024, p. 43–49.
- 3
Ainsi nommée en l'honneur d'Ernest Myrand, directeur de la Bibliothèque de 1912 à 1921.
- Martin Pelletier et Julie Rodrigue
Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec
Martin Pelletier est titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’Université Laval et d’une maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal. Il travaille à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale depuis 2004. En plus de 20 ans au sein de l’institution, il a développé une expertise et une connaissance approfondie des différents secteurs d’activités de la Bibliothèque et de l’Assemblée nationale. Depuis 2022, il occupe la fonction de Directeur du Service des collections et de directeur adjoint de la Bibliothèque.
Depuis 2020, Julie Rodrigue est directrice de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec. À ce titre, elle pilote les orientations stratégiques, assure la gestion opérationnelle et contribue au rayonnement de cette institution, qui joue un rôle essentiel dans le soutien des travaux parlementaires. Titulaire d’un MBA et de deux maîtrises en sciences de l’information et en histoire, elle a occupé divers postes de direction. Elle a notamment dirigé le Service d’information de la Caisse de dépôt et placement du Québec, fondé Gestion Indicium et exercé chez De Marque. Elle a également enseigné pendant dix ans à l’Université de Montréal.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre