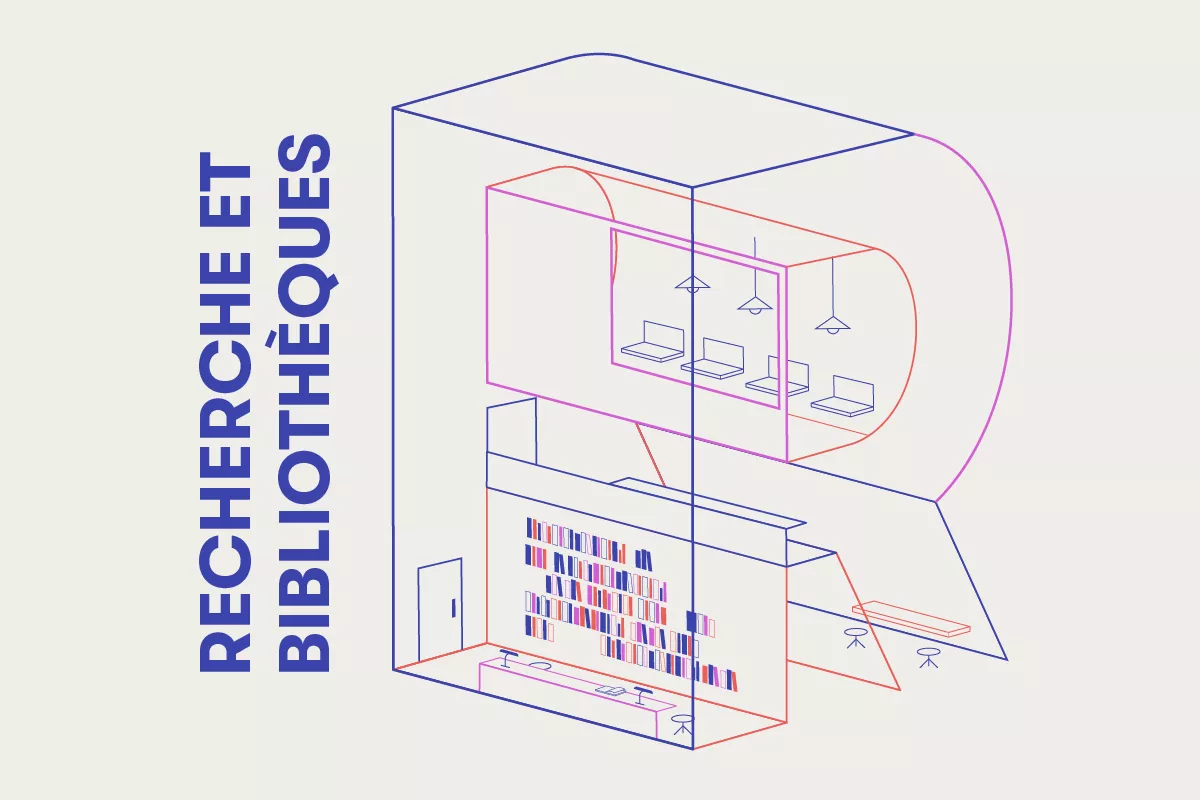La médiation des savoirs au sein de la bibliothèque universitaire (BU) met en relation le monde de la recherche, la communauté universitaire et la société civile. Aujourd’hui, dans le contexte d’évolution rapide que connaissent les bibliothèques, il est difficile de circonscrire les formes les plus communes de médiation tant les approches et les dimensions varient. Les formes peuvent intégrer à la fois une dimension pratique ou technique, utilisant des dispositifs et des outils, et une dimension symbolique, liée aux valeurs et au sens, reliant ainsi l'individuel au collectif (Hachani, 2023). Autant dire qu’il existe autant de visages de la médiation qu’il existe de types de bibliothèques, de missions et de moyens (humains, technologiques, spatiaux ou organisationnels).
La médiation comme conversation
Dans le présent article, je m’attarderai à une conception de la médiation envisagée comme un « processus conversationnel » qui teinte la relation entre les personnes et la bibliothèque, en favorisant la circulation, le partage et potentiellement la création de savoirs1. Cette conception se distingue d’une posture passive par son caractère réciproque, dans la mesure où elle implique un échange entre les usager·ères et les professionnel·les de la bibliothèque. Le récit collectif de la connaissance, à travers des projets collaboratifs, se trouve ainsi enrichi.
À l’heure où l’on parle de décoloniser les savoirs, cette approche invite les usager·ères d’une bibliothèque universitaire à interroger ces savoirs et à les rapprocher des fissures sociales du monde. J’entends, par cela, le fait de poser un regard critique sur les systèmes de légitimité du savoir, en mettant en lumière les réalités sociales invisibilisées par les rapports de pouvoir. Il s’agit d’une démarche sensible, d'une tentative de briser les barrières entre les disciplines et de transformer la bibliothèque en agora, soit en un espace de dialogue permettant à diverses voix de s’exprimer et d’exister.
...briser les barrières entre les disciplines et de transformer la bibliothèque en agora, soit en un espace de dialogue permettant à diverses voix de s’exprimer et d’exister.
Des formes hybrides
Plusieurs bibliothèques universitaires ont déjà expérimenté avec succès de nouveaux dispositifs de médiation des savoirs. Dans les universités québécoises, ces initiatives ont donné lieu à des projets de recherche sur une collection spécifique, la mise en valeur de fonds anciens ou l’exploitation de livres savants2. La collection devient donc ici un objet de recherche, mais sans qu’une forme d’échange avec les usager·ères soit installée.
Qu’en est-il si l’on ne se contente pas d’interpréter scientifiquement une collection, et que l’on instaure un dialogue autour d’elle? Le festival annuel Science et Manga de la Bibliothèque universitaire Lyon 1 en France, qui célèbre cette année sa 15ᵉ édition, est un bel exemple de médiation scientifique réalisée auprès de la population étudiante. Un dialogue s’installe entre l’univers du manga et celui de la recherche et prends forme, entre autres, dans un volet de vulgarisation scientifique assuré par les enseignant·es-chercheur·ses, ce qui ouvre la porte à de possibles collaborations pérennes.
Plus près de nous, cette fois-ci à travers un exemple culturel, la Bibliothèque de l’Université Laval a pris part en avril dernier aux célébrations lancées par l’Orchestre symphonique de Québec autour du compositeur Beethoven, en valorisant ses collections et en illustrant ainsi le lien bien vivant entre savoir, création et mémoire.
Nous pouvons apprendre de ces expériences, et nous laisser aller à rêver. Les possibilités abondent quand il s’agit de rendre nos espaces plus vivants, d’en faire, par exemple, des lieux privilégiés de contextualisation d’enjeux sociétaux et des remparts à la désinformation. Pensons aux causeries en bibliothèque et hors les murs, aux médiations autour d’expositions thématiques (déjà bien ancrées dans les pratiques des BU québécoises), aux résidences d’artistes ou de chercheur·euses, aux balados enregistrés sur place, aux clubs de lecture, etc.
Enfin, j'aimerais mentionner ce parcours estival dans plusieurs bibliothèques européennes, où j'ai relevé une différence dans la dénomination des rôles professionnels : il est fréquent d’y trouver une personne ou même une équipe, selon les moyens, chargée de « la mission d’action culturelle et scientifique ». C’est une approche dont nous pourrions certainement nous inspirer.
Les possibilités abondent quand il s’agit de rendre nos espaces plus vivants, d’en faire, par exemple, des lieux privilégiés de contextualisation d’enjeux sociétaux et des remparts à la désinformation. Pensons aux causeries en bibliothèque et hors les murs, aux médiations autour d’expositions thématiques, aux résidences d’artistes ou de chercheur·euses, aux balados enregistrés sur place, aux clubs de lecture, etc.
Oser la subversion
Je vois déjà certaines personnes arguer que nos bibliothèques universitaires manquent d’espaces et que, lorsqu’elles parviennent à en obtenir, la priorité — absolument légitime — va aux locaux de travail pour les usager·ères. À cela, je réponds toujours que la bibliothèque universitaire ne se limite pas à l'idée que l’on s’en fait et que sa mission peut essaimer bien au-delà de ses murs. Par exemple, en prenant part à de la recherche participative avec des communautés locales et associatives, ou encore, en organisant des évènements hors les murs dans l’objectif de rendre le savoir accessible au plus grand nombre.
Ces modèles de médiation impliquent un certain lâcher-prise, et ils encouragent une remise en question des modes traditionnels de communication des savoirs universitaires, souvent perçus comme hermétiques et peu attrayants. Une cocréation peut émerger entre les chercheur·euses — peu importe l’étape de leur carrière — et les bibliothécaires, afin de concevoir ensemble des formats de diffusion mettant richement en partage toutes ces connaissances.
Il ne faut pas non plus oublier les étudiant·es (au premier cycle) qui n’ont pas encore le pied dans la recherche, mais qui doivent également apprendre à naviguer et à réfléchir sur le monde. Les exemples du Service commun de la documentation de l’Université de Paris – expositions, évènements et festivals nationaux, manifestations orales et rencontres, projets d’humanités numériques – présentés par Claire Tirefort (2021), illustrent bien cette dynamique, où les projets sont directement soumis par les étudiant·es, mais aussi par les enseignant·es.
Pour Siu Hong Yu (2017), bibliothécaire à l’Université de Waterloo, la littératie informationnelle ne se résume pas à un ensemble de compétences, mais constitue une manière de s’orienter dans le monde complexe de l’information grâce à l’enquête personnelle et à la pensée critique. La médiation peut également remplir ce rôle. Il s’agit d’une façon de voir la recherche non pas comme un ensemble figé, mais comme un espace investi par des humains, des intentions, des émotions.
Je livre ici ces idées et réflexions (qui ne sont pas si nouvelles), dans un esprit de partage, visant à inviter les bibliothèques universitaires à favoriser une culture de la médiation des savoirs, inspirée par la spécificité des disciplines qu’elles desservent. Il en demeure toutefois un enjeu important : celui de clarifier ce que l’on entend par « médiation » et de développer une terminologie commune, afin de mieux ancrer ces pratiques existantes et futures.
...la littératie informationnelle ne se résume pas à un ensemble de compétences, mais constitue une manière de s’orienter dans le monde complexe de l’information grâce à l’enquête personnelle et à la pensée critique.
Bibliographie
- Bogui, Sarah de. 2008. « Le rôle de médiation des bibliothèques patrimoniales en milieu universitaire ». Documentation et bibliothèques 54 (4): 257‑64. https://doi.org/10.7202/1029188ar.
- Chourrot, Olivier. 2007. « Le bibliothécaire est-il un médiateur ? » Text. 1 janvier 2007. https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001.
- Gaume, Florence, et Livia Rapatel. 2016. « Le festival Science et Manga, une manifestation originale de la BU Lyon 1 ». Dans Médiatiser la science en bibliothèque, édité par Justine Ancelin, 134‑40. La Boîte à outils. Villeurbanne: Presses de l’enssib. https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.5065.
- Hachani, Mabrouka El. 2023. « Une approche dispositive de la médiation des savoirs en contexte culturel ». Approches Théoriques en Information-Communication (ATIC) 7 (2): 119‑39. https://doi.org/10.3917/atic.007.0119.
- Tirefort, Claire. 2021. « Médiation culturelle en bibliothèque universitaire : à la rencontre des étudiants ». Dans L’art et la manière. Les industries culturelles et créatives, édité par Françoise Richer-Rossi et Stéphane Patin. Coll ”Interculturel”. Éditions des Archives Contemporaines. https://doi.org/10.17184/eac.4519.
- Yu, Siu Hong. 2017. « Just Curious: How Can Academic Libraries Incite Curiosity to Promote Science Literacy? » 12 (1): 1‑8. https://doi.org/10.21083/partnership.v12i1.3954.
- Rose Henriquez
Université de Montréal
Rose Henriquez évolue à la croisée des milieux culturel (journaliste et critique) et universitaire. On peut lire ses textes entre autres dans Le Devoir, la Gazette des femmes, Jeu et Spirale. Elle a dirigé des projets d’édition pour les Éditions du remue-ménage et pour Québec Amérique. Elle s’intéresse à la place des femmes racisées dans le milieu de la recherche scientifique, dans la production des connaissances et dans les sphères numériques, ainsi qu’à la décolonisation de la critique. Elle est bibliothécaire dans une université québécoise.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre