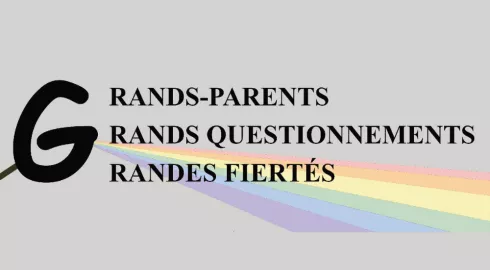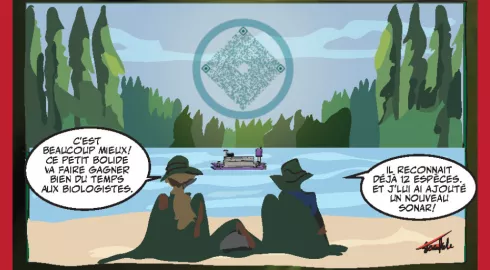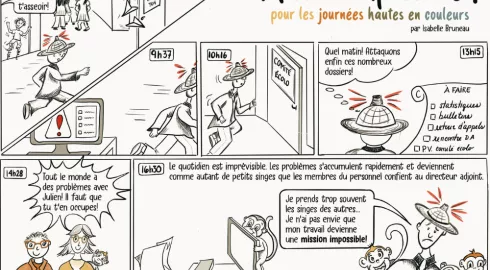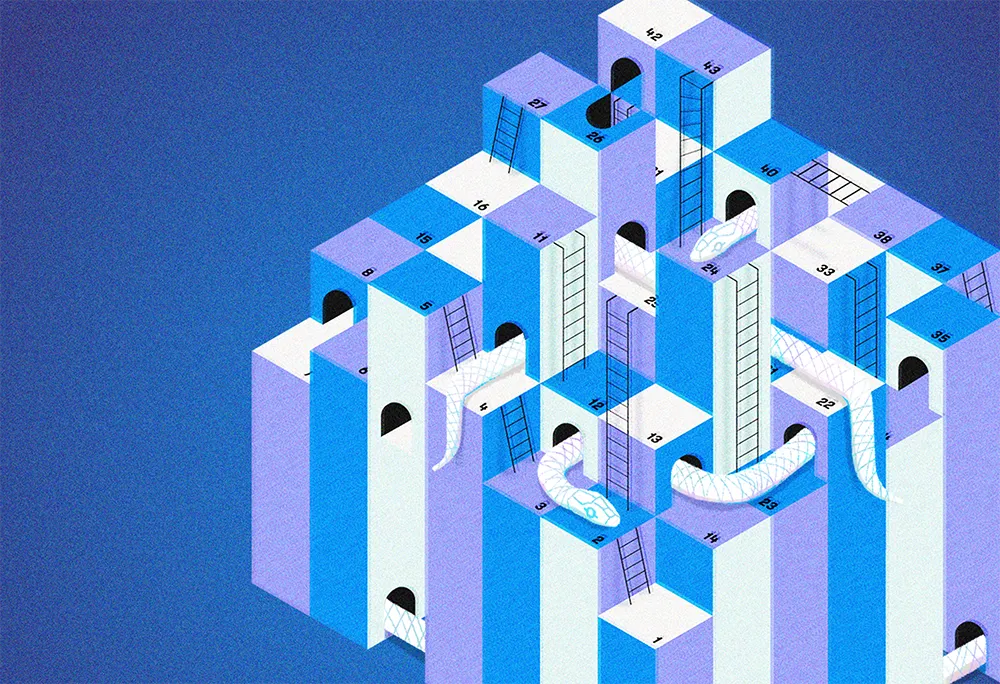Pour le dossier « Rêver, s'engager », nous avons demandé à des membres de la relève de nous parler de leurs motivations, de leurs parcours et de leurs aspirations en recherche. Conversation avec Éloïse Brassard, récipiendaire d'un Prix Acfas Relève en 2024, qui poursuit aujourd'hui un doctorat en télédétection à l'Université de Sherbrooke afin de contribuer au développement des connaissances liées à l’exploration de Mars.

D’où vient ton intérêt, ta fascination pour ton domaine et/ou ton objet de recherche?
Adolescente, j’avais un intérêt marqué pour la géologie et pour l’observation des constellations et des phénomènes astronomiques. Je ramassais les roches que je trouvais intéressantes et je sortais mon cherche-étoiles sous les ciels clairs, sans nuages. À l’époque, je ne savais pas que des chercheuses et chercheurs se consacraient à l’étude des planètes! De fil en aiguille, au long de ma formation universitaire, j’ai réalisé que je pouvais me diriger vers ce domaine grâce à la professeure Myriam Lemelin, qui étudie la surface de la Lune et de Mars à distance pour soutenir les missions d’exploration spatiale. Mon intérêt pour la recherche dans le domaine des sciences planétaires s’est confirmé grâce à plusieurs opportunités survenues dans les dernières années, dont une formation terrain sur les cratères d’impact, une école d’été à propos de la planète Mars et plusieurs conférences scientifiques.
Adolescente, j’avais un intérêt marqué pour la géologie et pour l’observation des constellations et des phénomènes astronomiques. Je ramassais les roches que je trouvais intéressantes et je sortais mon cherche-étoiles sous les ciels clairs, sans nuages.

Raconte-nous ton arrivée sur les bancs d’université, au baccalauréat. Quels désirs, quels rêves t’habitaient à ce moment?
Je suis entrée à l’université dans un programme de géologie, après avoir découvert les sciences de la Terre au cégep. À ce moment, j'avais comme objectif de poursuivre avec un DESS en océanographie après mon baccalauréat. Mes plans ont changé dès la première année, lorsque j’ai découvert la cartographie et la géomatique dans un de mes cours. La géomatique, c’est un ensemble de compétences et de technologies pour comprendre et visualiser des informations liées au territoire et à la localisation. Pensez à Google Maps, à l’utilisation des images satellites pour le suivi des feux de forêts ou encore à la création de modèles numériques de terrain pour la prévention des inondations. Je me suis alors redirigée vers ce domaine qui rejoint davantage ma fibre « techno ». J’avais trouvé ma voie avec la géomatique!
La géomatique, c’est un ensemble de compétences et de technologies pour comprendre et visualiser des informations liées au territoire et à la localisation. Pensez à Google Maps, à l’utilisation des images satellites pour le suivi des feux de forêts ou encore à la création de modèles numériques de terrain pour la prévention des inondations.
Après le baccalauréat, pourquoi as-tu entamé des études aux cycles supérieurs?
Pendant mon baccalauréat, j’ai effectué trois stages en recherche à l’Université de Sherbrooke, dont deux avec la professeure Myriam Lemelin. J’utilisais les outils de la géomatique pour étudier certaines formations géologiques de l’Arctique canadien – les chapeaux de fer, des dépôts rocheux oxydés – en tant qu’analogues à la surface de la planète Mars. Et c’est par ces stages que j’ai été introduite aux cycles supérieurs! J’ai eu l’opportunité d’entamer un projet de maîtrise pour poursuivre et approfondir les travaux sur ce même sujet, en plus d’aller collecter des données et des échantillons sur le terrain, en Arctique. J’étais très motivée par des études aux cycles supérieurs, car ce projet de recherche me permettait de combiner plusieurs de mes intérêts : géomatique, géologie, sciences planétaires et milieux nordiques. Je faisais mon entrée dans le monde des sciences planétaires avec mon bagage en géomatique, et j’y suis restée en poursuivant au doctorat en télédétection – la science de l’observation de la Terre et des corps planétaires à distance. J’utilise actuellement des images acquises par plusieurs satellites en orbite autour de Mars pour étudier la géologie de surface de cette planète, particulièrement les milieux riches en fer.
As-tu toujours su que tu voulais faire de la recherche?
Non! En fait, lors de mon entrée à l’université, j’étais convaincue que je ne voulais pas faire de maîtrise. Je voulais aller dehors, bouger, et je ne pensais pas trouver ce type d’expérience en recherche. Puis, j’ai eu plusieurs opportunités de faire du travail de terrain au baccalauréat et à la maîtrise, ce qui a changé ma vision des choses et orienté peu à peu mon parcours vers les études graduées. Au baccalauréat, j’ai réalisé un premier stage au sein du projet LakePulse, qui vise à caractériser l’état de santé des lacs au Canada. J’ai alors participé à une campagne d’échantillonnage des lacs au Yukon. Puis, à la maîtrise, j’ai participé à un projet pilote au nord de la Suède pour étudier les dépôts de poussières minières sur la neige. Par la suite, j’ai vécu deux expériences de terrain dans l’Arctique canadien, avec comme objectif de prendre des mesures et d’échantillonner les chapeaux de fer. En bref, c’est le travail de terrain qui m’a convaincue de m’investir en recherche. En découvrant la variété de tâches de mon quotidien de chercheuse, – entre le bureau, le laboratoire et le terrain – j’ai décidé d’y rester!
Aujourd’hui, comment t’engages-tu en recherche afin de réaliser ces rêves?
Une des manières de m’engager en recherche est par la vulgarisation scientifique. En débutant mon parcours aux cycles supérieurs, je me suis vite rendu compte que le domaine des sciences planétaires rejoignait l’imaginaire des gens! C’est ma participation au concours La preuve par l’image de l’Acfas qui a lancé le bal et m’a fait réaliser mon intérêt pour la vulgarisation scientifique. Dans les années qui ont suivi, je me suis impliquée dans plusieurs activités de vulgarisation afin de faire rayonner la recherche en télédétection planétaire et de rendre la science accessible. Dans les musées, à la radio, en plein air, je suis toujours ravie de voir des gens de tous âges s’intéresser à ce domaine! J’ai également collaboré avec l’organisme Futurum Careers pour publier un article de vulgarisation et créer une fiche d’activités pour les jeunes (en anglais seulement) afin de faire découvrir la géomatique et l’exploration spatiale. Toutes ces activités me permettent de développer des compétences transversales et d’obtenir de nouvelles perspectives. J’en ressors souvent stimulée et motivée pour la continuation de mes travaux!

- Éloïse Brassard
Université de Sherbrooke
Éloïse Brassard a complété un baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement à l'Université de Sherbrooke. En poursuivant ses études à la maîtrise dans le même domaine, elle s'est spécialisée dans l'étude de formations géologiques de l'Arctique canadien nommées « chapeaux de fer » en tant qu'analogues à des formations potentiellement similaires sur la planète Mars. Passionnée par les sciences planétaires, la géologie, la géomatique et les milieux nordiques, elle a participé à des missions de terrain dans l'Arctique et l’Ouest canadien, en Suède et en Arizona, renforçant ses compétences en logistique d’expéditions scientifiques.
Sensibilisée à la place des femmes en science, technologie, ingénierie et mathématiques, elle a remporté des prix pour sa participation à des concours de vulgarisation de la science et a présenté ses travaux lors de nombreuses activités de communication publiques. Éloïse Brassard est actuellement au doctorat en télédétection. Elle souhaite rendre la recherche accessible et susciter l'intérêt du public, et espère que ses travaux feront progresser les connaissances concernant l’exploration de Mars.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre