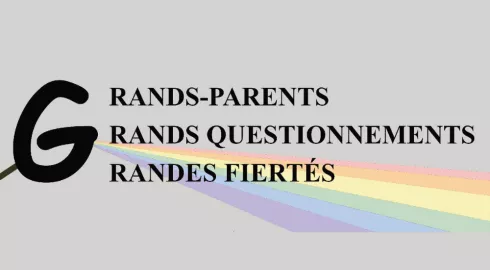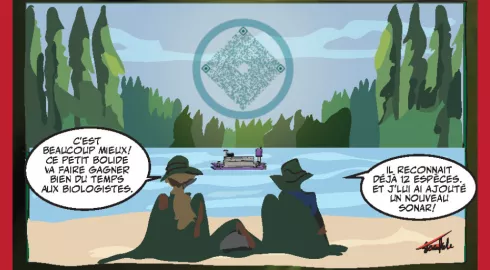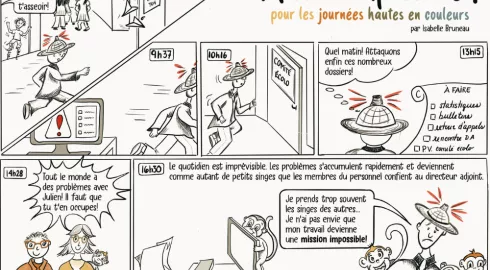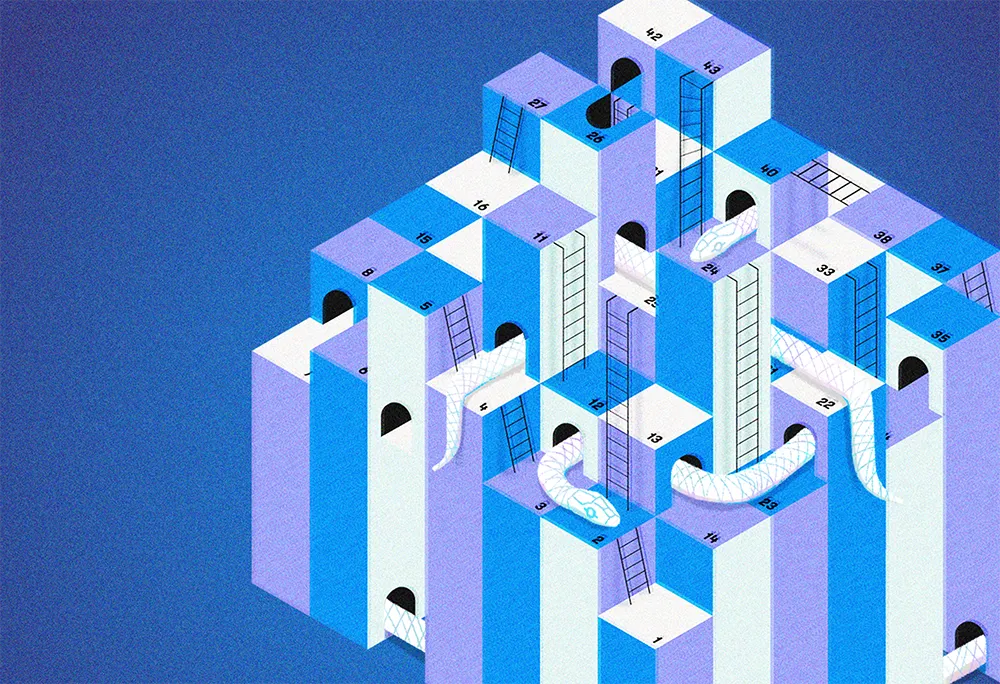Pour le dossier « Rêver, s'engager », nous avons demandé à des membres de la relève de nous parler de leurs motivations, de leurs parcours et de leurs aspirations en recherche. Conversation avec Camille Martini, récipiendaire d'un Prix Acfas Relève en 2025, qui poursuit aujourd'hui un doctorat en droit à l'Université Laval afin de participer à la conversation scientifique sur la justice climatique.

D’où vient ton intérêt, ta fascination pour ton domaine et/ou ton objet de recherche?
Mes recherches en droit s’intéressent aux procès pour le climat, c’est-à-dire des actions en justice souvent initiées par des personnes ou des organisations de la société civile ayant des préoccupations environnementales. Celles-ci utilisent l’arène judiciaire afin de pousser les décisionnaires publics et privés à en faire davantage pour lutter contre les changements climatiques, notamment pour les atténuer et s’adapter à leurs effets.
Cet intérêt pour ce type de procès est le fruit d’un long cheminement personnel et professionnel. Depuis l’enfance, j’ai un lien fort avec la nature (même si j’ai toujours vécu en ville, allez comprendre!). Certaines personnes de mon entourage ont d’ailleurs longtemps pensé que je me dirigerais vers les sciences naturelles. Pourtant, j’ai choisi le droit – un peu par défaut à l’époque, pour être honnête. Je n’avais jamais suivi de cours d’initiation au droit pendant mon secondaire, mais j’avais beaucoup entendu que cette voie « menait à tout ». Pour l’anecdote, en discutant avec un juriste du sport lors d’un salon d’orientation professionnelle organisé par mon école secondaire, je me suis dit : pourquoi ne pas allier droit et sport? À l’époque, j’étais arbitre de basketball dans une ligue d’assez bon niveau, et je me voyais rester dans le milieu d’une manière ou d’une autre. Ce rêve n’a pas duré très longtemps, mais il m’a mis sur la voie.
Pendant mes études, l’environnement est resté un fil conducteur; par exemple, mon mémoire de maîtrise, déposé en 2016, portait sur l’insuffisante prise en compte de l’environnement dans le règlement des litiges entre États et entreprises internationales, qui portent souvent sur des enjeux économiques. Ma pratique comme avocat, de 2018 à 2022, s’est ensuite concentrée sur le droit international économique. Cette expérience en cabinet m’a cependant offert peu d’occasions de traiter des procès climatiques dans le cadre des dossiers qui m’étaient confiés à l’époque. Or, ce phénomène prenait de l’ampleur et m’intéressait énormément. J’ai alors ressenti le besoin d’entamer une réflexion scientifique sur ces procès, afin de développer une vision plus globale de la justice climatique, plutôt que de défendre des intérêts particuliers. C’est ce qui m’a conduit à entamer un doctorat, en 2022, sur la question des procès sur le climat. Ces questions m’inspirent, car plusieurs requérants cherchent aujourd’hui à faire avancer les politiques climatiques, sensibiliser le public, ou changer le comportement du gouvernement ou de l’industrie; bref, ces personnes veulent induire un changement sociétal plus profond, bien au-delà de leurs propres intérêts!
Après le baccalauréat, pourquoi as-tu entamé des études aux cycles supérieurs?
Ma décision de poursuivre mes études aux cycles supérieurs était avant tout pragmatique : en France, où j’étudiais à l’époque, il est impossible de pratiquer le droit sans une maîtrise! Mais ce choix de poursuivre mes études aux cycles supérieurs découle également d’un contexte particulier. Je venais de passer une année à l’Université de Navarre, en Espagne, dans le cadre d’un échange universitaire. Cette immersion dans une autre culture m’a inspiré à prendre une direction différente : je n’avais plus envie de plus me limiter au cadre juridique français - ce qui se passait ailleurs m’intéressait trop.
Cette immersion dans une autre culture [dans le cadre d'un échange universitaire] m’a inspiré à prendre une direction différente : je n’avais plus envie de plus me limiter au cadre juridique français - ce qui se passait ailleurs m’intéressait trop.
J’ai donc commencé à explorer le droit international en entamant ma maîtrise, en 2014. D’ailleurs, en revenant d’Espagne, je me suis mis rapidement à la recherche d’opportunités pour repartir à l’étranger pour la maîtrise! À ce moment, j’avais envie de découvrir l’Amérique du Nord, et le Québec me semblait la destination idéale pour étudier le droit, entre traditions de droit civil et de common law. J’ai alors découvert le milieu universitaire québécois lors d’un échange d’une session à l’UQAM. Cette première expérience au Québec a été un succès, tant sur le plan académique que sur le plan personnel : il m’a permis de m’immerger dans une autre culture universitaire, de développer de nouvelles perspectives de recherche, et de tisser des liens humains qui perdurent aujourd’hui. À plusieurs égards, cette expérience a marqué mon parcours et m’a donné l’envie et la conviction de revenir au Québec pour y entreprendre ma thèse, cette fois à l’Université Laval. Un juste retour des choses!
As-tu toujours su que tu voulais faire de la recherche?
La recherche universitaire a toujours été présente dans un coin de ma tête, sans doute parce qu’une partie importante de ma famille travaille en milieu académique et m’a montré que ce chemin était possible. Mais au début de mes études de droit, il n’en était pas question! Je n’aurais probablement pas été capable de commencer mon doctorat directement après la maîtrise, d’ailleurs, car je manquais de recul pour approfondir une matière aussi vivante que les enjeux climatiques, qui évoluent au gré des transformations sociales, politiques et économiques de nos sociétés. En préparant l’examen du barreau, j’ai réalisé que les connaissances dans le domaine du droit sont autant le fruit de la recherche scientifique que de l’expérience judiciaire. C’est ce qui m’a poussé à exercer pendant cinq ans comme avocat en droit international entre 2018 et 2022. Cela dit, je n’ai jamais complètement quitté l’université : en parallèle de ma pratique comme avocat, je donnais un cours à la Sorbonne, une vraie respiration au milieu de semaines bien remplies. Et peu à peu, une question s’est imposée : et si ce « à côté » devenait le cœur de mon travail?
Je n’ai jamais complètement quitté l’université : en parallèle de ma pratique comme avocat, je donnais un cours à la Sorbonne, une vraie respiration au milieu de semaines bien remplies. Et peu à peu, une question s’est imposée : et si ce « à côté » devenait le cœur de mon travail?
Aujourd’hui, comment t’engages-tu en recherche afin de réaliser ces rêves?
Assez tôt dans mon parcours, j’ai ressenti le besoin de mettre mes compétences juridiques au service de la justice sociale et environnementale. Ce souhait s’est concrétisé durant mes études de maîtrise. À mon départ du Québec en 2015, toujours animé par le désir de vivre d’autres expériences internationales, j’ai poursuivi un LL.M. d’un an aux États-Unis, au Boston College. Dans ce cadre, je me suis engagé sur des projets pro bono pour plusieurs organismes œuvrant pour la protection de l’environnement et le développement durable, comme le Natural Resources Defense Council. Ce fut une expérience très enrichissante, qui m’a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques accumulées. Une fois devenu avocat, cet engagement s’est poursuivi naturellement. Fin 2021, j’ai corédigé un rapport pour l’International Refugee Assistance Project sur la reconnaissance d’un droit d’asile pour les personnes déplacées par les effets des changements climatiques. Cette expérience a été un véritable déclic : j’ai constaté que la recherche pouvait avoir un impact concret sur des vies humaines. Depuis, je me suis lancé au doctorat, et je consacre désormais pleinement mes travaux à la justice climatique. Parallèlement, j’interviens notamment comme directeur du concours Lex Climatica depuis sa fondation, en 2023. Il s’agit du premier concours de plaidoirie au monde sur le droit et les politiques climatiques. Aujourd’hui, je me sens finalement bien plus engagé qu’à mes débuts, car j’ai pu constater de manière tangible que mes efforts académiques et professionnels contribuent directement à promouvoir la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques à l’échelle locale et internationale.

Comment rêves-tu la suite de ton parcours professionnel?
Beaucoup considèrent le doctorat, et la thèse en particulier, comme une fin en soi. Pour moi, c’est plutôt une étape, certes intense, mais surtout passionnante. C’est l’occasion de questionner, d’expérimenter, de tester des idées… Toutes des choses que je ne pouvais pas vraiment faire en cabinet d’avocats! Et ce n’est qu’un début : j’ai hâte d’explorer la suite, que ce soit comme professeur de droit (je l’espère!) ou comme avocat au Barreau du Québec, pour mettre mon expertise au service de personnes et d’organisations qui mènent des actions en justice pour le climat. Je suis d’ailleurs très reconnaissant du soutien matériel et financier reçu pendant ma thèse. Sans cela, ce parcours n’aurait pas été possible.
Si je devais conclure sur une note d’espoir, ce serait la suivante : j’aspire à ce que mon travail de recherche contribue à renouveler notre compréhension des droits et libertés à l’ère de l’action pour le climat, et à renforcer leur pouvoir de protection au bénéfice des populations les plus vulnérables et leur environnement.
- Camille Martini
Université Laval
Camille Martini est doctorant au sein des facultés de droit de l’Université Laval et Aix-Marseille Université, sous la direction de Géraud de Lassus Saint-Geniès et Sandrine Maljean-Dubois, et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval. Il est boursier Vanier 2023, récipiendaire de la bourse d’excellence Réal-Décoste/Ouranos du FRQNT, et membre du programme Thèses de l’Agence française pour la transition écologique (ADEME). Avant de se dédier à temps plein à ses recherches de doctorat, Camille a pratiqué le droit international comme avocat aux barreaux de New-York et de Paris. Il a également enseigné le droit international économique et les litiges internationaux à l’École de droit de la Sorbonne. Il est membre du Centre d’Études et de Recherches internationales et communautaires (CERIC) et de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement de l’Université Laval.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre