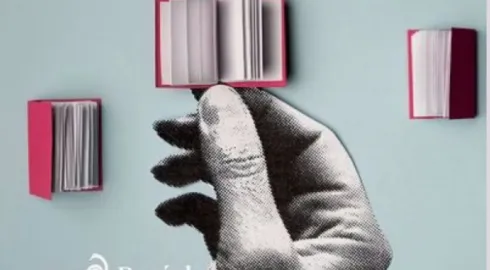Quand on conçoit ici un programme universitaire, on a tendance à se comparer d’abord aux meilleures universités américaines. Mais notre culture nous procure un accès constant à la France, et nous rapproche nécessairement des façons de faire britanniques et européennes. On est dans une situation assez unique de ce côté.

Solène Maillet : Professeur Paquin, vous venez tout juste de publier aux Presses de sciences de Paris un ouvrage intitulé Théories de l'économie politique internationale : cultures scientifiques et hégémonie américaine. Pouvez-vous d’abord nous décrire la nature de cette discipline?
Stéphane Paquin : L’économie politique internationale (EPI), telle qu’on la pratique aujourd’hui, est apparue au tournant des années 1970, aux États-Unis et en Grande-Bretagne simultanément. Ce ne sont pas des économistes qui en sont les initiateurs : aux États-Unis, ce sont des professeurs de sciences politiques, et en Grande-Bretagne, des historiens ou des politologues. La définition la plus citée de l’EPI est celle du professeur Robert Gilpin, selon qui cette discipline s’intéresse à « l’interaction réciproque et dynamique dans les relations internationales entre l’accumulation de la richesse et la poursuite de la puissance ».
Solène Maillet : Où étaient les économistes?
Stéphane Paquin : Cette absence d’intérêt s'explique par l'évolution de leur discipline. Dans les années 1950-60, ils sont de plus en plus quantitativistes. Centrés sur l’économétrie et satisfaits de leurs performances, ils se focalisent sur les déterminants de la croissance en politique intérieure, négligeant par le fait même les aspects internationaux. Puis, à partir des années 1970, le choc pétrolier, la crise de l'État providence, l’échec des politiques de relance associées au keynésianisme et la révolution des nouvelles technologies apporteront de l’eau au moulin de chercheurs de science politique, qui vont commencer à intégrer les enjeux économiques dans leurs réflexions sur la nature du système international. Dans les départements de sciences politiques, il faudra cependant attendre la fin de la guerre froide et la mondialisation massive de l'économie, à partir des années 1990, pour que le domaine s’installe définitivement, et ce, partout en Occident.
Solène Maillet : Si on revient aux années 1970, peut-on dire que c’est l’ébranlement de la puissance américaine qui fournira l’énergie de départ à cette discipline?
Stéphane Paquin : Tout à fait. En 1945, le PIB des États-Unis représentait 50 % du PIB mondial. Cependant, dès 1971, ils se sont retrouvés dans une situation de déficit commercial et leur pourcentage de l’économie mondiale déclinait rapidement. On craignait alors de plus en plus pour la stabilité du système international.
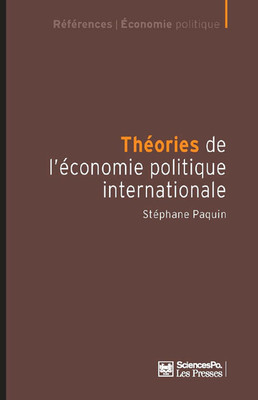
Charles Kindleberger publie en 1973 The World in Depression 1929-1939, où il avance de manière explicite que la cause fondamentale de la longue crise économique de 1929, c’est l'absence d’une puissance hégémonique dans le système international. En 1970, on craignait que le déclin des États-Unis, qui représentait la puissance hégémonique post-1945, ne provoque une nouvelle récession comme celle de 1929, voire un conflit mondial. C'est cette question de recherche qui amorce le débat au cœur de l’économie politique internationale. Ainsi, dans le sous-titre de mon livre, je parle de « culture scientifique et hégémonie américaine », car ce sont les débats au sujet du déclin et de ses effets sur le système international qui expliquent l’institutionnalisation de la discipline universitaire qu’est devenue l’EPI. Mais mon sous-titre a un double sens, car le livre explique également pourquoi la culture scientifique américaine a fait de la perspective américaine en EPI, la perspective dominante.
Solène Maillet : Comment évolueront les questions de recherche?
Stéphane Paquin : L’impact du déclin sera perçu par les Canadiens et les Britanniques de manière très différente des Américains, et diverses écoles de pensée en émergeront.
La plupart des auteurs américains, libéraux ou réalistes, sont convaincus du déclin de leur pays à partir des années 1970. Alors que les Britanniques et les Canadiens soutiennent que cette nation est toujours, et ce, même dans les années 1990 et 2000, la première puissance mondiale, et de loin. Pour la Britannique Susan Strange, par exemple, le problème premier n'est pas le déclin, c’est plutôt le refus de l'élite américaine de remplir son rôle de leader mondial et d'assumer une partie plus importante du bien commun qui est l'enjeu. Le problème n’est pas tant la puissance américaine que le refus de l’élite de s’en servir dans le sens du bien commun.
Solène Maillet : Comment évoluera l’école américaine?
Stéphane Paquin : Elle adoptera les codes et la culture des économistes. Les auteurs américains sont de fait très massivement positivistes et favorables à la « théorie des choix publics » dans leur explication du monde. Fortement axés sur l'individualisme méthodologique, ils proposent des recherches centrées sur les actions des individus et faisant appel à l'utilisation des méthodes quantitatives. Parmi les principales publications des dernières années aux États-Unis, par exemple, plus de 90 % des articles parus dans les revues importantes font mention de l'usage des méthodes quantitatives. En Grande-Bretagne et au Canada, ce n'est absolument pas le cas. Globalement, ces deux pays préfèrent les méthodes historiques et sociologiques, et leurs analyses sont très descriptives et qualitatives. Leurs thèmes de recherche sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus ambitieux. Ils portent sur les relations entre « l’État et le marché » ou sur la finance internationale, alors que les Américains s’intéressent aux coalitions de vote à l’OMC ou aux négociations commerciales avec des cas bien précis.
Solène Maillet : J’imagine que cela doit se refléter dans la formation universitaire?
Stéphane Paquin : Tout à fait. Les Américains forment des chercheurs en science politique de plus en plus près des économistes. Alors qu’en Grande-Bretagne et au Canada, tout comme en Europe continentale d’ailleurs, la formation vise l’étude des enjeux économiques certes, mais en utilisant les outils de la sociologie, de la science politique, de l’histoire et même de l'anthropologie et de la géographie. Les écoles se sont écartées jusqu’à aboutir littéralement à un dialogue de sourds entre elles.
Les Américains forment des chercheurs en science politique de plus en plus près des économistes.
Solène Maillet : Qu'est-ce qui peut expliquer ces écarts?
Stéphane Paquin : Prenons le cas de la Grande-Bretagne. Les départements de relations internationales de Cambridge, d’Oxford et même de la London School of Economics émanaient à l'origine des départements d'histoire, très largement multidisciplinaires. Partant de cette culture scientifique, il était aisé d’imaginer un département d'études internationales réunissant des économistes, des sociologues, des historiens et des politologues.
Aux États-Unis, à partir de la révolution béhavioriste et de celle des quantitativistes, l'intégration massive des outils mathématiques dans les départements d'économie finira par contaminer les départements de sciences politiques. Ainsi, les chercheurs américains de l'économie politique internationale, même s’ils sont généralement formés en sciences politiques, sont très forts en méthodes quantitatives. Celles-ci constituent même un préalable pour un jeune étudiant d’Harvard ou de Yale, qu’on oblige à intégrer les outils de ces méthodes dans ses analyses. Si vous lisez leurs publications, vous y noterez une multitude de cas (large-N analysis) appuyés par des méthodes pouvant s’appliquer tout aussi bien à la microbiologie. Par exemple, une des thèses fortes des dernières années aux États-Unis, c'est l'idée que deux démocraties ne se font jamais la guerre. Pour démontrer cela, on prend tous les conflits, on détermine si les régimes sont démocratiques, puis on effectue des régressions linéaires. Bref, on utilise les outils statistiques importés des sciences de la nature. Même si les universités américaines sont toujours les plus prestigieuses au monde, il reste que la plupart des autres pays n'ont pas pris ce tournant positiviste. En Grande-Bretagne, on rejette même cette façon de concevoir les sciences sociales. Au Canada cependant, de moins en moins.
Solène Maillet : Quels sont donc les effets de cette « école américaine »?
Stéphane Paquin : Ils sont très importants parce que ce sont les Américains qui, encore aujourd'hui, déterminent ce qu’est le professionnalisme en sciences sociales, et ce, à l’échelle mondiale. De plus en plus, les organismes subventionnaires du Canada, mais aussi peu à peu ceux d'Europe, cherchent à imiter les Américains. Les formations universitaires tendent à reproduire ce qui se fait dans les grandes universités américaines. La tendance, très claire déjà au Canada, et qui se dessine en Europe, est de s'approcher du modèle américain. Encore une fois, l'hégémonie américaine influence les milieux universitaires et nos manières de penser le monde.
Des chercheurs américains ont fait des sondages auprès de leurs collègues un peu partout dans le monde pour connaitre les auteurs de référence, les livres les plus utiles, ou encore, les revues les plus prestigieuses. Eh bien, presque systématiquement, quand il est question des spécialistes en relations internationales, les auteurs, les revues et les livres américains dominent sans partage. Les Américains sont-ils 10 ans en avance sur nous ou, au contraire, sont-ils en train de se marginaliser dans cette façon de concevoir les sciences sociales à partir des méthodes des sciences de la nature?
Solène Maillet : Du côté des universités québécoises, qu’en est-il de cette discipline?
Stéphane Paquin : On peut faire une distinction entre les universités anglophones et les francophones. McGill se situe très clairement à l’intérieur du paradigme américain. Concordia, plus proche des Canadiens et des Britanniques, est plus critique face aux Américains. Les universités francophones n'ont pas encore une culture d'économie politique internationale très développée. Elle en est à ses débuts et les professeurs sont encore assez jeunes.
Vivant dans les marges de l’empire américain, l'économie politique internationale subit cette attraction. De nombreux auteurs réfléchissent d’ailleurs à cette dépendance découlant du fait que plus de 75 % de nos exportations vont vers ce seul pays. Quand on conçoit ici un programme universitaire, on a tendance à se comparer d’abord aux meilleures universités américaines. Mais notre culture nous procure un accès constant à la France et nous rapproche nécessairement des façons de faire britanniques et européennes. On est dans une situation assez unique pour ça. Un peu entre deux chaises.
- Entretien avec Stéphane Paquin, École nationale d’administration publique, réalisé par Solène Maillet, Université de Montréal
Stéphane Paquin (docteur de Sciences Po Paris) est professeur à l’École nationale d’administration publique (ENAP) au campus de Montréal, où il est le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée. Il est également codirecteur de la collection « Politique mondiale » aux Presses de l’Université de Montréal. Il est président du comité local d’organisation du Congrès mondial de sciences politiques qui aura lieu à Montréal en 2014. Stéphane Paquin a également été professeur agrégé à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, visiting predoctoral fellow au Département de science politique de l’Université Northwestern de Chicago, maître de conférences à Sciences Po Paris et directeur général par intérim de l’Association internationale de science politique (International Political Science Association). Il a publié neuf livres dont, en 2013, Les théories de l’économie politique internationales. Ses autres publications sont : Cultures scientifiques et hégémonie américaines (Paris, Presses de Sciences Po), International Policy and Politics in Canada (Toronto, Pearson Canada, 2010) et Politique internationale et défense au Canada et au Québec (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2007) avec Kim Richard Nossal et Stéphane Roussel ; Économie politique internationale (2e éd., Paris, Montchrestien, 2009) et La nouvelle économie politique internationale. Théories et enjeux (Paris, Armand Colin, 2008). Il a codirigé neuf livres dont Introduction aux relations internationales (Montréal, Chenelière Éducation, 2009) avec Dany Deschênes et Mastering Globalization : New Sub-States’ Governance and Strategies (Londres, Routledge, 2005) avec Guy Lachapelle.En plus d’avoir obtenu de nombreuses bourses (Fulbright, CRSH, FQRSC, PIERAN), il a publié environ soixante articles dont plusieurs dans des revues scientifiques comme International Journal, The Hague Journal of Diplomacy, Nationalism & Ethnic Politics, Revue canadienne de science politique, Études internationales, Revue canadienne d’administration publique, Revue internationale de politique comparée et Guerres mondiales et Conflits contemporains.
Solène Maillet est doctorante en cotutelle avec l’Université de Montréal et l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) de Paris. Après un parcours interdisciplinaire en langues, études culturelles et sciences politiques, elle s’intéresse désormais à l’histoire contemporaine des relations internationales, notamment entre la France et les pays du monde arabe. Ses travaux de master portaient sur les politiques coloniales et les nationalismes émergents au Maroc sous protectorat français et au Liban sous mandat français.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre