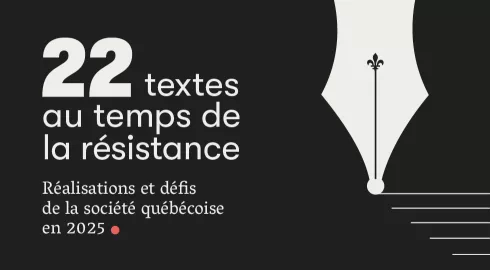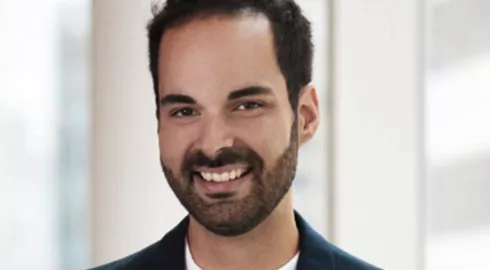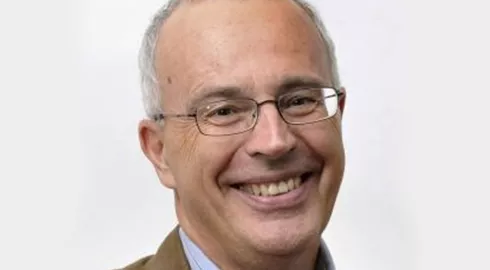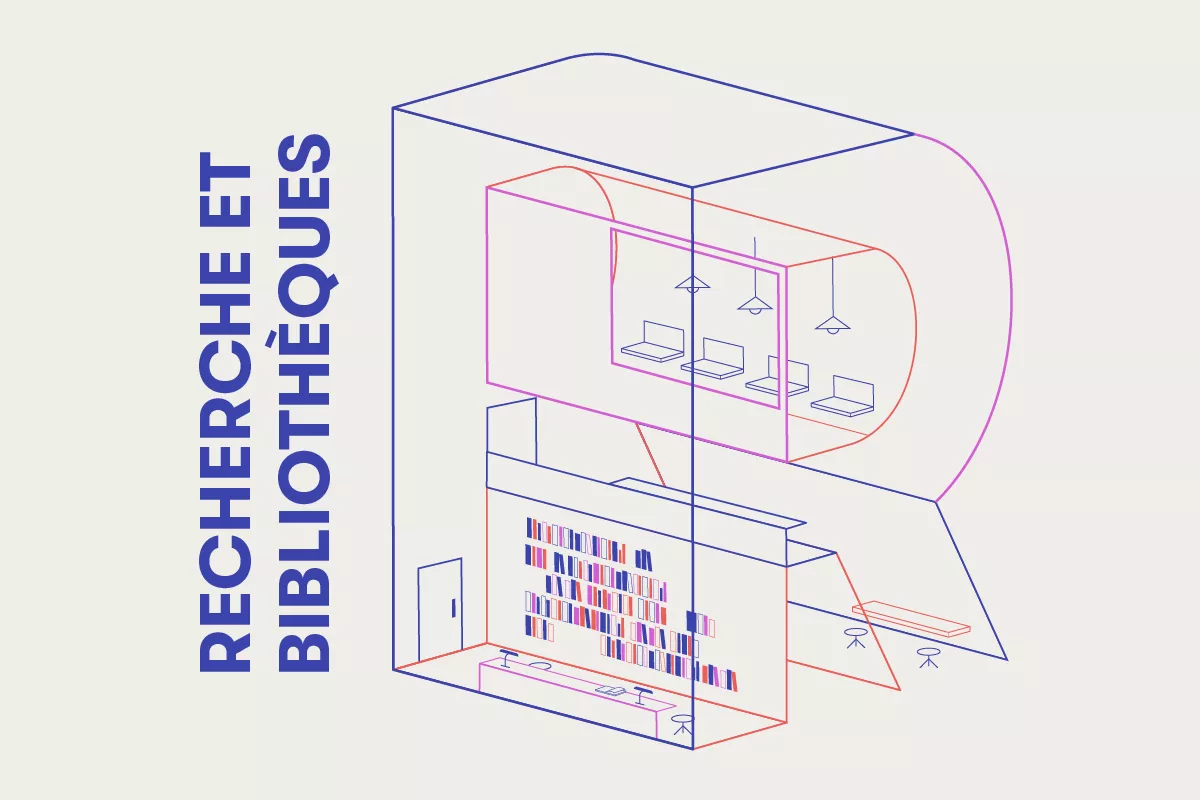J’apprécie tout particulièrement l’université pour le rôle qu’elle peut jouer dans l’amélioration des conditions socioculturelles et économiques non seulement des étudiant·es, mais aussi plus largement de toutes les communautés.
Quelles sont vos principales responsabilités ?
David Patenaude : Je suis bibliothécaire responsable des disciplines Criminologie et Travail social à l’Université de Montréal. Dans le cadre de mes fonctions, j’assure principalement des formations dans les cours de méthodologie de recherche. En quelques heures, je familiarise les étudiant·es avec les services et ressources des bibliothèques ainsi que la recherche documentaire. Je propose également des formations au Centre international de criminologie comparée (CICC), affilié à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, et je collabore souvent avec leur équipe pour différents projets.
J’offre par ailleurs du soutien ponctuel aux étudiant·es de l’École de criminologie et de l’École de travail social, tout comme aux chercheur·euses. Plus concrètement, j’aide les uns et les autres à réaliser leurs recherches documentaires, en particulier pour les projets de synthèses de connaissances, qui sont souvent des recensions systématisées très rigoureuses et structurées au moyen de méthodologies spécifiques. Je les conseille et j’agis parfois à titre de co-auteur.
Enfin, au sein de la bibliothèque, je collabore avec l’équipe de gestion des collections de criminologie et de travail social. Je sélectionne notamment les nouvelles monographies et j’évalue les titres à pérenniser ou à retirer.
Qu’est-ce qui vous a motivé à choisir la profession de bibliothécaire ?
David Patenaude : J’ai toujours été très curieux de nature et j’aime la connaissance, l’apprentissage et le développement de soi, tant sur le plan personnel que professionnel. Travailler dans le milieu universitaire me donne l’occasion de participer à la formation de la relève et de contribuer à la production des savoirs avec la communauté de recherche dans mes disciplines. J’apprécie tout particulièrement l’université pour le rôle qu’elle peut jouer dans l’amélioration des conditions socioculturelles et économiques non seulement des étudiant·es, mais aussi plus largement de toutes les communautés. Le rôle de bibliothécaire en milieu universitaire comporte une diversité de fonctions, souvent pour des projets sortant de la routine. Par exemple, je peux proposer de nouvelles formations sur le soutien à la recherche au Centre international de criminologie comparée, sur le libre accès ou sur la gestion de données de recherche. Anecdote : j’ai interviewé la célèbre drag queen Barbada dans le cadre de l’événement Mise en valeur des sexualités en contexte universitaire : enjeux et perspectives, à l’automne 2023! Au final, c’est très gratifiant et stimulant de pouvoir jouer un rôle dans la réussite de projets éducatifs, voire de projets de vie, des étudiant·es, tout en participant à la recherche en criminologie et en travail social.

Comment contribuez-vous aux projets de recherche dans votre établissement ?
David Patenaude : Je joue présentement le rôle de co-auteur dans un projet d’examen de la portée (scoping review) des services d’art-thérapie offerts aux communautés autochtones. J’ai aidé à définir les objectifs du projet et la question de recherche, en tenant compte de la faisabilité de la recherche documentaire. Dans ce contexte, je suis responsable d’élaborer la stratégie de recherche, de la traduire dans les bases de données et d’importer les résultats pour l’ensemble de l’équipe. Je forme les chercheur·euses et les auxiliaires de recherche à l’utilisation de ressources telles qu’Endnote, Zotero et Covidence, utilisées pour le projet.
J’offre par ailleurs des services-conseils pour les questions liées à l’information et à la documentation en recherche et en enseignement. Par exemple, je rencontre parfois les chercheur·euses pour leur expliquer ce qu’est un plan de gestion de données de recherche et leur fournir des exemples, afin qu’ils puissent se conformer aux exigences des organismes subventionnaires au moment de préparer une demande d’aide financière.
Finalement, j’informe les chercheur·euses sur les questions de diffusion de leurs travaux, notamment sur la publication en libre accès. Ainsi, on me demandera mon avis sur la réputation de tel ou tel éditeur, ou sur les risques de rencontrer un éditeur prédateur. Je reçois aussi des demandes concernant les frais de publication imposés par les éditeurs (article processing charges), qui sont souvent prohibitifs, et sur les façons de les contourner, par exemple en publiant chez un éditeur qui offre un rabais aux bibliothèques de l’UdeM.
Quels en sont les défis et les opportunités de votre métier ?
David Patenaude : Nos contributions doivent s’adapter aux développements en recherche d’information, ainsi qu’à l’évolution des comportements informationnels de la communauté universitaire et scientifique. Par exemple, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle générative (IAg), on constate que les étudiant·es s’approprient graduellement les outils de génération de contenus tels que ChatGPT, et donc qu’ils cherchent et traitent l’information autrement que par des méthodes traditionnelles. En formation, on doit désormais miser davantage sur l’évaluation des sources et la compréhension du fonctionnement des outils d’IA. Au-delà de l’aspect pratico-pratique, il est essentiel de nourrir la pensée critique dans nos communautés afin d’assurer la maîtrise de ces nouvelles ressources. En développant les collections, par exemple, il m’est arrivé de tomber sur une monographie publiée par une maison d’édition scientifique réputée qui avait été entièrement rédigée par IAg. De telles situations me poussent à revoir ma pratique quant aux critères de sélection des ouvrages. De plus, la pandémie de COVID-19 a régularisé les vidéoconférences comme moyen de formation, ce qui nous oblige à repenser notre approche pédagogique afin de l’adapter à cette réalité, alors que les présentations magistrales ou les ateliers en présentiel étaient la norme auparavant.
Un défi important est de rester à l'affût des nouveaux outils et des contextes toujours en évolution, de comprendre leur fonctionnement et les impacts sur notre milieu. Les modèles d’IAg, en particulier, changent très rapidement. Toutefois, cette réalité met à profit notre expertise en tant que spécialistes de l’information qui évaluent ces nouvelles données et pratiques, et qui peuvent ainsi conseiller et former nos communautés sur une utilisation optimale, éthique et critique des ressources. L’information étant au cœur de la recherche et de la formation, les bibliothécaires universitaires auront toujours un rôle essentiel à jouer dans leur milieu.

- David Patenaude
Université de Montéal
David Patenaude est bibliothécaire pour les disciplines Criminologie et Travail social à l’Université de Montréal depuis 2020. Il détient une maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal (2020), un baccalauréat en travail social de l’Université Laval (2014), ainsi qu’un baccalauréat en traduction de l’Université de Montréal (2008).
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre