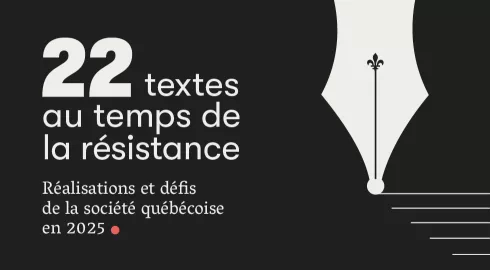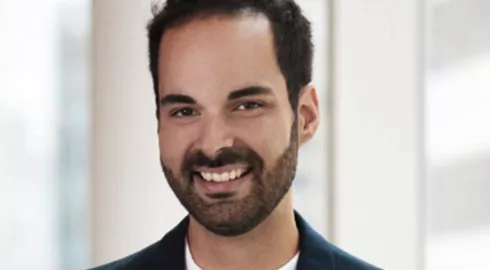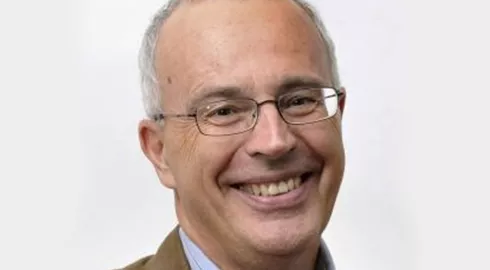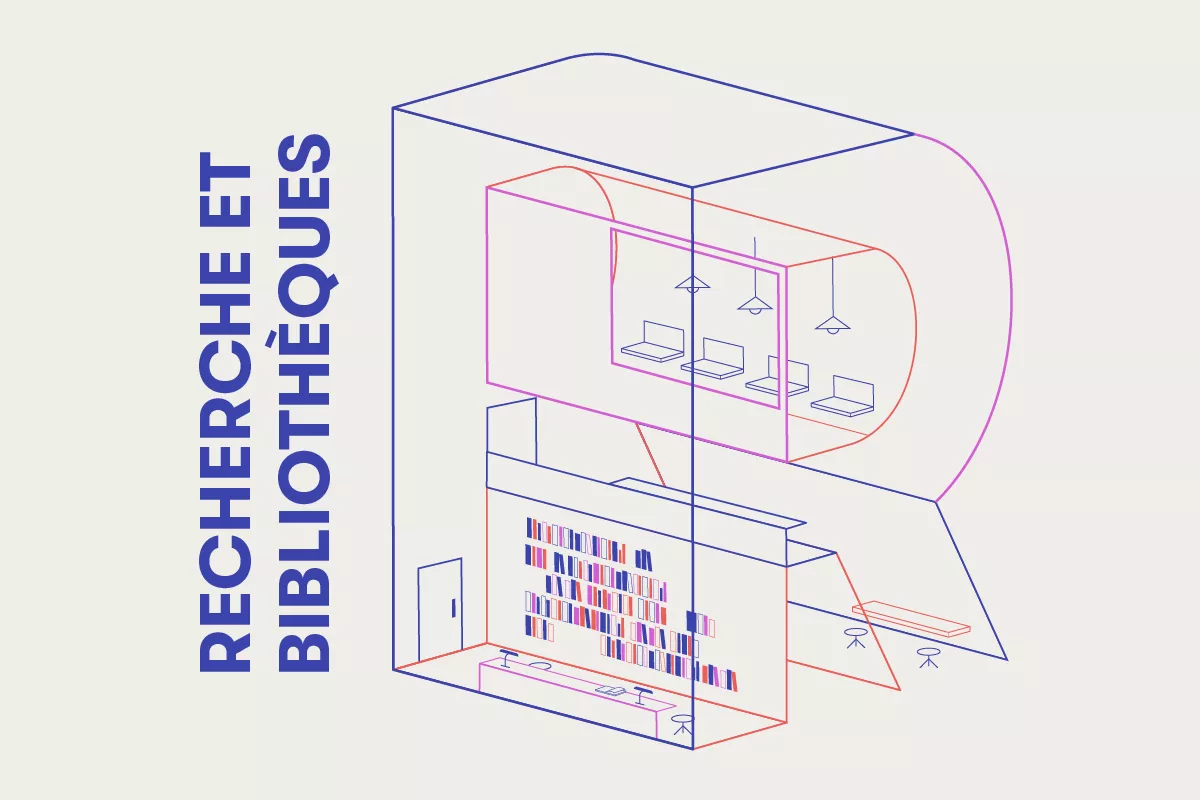Depuis le début de leur existence, les bibliothèques universitaires soutiennent les activités de recherche et d’enseignement. Les bibliothèques universitaires québécoises ne font pas exception à cette noble mission. Il est évident que les services et les manières ont changé, mais les bibliothèques québécoises trouvent toujours le moyen d’innover pour soutenir la recherche et sa diffusion. Une rétrospective des quelque cinquante dernières années de collaboration entre les bibliothèques universitaires du Québec nous permettra d’affirmer que le soutien à la recherche reste au cœur de leurs initiatives.
Une révolution pas si tranquille
La Révolution tranquille a eu beaucoup d’impact sur l’accès aux études universitaires – autrefois réservées à l’élite – , notamment par la création des différentes composantes de l’Université du Québec, dès la fin des années 1960. Pendant cette période, le nombre de publications savantes augmente significativement, bien que les budgets des bibliothèques universitaires demeurent limités1. Devant ces défis de taille, les directions de bibliothèques universitaires se rencontrent formellement dès 1967 pour former éventuellement le sous-comité des bibliothèques de la CRÉPUQ2 en 19723, ancêtre de l’actuel Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ).
Ces années sont fructueuses en réflexion et en propositions de coopération, car les différents penseurs et décideurs considèrent les bibliothèques comme des institutions de recherche. Elles collaborent entre elles pour maximiser leurs ressources et leurs collections respectives. Dès 1969, elles développeront leurs collections afin de servir les chercheurs de toute la province3.
C’est en reconnaissant l’importance de ces collaborations qu’est lancé, en 1969, le PEBUQUILL, un système de prêt entre bibliothèques (PEB) offrant un service quotidien de livraison. Cette initiative, innovante pour l’époque, démontre bien le désir des bibliothèques de desservir efficacement leur communauté4. Les initiatives de concertation, de collaboration, de coopération et de coordination seront nombreuses et variées dans les années 1970 et 1980 : par exemple, le traitement documentaire en coopération (UNICAT/TELCAT) et le privilège d’emprunts pour tous les membres de la communauté universitaire québécoise, et ce, sans frais5. Aussi, il ne faut pas oublier la compilation concertée de statistiques qui demeure une des activités centrales du sous-comité des bibliothèques, même à ce jour.
La révolution numérique
Au début des années 1990, les ressources documentaires en format numérique n’en sont qu’à leurs balbutiements, mais force est de constater que ces nouvelles modalités permettent d’aller encore plus loin dans la mise en commun des expertises et des ressources. Dès 1998, à l'avenant de ce qui a cours au Canada, en Amérique du Nord et dans d’autres consortiums, des achats en commun sont pris en charge par l’équipe permanente du sous-comité des bibliothèques, atteignant un total de plus de 16 millions de dollars au début des années 20206.
Nos prédécesseurs n’ont pas chômé et dès le début des années 2000, ils réfléchissent déjà à bonifier l'offre de service du réseau des bibliothèques universitaires en mettant en place un dépôt commun des publications de recherche. Cependant, cette initiative ne vit pas le jour par manque de financement et pour cause d’une faible adhésion de la part des membres du sous-comité et des autres parties prenantes. À la suite de nombreuses consultations, les bibliothèques universitaires du Québec (BUQ) ont quand même réussi à mettre en place un système informatisé pour le prêt entre bibliothèques (PEB) en 20077.
Place à la plateforme partagée de services (PPS)
Au début des années 2010, les solutions informatiques en infonuagique pour la gestion des activités des bibliothèques – dont l’accès facilité aux ressources numériques – suscitent beaucoup d’intérêt auprès des BUQ. Elles se lancent donc dans un projet d’envergure, soit la mise en place d’une infrastructure technologique collective. Grâce à une structure de gouvernance bien réfléchie, les personnes à la direction des bibliothèques tentent leur chance pour l’obtention d’un financement dans le cadre de la stratégie numérique du gouvernement québécois. Un financement de 10,4 millions est accordé pour le projet. L’interface de recherche Sofia est lancée officiellement en juillet 2020. Cette initiative unique au Canada offre un outil de recherche uniformisé que l'on retrouve dans toutes les BUQ7.
On peut dire que la plateforme partagée de services a permis aux bibliothèques de collaborer à un niveau inégalé. Cet écosystème technologique commun facilite grandement l’accès aux connaissances : à l’outil de découverte Sofia, se sont ajoutés, entre autres, les plateformes GéoIndex et Géophotos. L'écosystème favorise également la diffusion et la préservation des résultats de recherche à travers Borealis et Scholaris, des initiatives de Scholar’s Portal7.
La mutualisation a aussi permis au regroupement des BUQ de contribuer financièrement à des projets collaboratifs visant la mise en valeur des contenus francophones, tels que le Programme francophone des autorités de noms (PFAN) et l’accès libre au répertoire des vedettes-matières (RVM). Par ailleurs, plusieurs autres initiatives ont été menées par les groupes de travail durant cette période d’effervescence au sein des BUQ.
La création du Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ)
Le nouvel environnement technologique des BUQ répond bien aux besoins de l’enseignement et de la recherche. Cependant, les technologies étant en évolution rapide, les bibliothèques sont toujours confrontées à des enjeux de ressources limitées. Il était donc essentiel de continuer d’agir en synergie, tout en développant des pratiques efficaces et créatives.
Il demeurait donc primordial pour les BUQ de pérenniser une structure commune, stable et agile, pour continuer et maintenir les avancées durement gagnées. Les besoins d’avoir une équipe de permanence et de gestion matricielle – groupes de travail et comités composés du personnel des établissements membres – sont alors évoqués parmi les intervenant·es. Ces besoins sont cependant difficilement réconciliables au sein de la structure de gouvernance des universités québécoises qu’est le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). De ce fait, les chefs des établissements universitaires qui y siègent ont opté pour la formalisation du PBUQ en juin 2022, et à son rattachement à un mandataire, l’Université de Montréal, en septembre 20237.
En conclusion
Riche de ses deux premiers exercices de planification stratégique (2020-2023 et 2024-2027), nous pouvons dire que le PBUQ se positionne avec pertinence au sein de l’écosystème de la recherche pour soutenir les activités scientifiques, et tout particulièrement les publications, avec, entre autres, la nouvelle initiative du Réseau Circé, dédié au soutien de la publication de revues savantes en français et en libre accès « diamant ».
Au fil des décennies, les moyens pour accomplir la mission des partenariats réunissant les bibliothèques universitaires québécoises ont beaucoup évolué. Mais depuis les débuts du sous-comité des bibliothèques universitaires de la CRÉPUQ, il y a plus de 50 ans, et jusqu’à aujourd’hui, l’esprit est toujours le même. En effet, le PBUQ est tout aussi engagé aujourd’hui à renforcer le rôle de plus en plus stratégique des bibliothèques universitaires comme partenaires essentiels de la réussite étudiante, de l’excellence en recherche, de la promotion de l’éducation ouverte et du rayonnement de la science ouverte.
Lors de la célébration du 25e anniversaire du sous-comité des bibliothèques en 1992, il y avait plus d’une vingtaine de groupes de travail réunissant une centaine de professionnels; leur souhait était que ce regroupement de bibliothèques soit encore plus solidaire au cours des 25 années suivantes… Quelque 33 ans après cet anniversaire, nous pouvons dire que nous sommes de fait plus solidaires que jamais dans notre soutien à la recherche réalisée au sein de nos universités.
Bibliographie
- Ayoub, M. (2017) Entre autonomie et coopération : La construction des bibliothèques universitaires au Québec (1967-1975). [mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. http://hdl.handle.net/1866/19071
- Beaudy, G. (2025). Les bibliothèques universitaires du Québec et le sous-comité des bibliothèques (1992-2023) : un parcours vers la mutualisation. Dans R. Savard (dir.) Les bibliothèques universitaires : à l’heure des bilans. Les Éditions de l’Asted.
- Brault, J.-R. (1988). Les bibliothèques universitaires du Québec, 1980-1986. Documentation et bibliothèques, 34(3), 103–106. https://doi.org/10.7202/1052487ar
- Brault, J.-R. (1993). Les bibliothèques universitaires du Québec : 25 ans de coopération. Documentation et bibliothèques, 39(3), 141–152 https://doi.org/10.7202/1028749ar
- Delorme, S. (2008). Les bibliothèques universitaires québécoises : retour vers le futur. Documentation et bibliothèques, 54(2), 81–86. https://doi.org/10.7202/1029314ar
- Dufour, A. (2003). Quebec’s Education Revolution. The Beaver, Aug-Sep (2003), 6-7. https://www.canadashistoryarchive.ca/canadas-history/the-beaver-aug-sep-2003/flipbook/6/
- Dumont, R., Ghaouti, L. & Séguin, B. (2022). De la coopération à la mutualisation : naissance d’un partenariat au sein du réseau des bibliothèques universitaires du Québec. Documentation et bibliothèques, 68(3), 15–23. https://doi.org/10.7202/1092262ar
- Dupuis, O. (1977). Dix ans de coopération entre les bibliothèques universitaires du Québec : un bilan. Documentation et bibliothèques, 23(3), 143–150. https://doi.org/10.7202/1055227ar
- Dupuis, O. (1992). Les bibliothèques universitaires québécoises : un anniversaire. Documentation et bibliothèques, 38(1), 3–3. https://doi.org/10.7202/1028556ar
- Goulet, M.-A. & Allnutt, V. (2014). Les bibliothèques universitaires : crise ou métamorphose ? Documentation et bibliothèques, 60(1), 3–5. https://doi.org/10.7202/1022857a
- Greene, R. (1993). Au Nord et au Sud : même combat pour l’accès aux documents. Documentation et bibliothèques, 39(3), 165–167. https://doi.org/10.7202/1028752ar
- LeBlanc, J.-J. (1976). Coopérer... ou périr ? Documentation et bibliothèques, 22(3),113–121. https://doi.org/10.7202/1055313ar
- Rousseau, D., Dupont, L., Houyoux, P. & Joanis, M. (1992). La concertation du développement des collections : les bibliothèques universitaires québécoises et le NCIP. Documentation et bibliothèques, 38(1), 25–33. https://doi.org/10.7202/1028559ar
- 1
Ayoub, 2014.
- 2
Notice Wikipédia, consultée le 20 mai 2025 : « Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) - anciennement dénommé Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) - est une organisation sans but lucratif (OSBL) privée qui regroupe, sur une base volontaire, tous les établissements universitaires québécois. La mission du BCI est de favoriser les échanges entre les administrateurs universitaires autour de projets communs et de leur donner accès à des services en matière d'enseignement, de recherche et de gestion. »
- 3a3b
Dupuis, 1992.
- 4
Dupuis, 1977.
- 5
Brault, 1993.
- 6
Beaudry, 2025.
- 7a7b7c7d
Dumont, 2022.
- Alexandra Houde
Le Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ)
Bibliothécaire universitaire depuis plus d'une vingtaine d'années, Alexandra Houde a toujours eu à cœur le travail en collaboration. En effet, dès le début de sa carrière comme bibliothécaire aux ressources électroniques à la direction des collections des bibliothèques de l'Université de Montréal, elle a été sensibilisée aux initiatives canadiennes et québécoises quant à la mise en commun pour l'achat de ressources électroniques. Elle a ensuite pratiqué son métier avec vigueur au cours des années dans les services d'acquisitions, de traitement documentaire et à la direction des collections, et ce toujours à l'Université de Montréal. En 2017, Alexandra a ouvert ses horizons en occupant le poste d'agente principale de contenu des licences au RCDR (Réseau canadien de documentation pour la recherche). À partir de 2018, elle a participé à l'implantation de la plateforme partagée de service (PPS), projet phare du sous-comité des bibliothèques du BCI (ancêtre du PBUQ) au service de traitement de documentaire et métadonnées de l'Université de Montréal pour ensuite y prendre le poste de cheffe de service en 2019 jusqu'en juin 2023 où elle devient la première directrice du PBUQ.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre