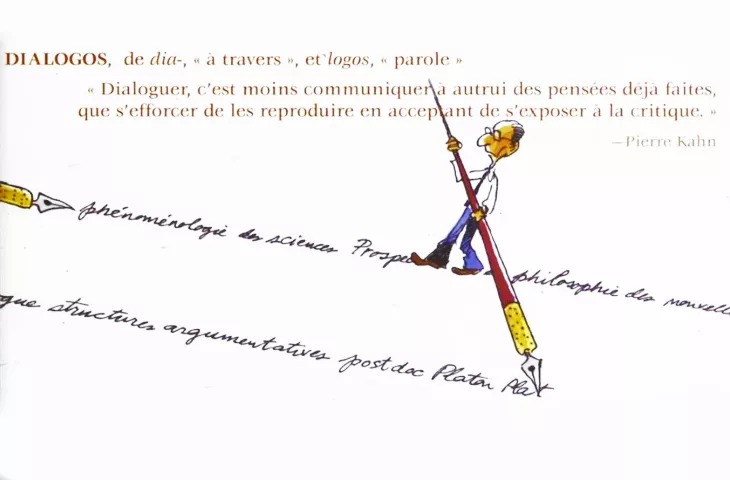Relire un article de jeunesse1 et le resituer dans son contexte historique me donne l’occasion de retrouver des réflexions qui ne m’ont jamais vraiment quittée, même si après ma thèse de doctorat, je n’ai pas poursuivi mes recherches dans le champ de la sociologie de la science, et que ma carrière de chercheure universitaire et de psychanalyste m’ait conduite vers d’autres horizons d’interrogation.
- 1Isabelle Lasvergnas-Grémy, « Où sont passées les femmes de sciences? », Les Cahiers de l’Acfas, no 22, 1983, p.30 – https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2828093?docref=L3YQ5cNaDRI73tlbYfXJ5Q&docsearchtext=2-89245-013-6-X

Retour sur mes travaux
Les statistiques compilées sur la période 1960-1975 pour rendre compte de la présence féminine dans les universités québécoises reflètent une réalité historique aujourd’hui dépassée. Néanmoins, elles conservent leur pleine pertinence en nous permettant de mesurer l’ampleur du chemin parcouru en six décennies par les femmes et par la société en général, du moins occidentale. Plus particulièrement, ces données témoignent du remaniement culturel d’une société québécoise alors en profonde mutation et dans laquelle les universités francophones, au début des années 1960, étaient caractérisées par les éléments suivants :
- Un retard historique marqué du développement de l’ensemble du secteur scientifique par rapport à l’Université McGill.
- Une quasi-absence des femmes étudiantes et professeures-chercheures en sciences fondamentales (mathématiques, physique, chimie, biologie, biochimie, neurosciences) ainsi qu’en génie, géologie et sciences de la Terre, où elles n’étaient qu’une poignée1, alors qu’elles étaient à peine plus nombreuses en médecine, médecine dentaire et pharmacie. Comme beaucoup d’autres secteurs professionnels, l’univers des sciences « pures » et appliquées était clairement masculin.
- Cette barrière structurelle avait été rigidifiée par deux facteurs : d’une part, dans les universités francophones, jusque dans les années 1950, les jeunes femmes n’avaient pas accès à ces facultés et départements, et d’autre part, pendant leurs études secondaires, très peu d’adolescentes québécoises avaient eu accès au « cours classique », condition sine qua non à l’époque pour entrer à l’université.
Au début des années 1980, les femmes étaient encore minoritaires à tous les niveaux de la hiérarchie universitaire. Nombre d’entre elles, compte tenu aussi de leur statut de femmes alibis, parlaient d’un profond sentiment d’isolement.
En 2024, deux générations plus tard, les femmes ont pratiquement atteint le cap de l’égalité avec les hommes en matière d’obtention de diplômes de premier et deuxième cycle dans les disciplines scientifiques, et notamment dans les facultés de médecine – où les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants. De même, leur présence est quasi à 50 % au sein du corps professoral universitaire ainsi que dans les postes d’administration de haut rang (décanats, vice-rectorats et rectorats) dans toutes les universités québécoises et canadiennes2.
Si je devais reprendre aujourd’hui, à titre de directrice de recherche, l’étude de la place des femmes dans la science au Québec et au Canada, le focus principal ne serait pas la progression statistique incontestable de leur présence dans l’ensemble de la hiérarchie universitaire, celle-ci n’étant qu’une des facettes d’un long processus de rattrapage égalitaire. Se contenter de ces seuls indicateurs chiffrés pourrait être trompeur. En effet, tout comme dans les hautes sphères du pouvoir politique ou économique, les femmes scientifiques se heurtent encore au phénomène d’un plafond de verre en matière de visibilité scientifique et de juste reconnaissance de leurs contributions à l’avancement des savoirs.
En ce sens, je repartirais, à titre d’un corpus d’hypothèses qui devraient être systématiquement vérifiées, de ce que j’estime être un des résultats les plus importants de mon étude par questionnaire menée en 1979-1980 auprès d’un très large échantillon de chercheurs et chercheures dans l’ensemble des universités québécoises3. Dans un article publié en 1981, deux schémas graphiques synthétisaient les modalités très différentes dont les hommes et les femmes s’inséraient dans les réseaux de la communication scientifique, notamment internationale4. Je postulerais que ces résultats sont encore assez largement actuels.
Le monde de la science est un sous-système culturel avec ses lois propres de fonctionnement interne (Robert K. Merton, 1947, 1952, 1973; Yves Gingras, 2013)5. L’impératif Publish or Perish de cet univers hautement spécialisé et fort compétitif est bien connu. À ceci près que la seule comptabilité des articles publiés n’est pas suffisante pour rendre compte des écarts en recherche entre les hommes et les femmes. L’importance attribuée à un chercheur ou une chercheure dans le discours de la science se mesure à l’aune de la cote de prestige des revues spécialisées dans lesquelles ils ou elles publient, du nombre de citations dont ces articles feront l’objet, du nombre de leurs conférences dans des rencontres scientifiques de haut niveau, et plus globalement, de leur présence dans les réseaux nationaux et internationaux de la communication spécialisée, et enfin, des distinctions scientifiques reçues (prix, etc.)6.
La question de la citation des publications et des résultats de recherche est cruciale. L’historienne des sciences Margaret W. Rossiter a forgé l’expression « effet Matilda » pour décrire le phénomène de minimisation récurrente, voire carrément parfois de spoliation, de la contribution des femmes à la recherche scientifique7. L’histoire des sciences est pavée de découvertes faites par des femmes et qui ont été ignorées d’abord, puis que des hommes se sont appropriées. Paradigmatique à cet égard, est le cas tragique de la physicochimiste britannique Rosalind Franklin, dont les résultats de recherche en cristallographie, volés après effraction dans son laboratoire alors qu’elle était hospitalisée et mourante, furent déterminants dans la démonstration de la structure en double hélice de la molécule de l’ADN, et contribuèrent à l’attribution du prix Nobel en 1962 à Dewey Watson et Francis Crick. Ceux-ci publièrent leurs travaux sans citer ni le nom ni la contribution majeure de leur collègue dans cette avancée. Ce cas très documenté appartient à la face cachée de la conquête scientifique et de la gloire qui en découle. Plusieurs historiennes des sciences, dont Rossiter (op.cit.), ont montré que cette tendance à l’occultation de la contribution des femmes scientifiques est systémique : les femmes sont moins visibles parce que systématiquement moins citées que leurs collègues masculins.
On connaît, en termes de prestige scientifique, l’effet exponentiel d’un cumul des citations par les pairs ainsi que par les jeunes chercheurs de niveau postdoctoral et les candidats au doctorat. De façon générale, les femmes sont également moins reconnues dans le cas de recherches simultanées ou conjointes, où, bien souvent, le principal, sinon le seul nom retenu dans les citations, références bibliographiques et in fine dans la transmission des connaissances sur le plan de l’enseignement, sera celui du chercheur masculin (Rossiter, ibid.). À souligner que ce biais discriminatoire n’est pas le seul effet d’un « boys club » aveugle à lui-même, même s’il en participe. Il relève d’une attitude de fond dont les femmes, à leur insu, sont souvent encore partie prenante de par leur adoption assez spontanée de la position de l’élève ou du disciple.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que la science est un univers fortement hiérarchisé, source d’un pouvoir symbolique très important et désirable quant à la notoriété publique qui pourra en découler (Robert K. Merton, op.cit.; Pierre Bourdieu, 1984; Yves Gingras, 20208). Seuls quelques esprits en dehors de la moyenne et animés d’une puissance du travail hors du commun parviennent à occuper les places à l’avant-scène du discours scientifique du moment – et ce, au prix d’une compétition internationale acharnée entre les laboratoires de recherche, accès au financement et talent stratégico-scientifique des directeurs ou directrices d’équipes tout au long d’un parcours dont on ne peut taire l’exigence, mais qui présuppose par ailleurs, faut-il le souligner, un certain type de comportement individuel et de tempérament psychologique. La science, en effet, n’est pas un monde de pudeur et de modestie, mais un univers dans lequel la capacité d’une affirmation de soi et d’une certitude subjective de sa propre importance sont des atouts majeurs. Ce à quoi s’ajoute désormais l’indispensable talent de savoir s’imposer dans les médias et de faire alliance avec eux en adoptant au besoin la rhétorique de la "com" : la science est devenue une figure parmi d’autres du système de la communication de masse dont on ne peut que redouter qu’elle puisse un jour en devenir l’otage.
La science, en effet, n’est pas un monde de pudeur et de modestie, mais un univers dans lequel la capacité d’une affirmation de soi et d’une certitude subjective de sa propre importance sont des atouts majeurs. Ce à quoi s’ajoute désormais l’indispensable talent de savoir s’imposer dans les médias et de aire alliance avec eux en adoptant au besoin la rhétorique de la "com" : la science est devenue une figure parmi d’autres du système de la communication de masse dont on ne peut que redouter qu’elle puisse un jour en devenir l’otage.
Tout au long de ce parcours plus ou moins clairement balisé, les femmes chercheures ont été historiquement entravées par une série de pesanteurs sociologiques et culturelles qu’elles ont individuellement peu ou prou intériorisées et qui ont été autant de causes d’inhibition et d’obstacles objectifs/subjectifs dans la construction de leurs carrières. En d’autres termes, la situation de la femme scientifique, telle que j’ai pu l’observer, était la résultante d’une reproduction sociale dans laquelle s’intriquaient deux niveaux de surdétermination dans un destin professionnel – le premier relevant des règles du fonctionnement interne de la science (modes de cooptation et de reconnaissance par les pairs), et le second, de la socialisation primaire de la petite fille et de son aptitude à éprouver ou pas une grande confiance intérieure.
Les schémas présentés dans mon article (op.cit.) démontraient un phénomène de sérendipité9 (Merton et Barber, 2004), soit l’observation de résultats non anticipés et inexplicables selon les modèles sociologiques classiques, et nécessitant de ce fait de nouveaux développements théoriques. En effet, chez les hommes, les variables sociologiques explicatives habituelles (origine socio-économique de la famille, niveau de diplomation des parents, âge au moment de l’obtention du Ph.D. et aux divers stades du rang académique avaient chacune une incidence mesurable sur une progression dans les réseaux de la recherche scientifique. Chez les femmes, par contre, aucune de ces variables « lourdes » ne semblait avoir d’effet significatif, y compris, fait surprenant, le niveau socioculturel du milieu familial de naissance ni la charge familiale qui était éventuellement la leur10. Dans les analyses de corrélation et de régression linéaire, la variable de l’identité sexuelle expliquait à elle seule le retard accusé des chercheures en termes de nombre de publications, d’importance des revues dans lesquelles leurs noms apparaissaient ou de participation à des comités scientifiques majeurs nationaux et internationaux, etc. Le fait d’être une femme semblait résumer en soi un profil type de carrière scientifique. Et celle-ci, en général, était partiellement dans l’ombre.
De quelques biographies de figures féminines de la science
Les nombreuses biographies de très grandes figures féminines de la science, ainsi que les entrevues en profondeur que j’avais menées avec plusieurs chercheures dans mes échantillons d’observation, ont révélé une constante particulière dans la socialisation primaire de l’enfant11. Dans la plupart de ces cas, la petite fille avait connu de manière très précoce une relation qui avait encouragé sa curiosité et son intelligence. En général, il s’agissait d’une relation privilégiée avec un père qui l’avait autorisée à développer une pensée personnelle, qui avait grandement valorisé son appétit spontané pour les choses de la science et qui, contrairement aux stéréotypes culturels habituels, s’était intellectuellement adressé à elle à l’égal d’un garçon, ou comme si elle avait été le fils que le père n’avait pas eu! Ce capital psychologique transmis à la fille, qui s’était identifiée à ce regard particulier posé sur elle dans son enfance – à la condition toutefois, de ne pas l’avoir intériorisé comme une attente et une exigence accablantes à son égard –, était aussi un capital culturel intime qui allait plus tard lui permettre, en tant que sujet, de ne pas se définir à partir d’un rôle sociosexuel prédéterminé ni de se percevoir comme une transfuge dans un univers qui aurait été a priori « réservé » aux hommes.
On pense aux exemples phares de Sofia Kovalevskaïa, Marie Curie, Barbara McClintock, chez qui le modèle relationnel noué avec le père s’était trouvé plus tard assez naturellement relayé dans la rencontre d’une nouvelle figure mentor « néopaternelle », un directeur de thèse ou autre soutien, souvent un conjoint avec qui s’était établie une proximité de pensée intellectuelle prolongée sous la forme d’une collaboration étroite. Leur première relation d’enfance idéalisée – dont il faut nommer le caractère clairement œdipien – avait donc été le point de départ d’une vocation scientifique. Le transfert spontané de ce mode relationnel sur d’autres figures ayant fait fonction d’une première reconnaissance publique, avait été le tremplin de démarrage de leur carrière et le principal étayage de son accélération.
Mais lorsque la fillette n’avait pas bénéficié, de la part de son père ou d’une autre figure déterminante, dans son histoire infantile, d’un investissement de son intelligence, tel qu’il avait frayé pour elle le chemin de la fascination pour la découverte, alors les exigences intellectuelles, psychologiques et même de résistance physique requises par une carrière de recherche de haut niveau semblaient avoir été, psychologiquement parlant, beaucoup plus conflictuelles et ardues à vivre; ladite carrière, faut-il ajouter, n’étant pas facilement compatible avec les contraintes d’une vie familiale et les exigences de disponibilité psychique intérieure que nécessite la maternité, tout particulièrement avec les enfants en bas âge12. What I need most is a husband at home! était une plaisanterie courante chez les scientifiques féministes américaines des années 1970 et 1980.
Observerions-nous chez les jeunes femmes scientifiques d’aujourd’hui la même conjugaison d’une intercausalité complexe et non linéaire entre une plus grande facilité d’ajustement aux règles internes du monde scientifique et une confiance narcissique suffisamment tranquille dont les racines les plus profondes sont à chercher dans la jeune enfance? Mon expérience clinique de psychanalyste me permet d’en soutenir aisément l’hypothèse.
Observerions-nous chez les jeunes femmes scientifiques d’aujourd’hui la même conjugaison d’une intercausalité complexe et non linéaire entre une plus grande facilité d’ajustement aux règles internes du monde scientifique et une confiance narcissique suffisamment tranquille dont les racines les plus profondes sont à chercher dans la jeune enfance? Mon expérience clinique de psychanalyste me permet d’en soutenir aisément l’hypothèse.
Quelles spécialisations pour les jeunes femmes scientifiques?
Dernier point, et non le moindre : dans une recherche sur la place occupée par les femmes dans la science en ce premier quart du 21e siècle, il serait indispensable, pour évaluer celle-ci avec justesse, de faire une analyse comparative fine, discipline par discipline, et sous-spécialisation par sous-spécialisation, des choix respectifs des objets de recherche des hommes et des femmes, et ce, dès leurs études de doctorat et de postdoctorat. Observe-t-on une différence selon l’identité de sexe entre engagement en recherche fondamentale et engagement en recherche appliquée? Les femmes sont-elles présentes ou plutôt absentes dans les grands laboratoires de recherche fondamentale en physique nucléaire, en biogénétique ou en intelligence artificielle13? Sont-elles les égales des hommes dans l’obtention des brevets? À titre d’exemple particulier : dans le vaste champ des technosciences, notamment l’intelligence artificielle (IA), ont-elles tendance à s’engager dans certaines sous-branches plutôt que dans d’autres? Choisissent-elles plus fréquemment de se spécialiser dans la conception de systèmes qui empruntent à la neurobiologie computationnelle et à la logique mathématique et algorithmique, ou dans les technologies informatiques d’applications (conception d’automates, gestion de systèmes de production ou de services, etc.)? En deux mots, y a-t-il des secteurs et des types de tâches dans la division du travail de recherche et sa gestion qui s’avèrent genrés? Et parce que c’est plus que probable, comment cela peut-il s’expliquer, d’une part, en termes de surdéterminations sociologico-culturelles externes au monde de la science et de leurs effets endopsychiques sur les acteurs sociaux, et d’autre part, en termes de surdéterminations internes relatives aux règles normatives de ce monde particulier14?
Pour mieux comprendre la portée des avancées scientifiques, la philosophie, l’histoire et la sociologie en avant-plan
Enfin, dans cette évocation succincte du fonctionnement institutionnel interne de la science et de ses conséquences sur la présence observable des femmes dans le processus collectif de l’avancement des connaissances, on ne peut pas ne pas évoquer, même si trop brièvement, les enjeux économicopolitiques qui président à la définition des grandes orientations scientifiques contemporaines. La compétition internationale féroce et les intérêts financiers considérables en jeu ont renforcé la relégation au second plan, dans l’ordre des savoirs, de l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales, ces « sciences molles » jugées de plus en plus superflues dans la formation des jeunes esprits. Cela se traduit au Québec par une tendance tragique à l’effacement progressif, dans les programmes de cégeps, des cours d’histoire et de philosophie et de leurs sous-composantes d’introduction à l’histoire de la pensée scientifique et à la déconstruction de l’utopie positiviste qui voit dans la science la garantie absolue d’un progrès de l’humanité. Cet effacement a de lourdes incidences en termes de lacunes dans les connaissances de base qui sont transmises aux jeunes esprits. En privant les générations montantes de la chance d’être introduites aux bases élémentaires d’une réflexion théorique et pratique à laquelle ces deux disciplines donnent prioritairement accès, ces générations risquent, dès les étapes les plus préliminaires de leur formation, d’être partiellement amputées dans le déploiement de leur imaginaire spéculatif et dans leurs futures capacités d’échapper au totalitarisme insidieux d’un technocosme (J. Ellul, 1984)15 dans lequel nous baignons et à ses effets de conditionnement des consciences.
Devant la nécessité plus impérieuse que jamais d’un questionnement collectif sur la marche de la science et sur les principales avenues qui en dessinent l’avenir, pourrait-on imaginer que les femmes scientifiques trouvent, dans leur relative marginalité, l’espace d’une plus grande liberté de pensée critique et qu’elles transforment cette situation en actions concrètes? Pourrait-on aller jusqu’à rêver que face au principe hégémonique de l’utilitarisme en Recherche et Développement ( R-D) qui constitue le cœur de la technoscience où se rencontrent chercheurs, ingénieurs et industriels, et qui domine aujourd'hui tous les secteurs de la recherche de pointe (sciences du vivant16, modifications cellulaires, biotechnologies, systèmes d’IA, recherche nucléaire, développement de l’armement militaire, etc.), elles soient présentes aux premières lignes d’une vigilance épistémologique critique, d’autant plus essentielle qu’elle sera scientifiquement très informée (E. Fox-Keller, 1983; G. Hottois17, 1984; B. Bensaude-Vincent et G. Dorthe, 2023)18? Et for making sense of life and science, pour emprunter les mots de la physicienne et grande historienne des sciences Evelyn Fox Keller (2003; 2023)19, qu’elles tracent les chemins de la génération qui nous suit en lui enseignant que l’aventure de la science est prodigieuse, mais à la condition indispensable de ne pas se laisser complètement absorber par les diktats d’une technoscience, dont J. Ellul et G. Hottois (op.cit.) ont dénoncé très tôt qu’elle nous laisse « sans voix et sans regard » et éthiquement démunis. En effet, ce nouveau milieu environnant, en modifiant nos mentalités et en transformant les modes du langage, introduit une mutation civilisationnelle potentiellement porteuse d’une déshumanisation. Tout comme sous l’emprise du vecteur science-technique-industrie, et sous couvert du logos de la technique devenue « une finalité à part entière » (G. Hottois, op.cit.) assortie de ses trois corollaires, le calculable, le planifiable et la faisabilité, il pourrait arriver, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l’histoire, que la science fasse alliance avec la barbarie.
Devant la nécessité plus impérieuse que jamais d’un questionnement collectif sur la marche de la science et sur les principales avenues qui en dessinent l’avenir, pourrait-on imaginer que les femmes scientifiques trouvent, dans leur relative marginalité, l’espace d’une plus grande liberté de pensée critique et qu’elles transforment cette situation de marginalité en actions concrètes?
- 1Il s’agissait en général, et ce n’était pas un hasard, de femmes scientifiques d’origine étrangère, assez souvent originaires d’Europe de l’Est.
- 2Les politiques d’affirmative action menées sous une pression militante féministe au cours des années 1980-2000 ont incontestablement porté fruit dans le recrutement des femmes au rang professoral en forçant les jurys de sélection à systématiquement prendre en compte la qualité des dossiers des femmes.
- 3Mon étude par questionnaire rassemblait un échantillon de plus de 600 chercheurs (niveau universitaire et doctorat) des deux sexes.
- 4Isabelle Lasvergnas, « Pratiques réticulaires et inscription de la différence dans l’institution scientifique », Sociologie et sociétés, vol. XIII, no 2, 1981.
- 5Je me contenterai pour simplification de me référer ici au grand ouvrage synthèse dans lequel Merton reprend plusieurs de ses travaux antérieurs : Robert K. Merton, The Sociology of Science, Theoretical and Empirical Investigations, The University of Chicago Press, 1973; voir également : Yves Gingras, Sociologie des sciences, Paris, PUF « Que sais-je ? », 2013.
- 6Ceci, sans sous-estimer le fait que la communication scientifique de haut niveau dans les disciplines dont il est ici question, doit impérativement se faire aujourd’hui en anglais si on veut avoir quelques chances d’être connu et reconnu, le Publish or Perish étant pleinement devenu uniquement de langue anglaise. Et sans passer non plus sous silence le fait que l’univers universitaire québécois et canadien est scientifiquement périphérique en termes de classement mondial de ses institutions universitaires, de capital de financement de la recherche, d’importance de ses laboratoires et de prestige de ses presses universitaires, une des conséquences directes du poids géopolitique et économique occupé par une nation dans la sphère mondiale.
- 7Margaret W. Rossiter, « The Matilda Effect in Science », Social Studies of Science, Londres, Sage Publ., 1993, p. 325-341.
- 8Pierre Bourdieu, Homo academicus, Paris, Les Éditions de minuit, coll. « Le sens commun », 1984, 302 p.; Yves Gingras, « Le système social de la science », Sociologie des sciences (2020), p. 53-86.
- 9Robert K. Merton et Elinor Barber, The Travels and Adventures of Serendipity. A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science, Princeton University Press, 2004.
- 10De fait et sans surprise dans mon échantillon d’étude, les femmes scientifiques provenaient d’un milieu familial où les deux parents avaient un niveau d’études postsecondaire et le plus souvent universitaire. De plus, la grande majorité d’entre elles n’avaient pas d’enfants.
- 11Isabelle Lasvergnas, « Contexte de socialisation primaire et choix d’une carrière scientifique chez les femmes », Recherches féministes, vol. 1, no 1, 1988, p. 31-45. Voir également : « Le cheminement des femmes scientifiques : auto-sélection ou voies d’exclusion? », dans Travailler au Québec, Montréal, Éditions Albert Saint-Martin, 1981, p. 197-208.
- 12Ce qui amène de nombreuses jeunes scientifiques prometteuses et détentrices d’un doctorat et post-doctorat, à devoir faire très tôt un choix irréversible entre un engagement dans une carrière de recherche de pointe, d’une part, et la maternité et ses exigences, d’autre part, ce qui, dans le second cas, les conduira à choisir une carrière scientifique périphérique.
- 13Aujourd’hui, une telle étude ne pourrait plus s’en tenir au seul monde universitaire de la recherche. Elle devrait impérativement inclure le secteur privé, notamment les industries biopharmaceutiques ainsi que les géants financiers qui, conséquence d’une économie néolibérale, sont devenus des acteurs prépondérants de la « Recherche et Développements », incluant la recherche universitaire.
- 14Isabelle Lasvergnas, « Le rapport des femmes à la science : pour une tentative de compréhension théorique », dansLouise Marcil Lacoste (dir.), La place de la femme, Les Cahiers de l’ACFAS, no 44, Montréal, 1986.
- 15Jacques Ellul, Le bluff technologique, Paris, Hachette, 3e éd., 2012 (1re éd. 1988).
- 16Isabelle Lasvergnas (dir.), Le vivant et la rationalité instrumentale, Montréal, Liber, 2003, 199 p.
- 17Gibert Hottois, Pour une éthique dans un univers technicien, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1984
- 18Evelyn Fox-Keller, A Feeling for the Organism: The Life and Work of Barbara McClintock, Freeman, 1983; Gilbert Hottois : Le signe et la technique, la philosophie à l’épreuve de la technique, Paris, Aubier Montaigne, 1984; Bernadette Bensaude-Vincent et Gabriel Dorthe, Les sciences dans la mêlée. Pour une culture de la défiance, Paris, Seuil, 2023.
- 19Evelyn Fox Keller, Making Sense of Life, Explaining Biological Development with Models, Metaphors, and Machines, Harvard University Press, 2003; Making Sense of My Life in Science: A Memoir, Modern Memoirs, Inc., 2023.
- Isabelle Lasvergnas
UQAM - Université du Québec à Montréal
Isabelle Lasvergnas, Ph.D., est professeure associée au Département de sociologie de l’UQAM et professeure-chercheure associée au Laboratoire de l’Unité transversale de recherche psychogenèse et psychopathologie, Université de Paris XIII Villetaneuse et Paris-Sorbonne-Nord. Psychanalyste, membre de la Société canadienne de psychanalyse, elle est également directrice générale et clinique du Groupe psychanalytique du Mont-Royal (GPMR), un organisme (OBNL et organisme de bienfaisance) dont les services psychothérapiques sont dédiés aux personnes en situation de précarité sociale et économique. Le GPMR est aussi un collectif de recherche. Dans le parcours de sa double carrière d’universitaire et de clinicienne, Isabelle Lasvergnas a publié de très nombreux articles et chapitres de livres au Québec, au Canada, en Europe et en Amérique latine, dont plusieurs ont été traduits en anglais et en espagnol, et a dirigé six ouvrages collectifs. À paraître sous sa direction en 2023, Les antichambres du langage, et en 2024, La création psychique. Penser dans le sillage de Michel de M’Uzan.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre