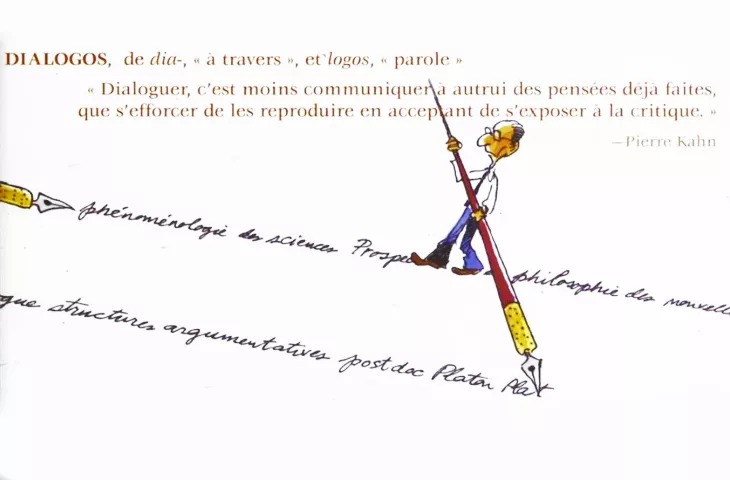La place du français dans les sciences est une thématique qui ne perd jamais de sa pertinence, surtout pour les nouvelles générations de chercheurs qui, pour être davantage connus, lus et cités, sont de plus en plus soumis à des impératifs de formation et de publication en anglais.
[Ce texte est la version rehaussée d’une conférence prononcée dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019, à l'occasion d'une table-ronde sur la science en français au Canada, organisée par l'Acfas.]
La place du français dans les sciences est une thématique qui ne perd jamais de sa pertinence, surtout pour les nouvelles générations de chercheurs qui, pour être davantage connus, lus et cités, sont de plus en plus soumis à des impératifs de formation et de publication en anglais. En effet, les doctorants et post-doctorants canadiens d’aujourd’hui sont poussés à acquérir une formation dans les universités du monde anglophone, dont la puissance d’attraction n'a peut-être jamais été aussi élevée. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de jeter un œil aux résultats des bourses postdoctorales attribuées par le CRSH pour le cycle 2019-2020 où l'on constate que la forte majorité des lieux d'attribution, toutes langues confondues, sont situés dans le monde universitaire anglophone, avec une préférence nettement marquée pour les États-Unis et le Royaume-Uni à l’étranger1. À l'inverse, une seule bourse a été attribuée à un étudiant du Québec pour un post-doctorat dans une université française, ce qui n'est pas sans contraster avec une époque pas si lointaine où la France constituait, en particulier pour la formation en sciences humaines et sociales, un passage quasi obligé pour les études supérieures. En outre, la pente vers l’anglais comme langue de publication et de référence scientifiques est aussi bien engagée au Québec depuis plusieurs années2. Faut-il s’en inquiéter? Si le recours à l’anglais dans les sciences comporte des avantages certains en matière de diffusion, de visibilité, de prestige et de positionnement scientifique à l’échelle internationale, cette injonction de l’époque n’en appelle pas moins une nécessaire vigilance.
Pourquoi une science en français?
Les dynamiques linguistiques dans la science ne flottent pas dans l’éther; elles s’ancrent dans l’histoire et s’indexent à des luttes de pouvoir plus profondes. Ainsi, deux raisons m’amènent à penser qu’il faut résister à la généralisation de l’anglais scientifique et défendre le principe du maintien d’une science en français.
La première est que l’hégémonie de l’anglais constitue un phénomène relativement récent dans l’histoire des sciences, est surtout un phénomène conjoncturel dont on peut penser qu’il ne sera pas appelé à perdurer. En effet, la prééminence de l’anglais scientifique remonte surtout au milieu du XXe siècle, plus particulièrement aux années entourant la Seconde Guerre durant lesquelles on a assisté à un important transfert d’hégémonie culturelle, politique et économique depuis l’Europe vers les États-Unis. Cette dynamique politique, dont le champ scientifique est tributaire, s’est par la suite accélérée avec la chute du mur de Berlin dans les années 1990, mais aussi avec l’extension du paradigme managérial dans le fonctionnement des universités nord-américaines3. Comme le faisait remarquer Stéphane Vibert, le rôle effectif de la langue dans un tel contexte, et tout particulièrement celui de l’anglais standard, s’envisage davantage « comme un moyen de promotion […] et non comme l’expression d’une culture, d’un monde historique et d’une pensée diverse »4. C’est dire que l’appel à l’anglicisation et à la mondialisation du savoir de nos jours peut aisément devenir une manière détournée d’en accréditer son américanisation. Cette hégémonie de la culture savante anglo-américaine court le risque de nous conduire à une uniformisation des paradigmes de pensée et, incidemment, à l’extinction des épistémologies de cultures « périphériques » - ce que le chercheur Budd Hall nomme les « épistémicides », en référence à la pensée décoloniale5. Ce risque d’uniformisation vaut aussi pour les modes de diffusion de la connaissance, qui se traduit notamment par le recours de plus en plus généralisé au modèle de type paper. Ce modèle, calqué sur le fonctionnement des sciences naturelles et encouragé par les grands éditeurs savants commerciaux anglophones comme Springer et Elsevier, a induit une temporalité écourtée dans la production scientifique, mais aussi, un rétrécissement des ambitions dans les publications. Pour certaines disciplines, comme l’histoire, où le livre demeure encore un élément constitutif de son identité disciplinaire, ce changement esthétique n’a rien de banal.
...il faut savoir qu’historiquement, la science moderne s’est développée dans un système de plurilinguisme, suivant généralement une logique de partage disciplinaire entre l’anglais, l’allemand, le français, l’italien et le russe.
Or, il faut savoir qu’historiquement, la science moderne s’est développée dans un système de plurilinguisme, suivant généralement une logique de partage disciplinaire entre l’anglais, l’allemand, le français, l’italien et le russe. En effet, si les grands fondateurs de la science moderne comme Galilée, Descartes, Pascal, Bacon ou Newton, parlaient le latin, ils écrivaient néanmoins dans leur langue nationale. Ce souci pour la différenciation linguistique de la pensée scientifique, bien que présent dès la Renaissance, est surtout un héritage du Siècle des Lumières, alors que le recours à des langues scientifiques nationales avait pour vocation de démocratiser l’accès au savoir6. On peut également penser que c’était là aussi une condition bien légitimement posée de l’innovation scientifique. Car, comme l’a démontré le linguiste Benjamin Lee Whorf, la créativité scientifique est aussi fonction de la structuration du langage, étant entendu que toute langue est l’expression d’une culture, d’une histoire et donc, d’un point de vue original sur le monde7.
Ce rappel historique éclaire autrement notre présent, où se multiplient les indices d’une fin de cycle de la prééminence de l’anglais. Comme l’a démontré le linguiste Nicolas Ostler, la langue de Shakespeare serait en effet la dernière lingua franca du monde8. Confronté à la fin des empires et à l’émergence d’un monde de plus en plus multipolaire, avec l’affirmation de nouvelles puissances économiques et scientifiques (Brésil, Russie, Inde, Chine), l’anglais sera nécessairement tenu de faire une plus grande place au déploiement de nouveaux espaces linguistiques. L’investissement de plus en plus significatif dans des logiciels et des algorithmes de traduction, forcément imparfaits et insuffisants, signalent tout de même un désir d’accès accru à des contenus de langues diversifiées en temps réel. On peut ainsi raisonnablement penser que s’ouvre une ère où la diversité des langues et des modalités d’accès à la connaissance sera davantage valorisée que le développement d’une seule langue universelle9.
...les sciences humaines et sociales [...], plus difficilement universalisables, se pratiquent toujours en situation, c’est-à-dire en fonction des enjeux, des défis et des besoins propres à des contextes sociétaux et nationaux spécifiques.
La seconde raison relève de la spécificité des sciences humaines et sociales (SHS), où les rapports entre langue et science ne se posent pas de la même manière que dans le champ des sciences naturelles ou biomédicales. Comme l’a déjà fait remarquer Yves Gingras, l’universalisation de l’anglais scientifique dans les « sciences dures » est un fait acquis, redevable au potentiel universalisable de leurs objets et résultats de recherche (le fonctionnement de l’atome sera toujours le même, peu importe le lieu où on l’observe). À l’inverse, les SHS sont des sciences qui, plus difficilement universalisables, se pratiquent toujours en situation, c’est-à-dire en fonction des enjeux, des défis et des besoins propres à des contextes sociétaux et nationaux spécifiques10. Ainsi, les sociologies québécoise ou acadienne sont-elles nées d’une série de questions suscitées par les enjeux, les besoins et les défis propres aux cultures québécoise et acadienne. C’est la raison pour laquelle les SHS sont souvent indissociables de la communauté étudiée et, bien souvent, de leur langue de référence. Dans ce cas-ci, la langue n'est pas qu'un simple instrument de communication, elle est intimement associée aux significations qu'elle porte. Soulignons qu’elle est aussi associée à une précaution proprement éthique du savoir scientifique, en cela que la responsabilité du chercheur en SHS s’exerce aussi vis-à-vis de l’espace culturel et linguistique de son terrain d’enquête (dans le cas d’une enquête participative) ou encore du public concerné11.
Une précision s’impose : il ne s’agit pas tant ici de défendre l’idée d’une science « régionalisée », « nationalisée » ou repliée sur elle-même, mais plutôt de rappeler la vertu épistémologique de l’enracinement dans la pensée scientifique, notamment dans le contexte des sociétés dites « non hégémoniques » comme le Québec. Pour reprendre les termes du sociologue québécois Fernand Dumont, l’enjeu de la pratique des SHS relève à la fois de la vérité et de la pertinence. Si la vérité, quête nécessaire et noble de tout chercheur, tend vers « l’universel de la Raison », elle est aussi « l’expression de la situation et des enracinements de ceux qui s’y vouent et de ceux à qui elle est destinée »12. Sans en être une condition inaliénable, le choix d’une langue scientifique – en l’occurrence le français pour le Québec et la francophonie canadienne – me paraît être une condition fondamentale pour un enracinement fécond de la science. Il est tout aussi important du point de vue du statut public du savoir scientifique et de sa capacité à s’inscrire dans le débat public et de le nourrir.
Deux pistes de solution
Au-delà des pétitions de principe, quels moyens concrets peut-on mettre en œuvre pour favoriser la diversification des postures et des formats de production scientifique? Deux pistes de solution, déjà évoquées par d’autres avant moi, me semblent porteuses. Tout d’abord, il importe de revaloriser le rôle des revues savantes nationales francophones, aujourd’hui menacées par l’internationalisation du savoir et par le passage au numérique. Bien que rarement comptabilisées dans les grandes instances d’indexations scientifiques, qui ont un biais en faveur des publications en langue anglaise13, ces revues, pour la plupart hébergées sur la plateforme Érudit, ont pourtant une grande force de rayonnement dans les milieux universitaires francophones au Canada14. Leur importance tient non seulement au fait qu’elles sont des véhicules de diffusion de la connaissance sur le Québec et le Canada français, mais aussi qu’elles constituent des lieux de préservation, d’actualisation et de transmission de son patrimoine scientifique. Elles sont, pour reprendre la formule hégélienne, des lieux d’expression d’un « universel concret » du savoir, en offrant à la fois la possibilité d’élargir les horizons de la connaissance tout en maintenant celle-ci en dialogue avec des milieux locaux et nationaux particuliers.
Ensuite, la lutte contre la généralisation de l’anglais scientifique doit passer, me semble-t-il, par une revalorisation et une meilleure connaissance de nos traditions scientifiques francophones et de leurs ancrages spatiaux. S’attacher à la généalogie de nos disciplines, c’est aussi une façon de montrer qu’il existe quelque chose comme des lieux différenciés de la pensée francophone – tantôt québécoise, tantôt acadienne, tantôt franco-ontarienne – qui ont façonné leur propre légitimité et une originalité porteuse d’une certaine vérité sur le monde. Pareille entreprise constitue une manière, parmi d’autres, de redécouvrir la langue scientifique sous son jour culturel et référentiel. Elle passe peut-être d’abord par un enseignement mieux intégré, au 1er cycle universitaire, de l’histoire de nos disciplines et des conditions épistémologiques particulières qui les ont façonnées. Ainsi, retrouverons-nous les raisons fortes qui les ont mises au monde et qui font qu’elles méritent d’être perpétuées.
S’attacher à la généalogie de nos disciplines, c’est aussi une façon de montrer qu’il existe quelque chose comme des lieux différenciés de la pensée francophone – tantôt québécoise, tantôt acadienne, tantôt franco-ontarienne – qui ont façonné leur propre légitimité et une originalité porteuse d’une certaine vérité sur le monde.
- 1Sur les 36 bourses postdoctorales attribuées au Québec pour le cycle 2019-2020, 10 seront utilisées à l’Université Concordia et 13 à McGill (pour un total cumulé de 64%). Quant aux universités étrangères, sur les 38 bourses attribuées, 10 seront utilisées au Royaume-Uni et 16 aux États-Unis (pour un total cumulé de 68%). Source : « Statistiques relatives aux concours », Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/stats-statistiques/index-fra.aspx (page consultée le 28 septembre 2019).
- 2Voir Jean-Philippe Warren et Vincent Larivière, « La diffusion des connaissances en langue française en sciences humaines et sociales. Les défis du nouvel environnement international », Recherches sociographiques, vol. 59, nº 3, Septembre–Décembre 2018, p. 327–337.
- 3Vincent de Gaulejac, « On ne pense pas de la même façon selon les langues. La domination de l’anglais dans les sciences sociales », SociologieS, [En ligne], http://journals.openedition.org/sociologies/9445 (page consultée le 28 septembre 2019).
- 4Stéphane Vibert, « Publier en français, une question de principes », SociologieS [En ligne], http://journals.openedition.org/sociologies/9514 (page consultée le 28 septembre 2019).
- 5Budd Hall, « Épistémicides et reconstruction des savoirs et épistémologies du monde endogène/autochtone d’Afrique et d’Amérique », Conférences midi du Ciram, Université Laval, 28 janvier 2019.
- 6Rainer Enrique Hammel, « The dominance of English in the international scientific periodical literature and the future of language use in science », Aila Review, nº 20, 2007, p. 55.
- 7Charles Durand, Christian Guilleminot, « Où nous conduit l’hégémonie de la langue anglaise? Quelques conséquences néfastes de l’utilisation de la langue anglaise en science et en technologie dans le contexte international: l’exemple français », Conférence prononcée dans le cadre du VIII Simposio Internacional de Comunicación Social, Santiago de Cuba, Vol. II, 2003, [En ligne], https://www.researchgate.net/publication/258833491_Ou_nous_conduit_l'hegemonie_de_la_langue_anglaise_Quelques_consequences_nefastes_de_l'utilisation_de_la_langue_anglaise_en_science_et_en_technologie_dans_le_contexte_international_l'exemple_francais (page consultée le 28 septembre 2019).
- 8Nicolas Ostler, The Last Lingua Franca: English Until the Return of Babel, New York : Walker Publishing Company , 2010, 318 p.
- 9Joseph Yvon Thériault, Sept leçons sur le cosmopolitisme. Agir politique et imaginaire démocratique, Montréal, Québec Amérique, 2019, p. 113.
- 10Yves Gingras cité dans Jean-François Venne, « Le dilemme des chercheurs francophones : publier en anglais ou périr? », Affaires universitaires, novembre 2017, [En ligne], https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/le-dilemme-des-chercheurs-francophones-publier-en-anglais-ou-perir/ (page consultée le 28 septembre 2019).
- 11Voir Jean-Louis Genard et Marta Roca i Escoda, « Publier en français dans un monde globalisé : raisons et déraisons », SociologieS [En ligne], https://journals.openedition.org/sociologies/9731 (page consulté le 5 octobre 2019).
- 12Fernand Dumont, Récit d’une émigration, Montréal, Boréal, 1997, p. 172.
- 13Archambault, É., Vignola-Gagné, É., Côté, G., Larivière, V., & Gingras, Y., « Benchmarking scientific output in the social sciences and humanities: The limits of existing databases », Scientometrics, vol. 68, nº3, 2006, p. 329-342.
- 14Vincent Larivière a bien démontré que les revues savantes québécoises diffusées sur la plate-forme Érudit sont autant, sinon davantage, utilisées par les universités du Québec que les revues internationales publiées par les grands éditeurs (V. Larivière, « De l’importance des revues de recherche nationales », Découvrir, 15 septembre 2014, [En ligne], https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2014/09/l-importance-revues-recherche-nationales (page consultée le 28 septembre 2019).
- François-Olivier Dorais
Université du Québec à Chicoutimi
François-Olivier Dorais est professeur adjoint à l’Université du Québec à Chicoutimi, où il enseigne l’histoire du Québec et du Canada aux XIXe et XXe siècles ainsi que l’histoire régionale. Ses recherches se partagent entre l’histoire culturelle et intellectuelle des savoirs au Québec, l’historiographie et l’histoire des francophonies minoritaires au Canada, en particulier l’Ontario français. Il est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) et du comité de rédaction de la revue Recherches sociographiques.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre