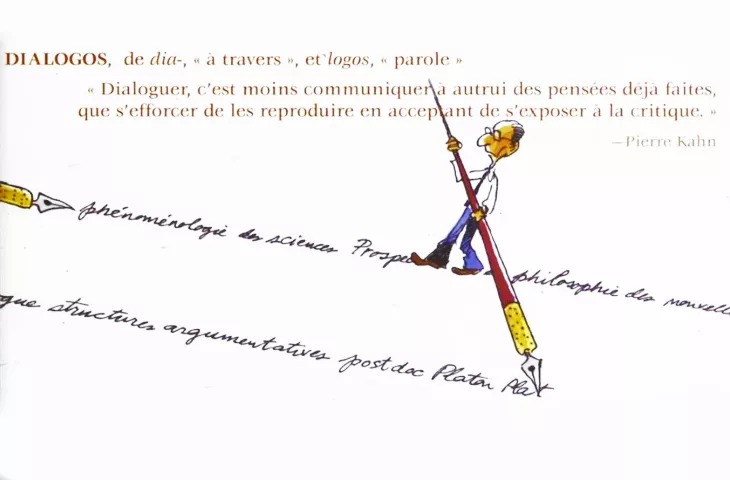Mélissa Thériault, UQTR
Mélissa Thériault, UQTR
Chronique Les dessous du métier de chercheur
Partie 1 : l’édition
13 octobre 2016
Je me suis surprise moi-même à lancer ça d’un trait :
- Donc si j’ai bien compris, tu me proposes de faire un travail dans lequel je me ferai plein d’ennemis parce que ma responsabilité sera de refuser presque tous les projets qui arriveront sur ma table, et en plus de briser des rêves, je devrai ramener mes collègues à l’ordre dans le cadre d’un travail qui m’obligera à mettre plus souvent qu’autrement mes propres projets de côté et ... tu t’attends à ce que je dise oui?
J’ai senti dans le rire réprimé de mon interlocuteur un léger soulagement : au moins, il n’aurait pas à tout m’expliquer. Parce qu’assumer la responsabilité d’éditer des livres (c’est-à-dire sélectionner parmi les projets reçus ceux qui seront produits, d’accompagner les auteurs jusqu’à la ligne d’arrivée – en s’assurant que tous les détails pratiques soient réglés – et de devoir rendre des comptes à la fois au lectorat, à l’auteur(e) et à la maison d’édition), ça n’est pas facile.
-Oui, c’est pas mal ça.
J’ai demandé un peu de temps pour réfléchir, sachant néanmoins que j’allais accepter : la voix intérieure était catégorique, accepter signifiait de laisser tomber autre chose. Il fallait déterminer ma marge de manœuvre, histoire que la qualité du travail soit au rendez-vous.
-J’ai besoin de temps pour réfléchir, ok? Je te rappelle demain pour te dire que j’accepte.
Oups.
Vous trouvez que je prends de drôles de décisions?
Moi aussi.
« Ça fait partie de la tâche »
C’est un aspect méconnu de la fonction de professeure (souvent perçue hors du milieu universitaire comme réduite à l’enseignement) : le métier exige, en plus de la recherche, que l’on fasse aussi ce qu’on appelle du « service à la collectivité ». En anglais, on dit civil servant pour désigner les fonctionnaires : ça s’applique particulièrement bien à cette sorte bien particulière de fonctionnaires que sont les professeurs d’université, du moins, si on parle des universités publiques comme celle dont je suis à l’emploi, qui ont été développées pour donner accès à l’éducation sur l’ensemble du territoire, dans une visée démocratique. Être au service de la collectivité, ça signifie notamment rendre accessible à un lectorat désireux d’approfondir ses connaissances des ouvrages qui lui permettra de le faire.
Par contre, aux yeux de mon administration, l’enseignement devrait représenter environ 35 % de ma charge de travail (j’aimerais comprendre comment l’enseignement qui m’occupe à temps plein huit mois par année peut être comprimé dans « 35 % » et surtout, j’aimerais savoir comment faire entrer le « 65 % » dans les 4 mois qui restent, mais prenons pour acquis que c’est moi qui suis mauvaise en calcul). Ce 65 % se répartit entre la recherche (sur laquelle se juge l’avancement d’une carrière) et le service à la collectivité (pas véritablement reconnues) et à la recherche; auxquels s’ajoutent notamment de nombreuses tâches administratives et la supervision d’étudiants aux cycles supérieurs.
L’édition et la vulgarisation des travaux de recherche peuvent ainsi être considérées à la fois comme un prolongement de ma propre recherche et comme un service à la collectivité : mon rôle devient alors de mettre la recherche de mes collègues à la disposition de la communauté, à l’aide du budget strict dont nous disposons.
Agir comme directrice de collection est à la fois ingrat et stimulant : évaluer les manuscrits me permet de développer mes connaissances dans des domaines connexes à mon champ d’expertise (au contact de projets qui portent sur des sujets que je n’ai pas eu à travailler moi-même), mais me permet aussi d’avoir un impact direct (bien que modeste) sur la façon dont on diffuse la recherche au Québec et dans la francophonie. Cela me permettra aussi de mettre en valeur les travaux de chercheurs émergents qui ne bénéficient pas encore de la visibilité des chercheurs établis. Mais ça m’obligera aussi à justifier mes refus, mes hésitations et mes demandes de modifications (car non, on ne peut pas publier une thèse de doctorat telle quelle, même lorsqu’elle est fascinante et exempte de coquilles : le livre a sa logique propre).
Choisir est difficile. Cela exige de faire abstraction des partis-pris (autant d’antipathie que de sympathie) pour se concentrer sur le potentiel de l’ouvrage. Dans ce milieu où il est courant de croire, à tort, que nous sommes des êtres de pure rationalité1 ou, à l’inverse, que tout n’est affaire que de copinage (deux extrêmes aussi peu représentatifs de la réalité l’un que l’autre), si on est le moindrement rigoureux, on craint le piège des sentiments. Mais il est tout aussi illusoire de prétendre que les livres n’ont rien voir avec la subjectivité. Dans un marché ou la compétition est féroce, les productions, nombreuses et de qualité, choisir les projets coups de cœur est parfois l’un des seuls moyens pour trouver l’énergie pour défendre ces productions alors que le temps, l’énergie et les ressources sont limités. On ne peut accepter cette responsabilité si l’on n’a pas en soi ancré profondément une affection pour le bricolage, au sens large du terme, si on n’a pas un rapport ludique au livre, mais aussi une implacable capacité à dire non et à composer avec les manifestations d’insatisfactions qui accompagnent souvent les refus.
« Éditer au Québec, pourquoi donc? » : un exemple concret
La situation de l’édition au Québec est par nature précaire puisqu’elle repose sur le bon vouloir d’une population restreinte. Elle n’en est toutefois pas moins anémique pour autant, bien au contraire : plusieurs maisons indépendantes de qualité survivent2 malgré la petitesse du marché. Si les grandes revues savantes font des profits surprenants en jouant du fait que les articles, rédigés et évalués bénévolement par les professeurs & chercheurs, sont ensuite revendus à fort prix via les abonnements des bibliothèques universitaires3, l’édition de livres savants (dans les presses universitaires) ou spécialisés (c’est-à-dire qui s’adressent à un lectorat érudit, mais sans être des presses universitaires en tant que tel) se fait grâce à l’apport des organismes subventionnaires.
J’avoue que ce qui m’a décidé à accepter ce rôle, c’est la possibilité d’avoir une influence, modeste évidemment, mais néanmoins réelle sur la vie des idées et sur les débats sociaux. Diriger une collection permet d’attirer l’attention du lectorat sur des sujets incontournables, mais aussi des sujets inédits, stimulants, qui peuvent sortir des sentiers battus. Mais les possibilités de transformations ne se situent pas qu’à ce niveau et une zone d’action possible se dessine au cœur même des matériaux dont le livre est fabriqué : la langue et l’image projetée.
Par exemple, certaines revues savantes ou maisons d’édition refusent toute féminisation des termes dans leurs publications. Mais le message qui est véhiculé de la sorte est que si on veut écrire des choses sérieuses, soit on est un homme, soit on fait comme si (comme si on ne pouvait être à la fois ostentatoirement femme et écrire quelque chose de sérieux). Certains éditeurs s’obstinent en s’en remettant à l’Académie française. Mais pour avoir déjà dû me battre, comme auteure, pour ne pas être identifiée comme "professeur", mais bien comme « professeure » (puisque la revue refusait de féminiser le terme, avec les séculaires arguments habituels), je sais à quel point des soi-disant détails font la différence. Me présenter en tant « qu’auteur » revenait à m’imposer au nom des traditions dont les fondements sont contestables, une identité qui n’est pas la mienne, celle d’un genre masculin-neutre-qui-englobe-tout et dans lequel, justement, je ne me sens pas incluse4. Depuis, je ressens encore plus le besoin d’inscrire dans la chair même des mots qui je suis ; le lectorat devra pour sa part composer avec le fait que les intellectuels ne correspondent pas toujours à l’image qu’on se fait d’eux. La langue est quelque chose qui évolue. Et la maison qui m’ouvre sa porte est aussi ouverte à ça. Déjà, c’est significatif comme début.
C’est dans cette perspective que l’idée de joindre une équipe affranchie des pratiques archaïques contestables et qui contribue à changer les usages dans ses productions m’apparaissait sensée : m’impliquer dans l’édition au Québec permet de contribuer à une meilleure représentation de l’apport des femmes à la vie intellectuelle. S’il m’a fallu à moi –féministe assumée- une prise de conscience pour poser des actions simples telles que féminiser mes plans de cours et y ajouter davantage de textes écrits par des femmes en vue d’atteindre un jour la parité, cela signifie que ça ne va pas de soi pour tous ...et toutes. Assurer la direction de la production d’ouvrages permet ainsi de poursuivre ce travail de sensibilisation auprès des autres auteurs et de les inviter à proposer au lectorat une nouvelle donne.
La fabrication de livres implique aussi plusieurs décisions qui ont trait à autre chose que le langage : comme les universitaires, les artisans du milieu de l’édition sont en constants déchirements entre la tentation d’utiliser cette culture de l’image dans laquelle nous baignons pour la mettre au service de la promotion de leur recherche, et le refus de céder à ce qui est perçu par certains comme une capitulation face à une culture superficielle où le contenu serait bradé au profit des apparences. Mais l’image est un moyen qui peut être utilisé à bon escient. Le dilemme consiste donc à choisir entre le statu quo (la photo sérieuse devant une bibliothèque5) ou quelque chose de vivant et représentatif de la personnalité singulière des auteur(e)s. Pour une nouvelle recrue, choisir une photo pour la page web n’est pas anodin du tout : à chaque fois, c’est l’angoisse : si j’ai l’air plus jeune sur celle-ci, me prendra-t-on au sérieux? Si j’ai l’air sympathique, est-ce qu’on suspectera que je puisse manquer de rigueur? La photo idéale aurait celle où j’aurais arboré un air sévère sous mes lunettes, boutonnée jusqu’au cou, pas trop souriante et pas trop mignonne, pour « faire sérieux ». Ça en dit long sur l’image qu’on se fait de ce que doit être un(e) intellectuel(le) et surtout sur le double standard entre hommes et femmes dans ce métier.
En somme, l’édition est une fabuleuse expérience pour quiconque a l’énergie, la patience et la motivation pour développer les projets stimulants. Le potentiel d’innovation est vaste, puisque les idées sont à tout le monde et elles sont gratuites. Mais l’imprimeur, lui, ne l’est pas. La difficulté du métier est en bonne partie là. Pour le reste, comme on dit : « cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage », c’est la clé. Ça et… respecter les dates de tombée!
- 1Billy Ehn, Orvar Löfgren, « La vie des émotions dans le monde universitaire », Ethnologie française 2008/2 (Vol. 38), p. 283-292.
- 2Bérard, Sylvie, « L’édition du livre au Québec : des chiffres et des lettres », in Panorama de la littérature québécoise contemporaine, s.l.d. Réginald Hamel, p. 686.
- 3http://www.cbc.ca/beta/news/technology/academic-publishers-reap-huge-profits-as-libraries-go-broke-1.3111535
- 4http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2014/10/20/006-bataille-autour-de-la-feminisation-des-titres-en-france.shtml
- 5http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20130206.OBS7945/les-8-astuces-pour-reussir-une-mauvaise-photo-d-ecrivain.html
- Mélissa Thériault
Université du Québec à Trois-Rivières
Mélissa Thériault est professeure au Département de philosophie et des arts de l’UQTR. Ses recherches sur le concept d’art de masse et sur les aspects sociologiques et politiques liés à la culture populaire sont parues en 2015 dans l'essai Le « vrai » et le reste. Plaidoyer pour les arts populaires. Ses travaux actuels portent sur les représentations éthiques et politiques dans la création, sur les liens entre littérature et philosophie, ainsi que sur les questions féministes. Elle est membre-chercheure du Réseau québécois de recherche en études féministes et de l’Institut de recherche en études féministes et vice-présidente de la Société de philosophie du Québec.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre