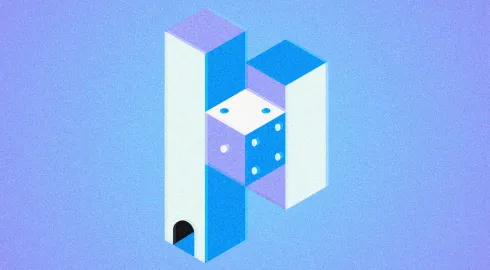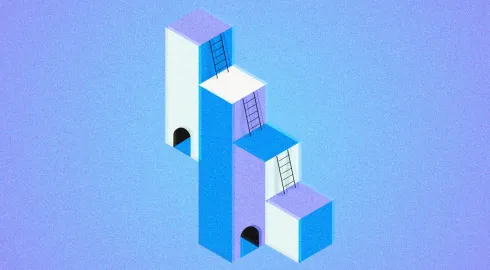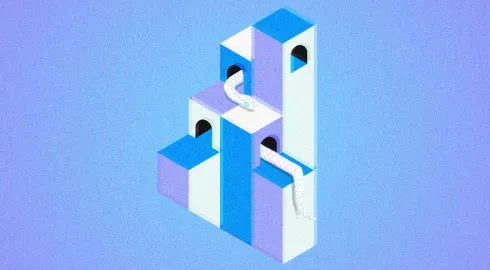Martin Hébert est directeur du département d’anthropologie de l’Université Laval. En plus d’être mon directeur de thèse, il représente l’une de mes grandes sources d’inspiration épistémologiques en anthropologie de la paix. Le défi de ce nouveau paradigme de résolutions des conflits, c’est de faire de la paix un objet empirique, là où l'essentiel de la recherche focalise son regard sur le conflit. Voici une aventure, voire un défi, auquel Martin m’incite à prendre part désormais.

Borne Djeumegued Pascal : Pour notre échange, je propose de traiter de la question de la paix en quatre moments : l’objet d’étude, la relation avec l’anthropologie, les questions spécifiques au domaine et l’expérience du terrain. Je débuterais donc en vous demandant de nous faire part de vos différentes perceptions de la notion de paix?
Martin Hébert : Il existe plusieurs définitions de la paix. Chacune d’elles conditionne les actions à mener pour atteindre cet objectif, et chacune conditionne aussi les chances de succès. La définition la plus proche du sens commun est celle de paix négative qui renvoie à une paix immédiate et d’urgence, au sens d’un cessez-le-feu dans le contexte d’une guerre, par exemple. C’est déjà un grand défi et une réussite que d’arriver à ce résultat. Mais en même temps, c’est un niveau de paix qui n’atteint pas les racines de la violence.
Que pensez-vous de la définition de la paix comme « absence de la guerre ou de la violence »?
Vous mettez le doigt sur quelque chose d’intéressant. Le piège serait de réduire l’anthropologie de la paix à un travail d’élimination des sources de souffrance. Cette vision n’est pas fausse, mais elle est incomplète. Elle est incomplète conceptuellement dans la mesure où elle se prononce sur les phénomènes auxquels nous souhaitons mettre fin – la violence et la guerre – sans rendre explicite ce à quoi nous aspirons positivement. Par ailleurs, cette définition est incomplète, car elle présente une vision binaire de la paix : soit elle est là, soit elle ne l’est pas. L’inscription de la paix dans l’Histoire et dans des sociétés humaines concrètes s’en trouve escamotée.
Cette idée de la paix hors de l’histoire a une forte teneur théologique. Elle a fait son chemin dans des philosophies politiques sécularisées sous la forme d’une recherche des conditions de la paix perpétuelle. Elle est fondée sur la conviction qu’il est possible d’identifier et d’atteindre un agencement pacifié des rapports humains qui serait définitif. Sans surprise, cette idée a été reprise par une certaine anthropologie de la violence à teneur prescriptive. Cette dernière est engagée dans la description de formes de violence de plus en plus spécifiques et dans la proposition de solutions qui permettraient de mettre fin à ces violences. Ces analyses sont un raffinement de la recherche sur la paix négative et, même si elles sont de grande importance pour s’attaquer aux sources de souffrance que nous sommes en mesure d’identifier, elles ne permettent qu’une réflexion partielle sur la nature de la paix elle-même. Bâtir la paix n’est pas uniquement un processus de soustraction où il suffirait d’extirper la violence de la société. C’est aussi un processus d’addition qui demande de produire du nouveau, de créer, d’ajouter à nos possibilités d’existence.
Bâtir la paix n’est pas uniquement un processus de soustraction où il suffirait d’extirper la violence de la société. C’est aussi un processus d’addition qui demande de produire du nouveau, de créer, d’ajouter à nos possibilités d’existence.
Avant de poursuivre sur cette question, revenons un moment à la définition de la paix comme absence de guerre. Les dictatures, comme on sait, sont des sociétés où le conflit trouve peu d’expressions publiques, beaucoup moins que dans une démocratie. Ce sont aussi des sociétés où la violence du régime n’est pas nommée telle, par celles et ceux qui la commettent. Si la domination idéologique est suffisamment grande, cette violence ne sera pas, non plus, nommée telle, par les personnes qui en sont témoins. Elles blâmeront les victimes et verront la souffrance de ces dernières comme nécessaire à l’atteinte de la paix sociale. La domination symbolique ultime, ou l’aliénation ultime selon le cadre d’analyse utilisé, ferait même en sorte que les victimes elles-mêmes soient dépossédées des mots pour nommer la violence qui leur est faite. C’est cette dynamique que Frantz Fanon a vue dans la « pacification coloniale » et décrite dans Peau noire, masques blancs (1952). L’Afrique a abondamment fait les frais de ce renversement de la logique, par lequel les métropoles disaient mettre fin aux conflits – entre les factions, les royaumes et les groupes ethnoreligieux – en imposant une paix armée et grandement répressive sur le continent. Évidemment, aucune de ces paix ne correspond à ce qu’on imagine quand on rêve de la paix. Il s’agit là de « paix du cimetière »1. C’est la paix des sociétés qui subissent l’asservissement d’un Léviathan envahissant et violent. En fait, plus le Léviathan est dominant et écrasant, moins il aura à s’engager dans des conflits ou des guerres. Il sera plutôt vu comme celui qui arbitre les conflits et met fin aux guerres. Ses violences peuvent être tellement systémiques et imbriquées dans toutes les sphères du social que son usage de la violence physique directe peut devenir un recours de moins en moins utilisé. Bref, c’est pourquoi lier notre compréhension de la paix à l’absence de conflits, de guerre ou même de violence physique directe nous donne une vision incomplète, voire déformée, de la paix en tant qu’aspiration humaine.
Pour poursuivre cette réflexion, est-ce que nous pouvons historiquement retracer quelques conceptions disciplinaires de la paix?
Comme j’ai commencé à l’esquisser plus haut, dans plusieurs traditions du monde la paix a d’abord un sens théologique ou spirituel. Dans le christianisme, son expression ultime est ce qu’on appelle la Parousie, c’est-à-dire la paix de la fin des temps, comprise comme ultime, perpétuelle et éradiquant toute souffrance. Ce n’est pas une paix accessible dans l’Histoire, mais plutôt au terme de l’Histoire.
Au 18e siècle, certains philosophes tenteront de traduire cette idée de la paix paradisiaque dans les affaires humaines. Emmanuel Kant s’est intéressé par exemple aux conditions de cette paix perpétuelle. Sachant que la paix des textes religieux n’était pas du ressort de l’humain, il se demande ce que l’humain peut faire avec ses propres moyens pour obtenir une telle paix, ou un état qui en est aussi proche que possible. Cette perspective ouvrira un champ de réflexion sur une paix qui ne s’obtient plus par la vertu, mais par la raison. Il y a un passage assez célèbre de Kant sur le projet de paix perpétuelle où il écrit que l’institution de l’État, qui était pour lui l’approximation la plus proche de la paix pouvant être réalisée par l’humain, « n’est pas insoluble, même pour un peuple de démons (pourvu qu’ils aient un entendement) »2. Il y a ici un découplage entre la morale et la paix. Cette dernière peut être aussi le fruit de l’intérêt bien compris, de l’adhésion à l’idée que la collectivité bénéficie davantage d’un monde pacifié que d’un monde en conflit perpétuel.
Cette tradition de la philosophie politique contribuera à placer l’État au cœur de la compréhension de la paix. Thomas Hobbes est le philosophe qui incarne le mieux cette vision où l’État est un gardien qui nous protège de la guerre de tous contre tous et où la poursuite non régulée de l’intérêt individuel mène inévitablement à la guerre. On trouve dans sa philosophie l’expression de ce besoin de remettre une partie de notre souveraineté entre les mains d’une entité qui surplombe, d’un Léviathan, pour le maintien de la sécurité et de la paix, entendue ici au sens de l’ordre.
Dans cette vision, la paix repose sur le pouvoir de l’État, sur sa capacité à la maintenir au moins à l’intérieur de ses frontières. Hobbes croyait que les États, dépourvus d’un Léviathan qui les surplombe eux-mêmes, étaient condamnés à vivre dans un état de nature d’échelle internationale. Mais d’autres transposeront ses idées dans cette sphère, imaginant une paix sous l’égide d’une forme ou d’une autre de gouvernement mondial. Les Nations Unies procèdent d’une telle vision de la paix.
Graduellement l’anthropologie politique, notamment avec l’ouvrage African Political Systems3 de Fortes et d’Evans-Pritchard, va soutenir l’argument que la place centrale accordée à l’État pour penser le politique est surfaite, d’autant plus lorsqu’il est question de comprendre les conflits et la paix. Réfléchissant sur les royautés africaines, par exemple, l’anthropologue sur le terrain verra bien qu’on n’est pas devant un État bureaucratique. Pourtant ces structures sociales jouaient un rôle clé dans le maintien de la paix, dans la gestion des conflits internes au royaume et même dans la pratique d’une diplomatie entre les groupes. Tout cela, sans le type de centralisation du pouvoir que les Européens attendaient d’un État et que la philosophie politique occidentale posait – et pose toujours dans une large mesure – comme condition sine qua non de la paix. La paix et la guerre peuvent donc exister et se comprendre dans des structures sociales extrêmement diversifiées.
L’anthropologie politique qui se développe dans le contexte africain deviendra certainement une inspiration pour les travaux réalisés ailleurs. Elle sera notamment importante pour aider à comprendre ce qui en est venu à être nommé « les équilibres dynamiques ». La théorie hobbesienne perçoit le désordre comme une menace à la structure. Le conflit et la contestation y sont des pathologies qui menacent de faire tomber la société dans le chaos et la désintégration. Or, l’anthropologie politique naissante proposera une vision plus dynamique de la société, marquée par des périodes de stabilité, peut-être, mais surtout par des périodes de reconfiguration qui peuvent sembler « chaotiques » à un regard extérieur, mais qui ne le sont pas. L’exemple ethnographique le plus frappant de cette configuration du politique fut sans doute donné par Edmund Leach dans son livre Les systèmes politiques des Hautes-terres de Birmanie (1954). Leach montra que le pouvoir politique d’un groupe, de même que plusieurs de ses attributs culturels, étaient oscillants et fluctuants dans le temps. Ainsi, la Birmanie précoloniale n’était pas composée d’États-nations, mais présentait plutôt une toile d’ « États-mandala ». Selon ce modèle, élaboré par O. W. Wolters dans son ouvrage History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives (1982), un centre politique spatialement restreint exerce un contrôle relatif sur des auréoles concentriques. Ce pouvoir décroît à mesure que les distances-temps augmentent. Le pouvoir du souverain ne repose donc que sur des alliances, souvent fluides et conflictuelles, avec des chefs de villages. En d’autres termes, l’état normal du pouvoir dans cette région était d’être morcelé, négocié et disputé. Comme dans d’autres régions du monde, ce caractère dynamique des structures et des positions sociales interagit mal avec l’imposition coloniale d’un système politique occidental où les structures et les institutions sont rigides, centralisées et souvent défendues coûte que coûte par la force. L’équilibre dynamique où le conflit et la dissidence sont habituels et impliquent souvent des niveaux de violence relativement limités se transforme alors en Léviathan aux ambitions disproportionnées. Non seulement ce Léviathan vit-il et meurt-il par la violence, mais surtout en contexte colonial, sa constitution et son effondrement a généralement impliqué des niveaux de violence inédits dans les régions où il a été implanté.
La théorie hobbesienne perçoit le désordre comme une menace à la structure. Le conflit et la contestation y sont des pathologies qui menacent de faire tomber la société dans le chaos et la désintégration. Or, l’anthropologie politique naissante propose une vision plus dynamique de la société, marquée par des périodes de stabilité, peut-être, mais surtout par des périodes de reconfiguration qui peuvent sembler « chaotiques » à un regard extérieur, mais qui ne le sont pas.
Certains anthropologues4 font remonter l’intérêt de leur discipline pour la paix au début des années 1980, époque où elle était encore largement occupée à décrire des sociétés traditionnelles et exotiques. Comment expliquer ce nouvel intérêt?
Je dirais d’abord qu’il faut se méfier du découpage produit par nos catégories. Les anthropologues, et ce depuis l’émergence même de la discipline, ont été impliqués dans des questions de justice sociale. La lutte contre le racisme scientifique est un exemple d'une telle bataille où des idées comme l’unité de l’espèce humaine ou le relativisme culturel sont venues répondre au racisme qui nourrissait d’autres pans de la discipline. Aujourd’hui, ce combat serait vu comme faisant partie d’un engagement pour la paix.
À la fin du 19e siècle, le paradigme de l’État était tellement dominant que les anthropologues ne pensaient pas avoir grand-chose à dire sur la paix, outre peut-être celle observée à l’échelle microsociale dans certaines sociétés que l’on voyait, à tort, comme idylliques. Mais la paix bâtie par des processus politiques, elle, était vue comme le métier des généraux et des diplomates. Au début du 20e siècle, un certain nombre d’anthropologues s’impliqueront dans ce qu’on a appelé le mouvement internationaliste5 qui contient, pourrions-nous dire, le prototype de la vision contemporaine de l’anthropologie sur la paix. Ces positions étaient d’abord anticoloniales – ou du moins prônaient une humanisation du colonialisme – puis devinrent aussi antiguerre et antimilitaristes après l’éclatement de la Première Guerre mondiale.
Le mouvement internationaliste brisait le monopole de l’État sur les relations entre nations et se caractérisait par l’idée que les « citoyens du monde », comme on se déclarait à l’époque, avaient aussi un rôle à jouer dans la paix entre les États; la paix globale se construisant aussi à travers les contacts de personne à personne. Le mouvement espérantiste en est un exemple typique6. Il encourageait l’accès aux cultures à travers la connaissance des langues auxiliaires comme l’interlingua, l’espéranto ou l’ido (soit les langues construites ou conçues dans un objectif de neutralité, afin de transcender les clivages culturels), considérées aussi comme des langues internationalistes. Plusieurs anthropologues fondateurs de la discipline, dont Bronislaw Malinowski, ont été impliqués dans ces mouvements et ces réseaux.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Américaines Ruth Benedict et Margaret Mead ont prôné des approches non militaires à la gestion des conflits entre les États. Ruth Benedict, connue pour ses positions prises quant à la guerre du Pacifique, croyait que la voie de sortie du conflit était de bâtir des ponts d’intercompréhension entre les États-Unis et le Japon. Elle estimait que la grande violence de la guerre du Pacifique s’expliquait par la distance culturelle considérable entre les deux protagonistes. Les connaissances interculturelles auraient permis, a-t-elle soutenu dans les avis qu’elle fournissait à l’état-major américain, de sortir de cette guerre sans une escalade vers l’extrême.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les positions anticoloniales commencèrent à s’affirmer un peu plus dans les travaux des anthropologues. Le mythe de la société intouchée par la modernité avait alors été battu en brèche, et il s’agissait de décrire les sociétés telles qu’elles existaient concrètement et empiriquement dans le monde, c’est-à-dire, pour la plupart d’entre elles, inscrites dans une « situation coloniale »7. L’engagement politique des anthropologues devenait plus apparent dans le choix des thèmes abordés dans leurs écrits. Cependant, cet engagement n’était pas explicitement présenté comme un intérêt analytique ou une militance pour la paix. Ce terme relevait encore et surtout de préoccupations antiguerres et antimilitaristes.
C’est dans le contexte de la Guerre froide que nous observerons en anthropologie une convergence plus claire entre le thème de la paix et ceux de l’anticolonialisme et des droits civiques. Elle sera visible dans l’implication d’anthropologues au sein du Peace Movement qui se développera en opposition à la guerre du Vietnam. Elle le sera aussi dans la montée en visibilité des intellectuels du Sud, par exemple avec le lancement de la revue Présence africaine en 1947, qui vient interpeller les manières classiques de faire de l’anthropologie. Mais ces dynamiques militantes ont aussi un pendant géopolitique. Les conflits de la Guerre froide et ceux qui suivront la chute du Mur de Berlin se dérouleront souvent à ce que l’on pourrait appeler une échelle ethnographique. Conflits intraétatiques, conflits ethniques, guerre dite « irrégulière », affrontements entre factions, clans et groupes religieux, toutes ces configurations semblent davantage lisibles à partir des savoirs ethnographiques qu’à partir des dynamiques entre États ou entre empires.
Les Balkans, le Rwanda et la Somalie, en particulier, montreront que la paix demande davantage que la négociation de traités entre diplomates. Elle demande à la fois une connaissance fine de la complexité du terrain et des défis liés à la mise en œuvre de plans de paix. Les méthodes ethnographiques sont adaptées pour saisir ces questions. Entre le début des années 1980 et le début des années 1990, nous voyons donc une synthèse s’opérer entre les acquis de l’anthropologie politique classique, l’engagement qui s’est affirmé dans la militance pour la paix durant les années 60 et 70, et l’apport grandissant de l’anthropologie à notre compréhension des conflits intraétatiques de l’époque post-Guerre froide. Cette convergence sera l’occasion pour l’anthropologie de commencer à systématiser son regard sur la paix.
Les Balkans, le Rwanda et la Somalie, en particulier, montreront que la paix demande davantage que la négociation de traités entre diplomates. Elle demande à la fois une connaissance fine de la complexité du terrain et des défis liés à la mise en œuvre de plans de paix. Les méthodes ethnographiques sont adaptées pour saisir ces questions.
Les anthropologues sont donc sur le « terrain » de la paix depuis le début du siècle dernier, et à partir du milieu des années 1980, cette question apparait explicitement dans leurs travaux scientifiques. C’est là qu’émergent des écrits anthropologiques sur la paix et portant sur des sociétés de petites tailles. Est-ce que nous pouvons alors affirmer que la spécialité de l’anthropologie, c’est l’échelle locale?
L’anthropologie propose un regard et des outils qui ont, en effet, une portée et des limites qui leur sont propres. Ce serait une erreur de penser que l’ethnographie et l’anthropologie sont des clés qui déverrouillent tout. Comprendre les conflits, la violence et la paix est une entreprise nécessairement multidisciplinaire. Mais la multidisciplinarité est souvent menacée par l’éclectisme, la superficialité et l’impression, au bout du compte, que tout le monde fait à peu près la même chose. Ceci ne sert pas bien notre volonté de compréhension rigoureuse de dynamiques extrêmement complexes. Ainsi, il semble important de bien cerner la contribution de chaque discipline, puis de réfléchir avec précision à la manière de mettre ces savoirs en relation les uns avec les autres. Dans cette perspective, oui, l’anthropologie contemporaine peut être vue comme fondamentalement investie dans la compréhension du local.
Cela n’a pas toujours été le cas. Avant les années 1980, par exemple, l’anthropologie s’interrogeait beaucoup sur des questions comme l’universalité de la violence, les bases évolutives de l’agression et de la coopération, etc. Elle a délaissé ces questions pour s’investir dans l’étude des sens locaux et des structures locales des conflits et de la violence. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’apparition de l’anthropologie de la paix sous sa forme contemporaine se produise dans les années 1980. Les préoccupations de l’anthropologie, et son bagage hérité de l’anthropologie politique classique, sont alors à l’image des types de conflits et des nouvelles opérations de paix8 de l’époque. Les conflits qui préoccupent alors le plus la communauté internationale sont, par exemple, à petite échelle, localisés, issus d’une segmentation de sociétés ethniques et claniques. Ce sont des entités que les anthropologues saisissent bien. Ils en ont les outils d’analyse.
Incidemment, les anthropologues contribueront aussi à faire remonter les leçons tirées de l’observation de sociétés traditionnelles vers le fonctionnement d’entités étatiques et bureaucratiques. Pensons par exemple au mouvement de l’alternative dispute résolution (ADR)9, soit la gestion alternative des conflits, qui gagnent en popularité dans l’administration publique et dans le droit de plusieurs pays. Mais tout ceci est situé dans le temps et dans la contingence, notamment dans un contexte, allant de la fin des années 1980 jusqu’à la fin de la première décennie des années 2000, où le pouvoir hégémonique américain est peu contesté.
Dans un monde qui redevient multipolaire, la grande géopolitique reprend certainement une place très importante dans notre compréhension des conflits et des guerres. On comprend bien que le conflit ukrainien, dans son stade actuel, ne se résoudra pas avec des comités de réconciliation communautaire. Idem pour le Moyen-Orient ou ce qui bouillonne autour de Taïwan. Quand on entre dans des questions de géopolitique nucléaire et de guerre économique à l’échelle d’un continent, les outils anthropologiques deviennent un peu comme des pincettes avec lesquelles nous tenterions de lever un éléphant.
Cela étant dit, toutes les disciplines éclairant les conflits, de la psychologie individuelle jusqu’aux relations internationales, ont leur pertinence. C’est l’importance de chacun des facteurs et de chacune des échelles qui varie selon la nature du conflit et son stade d’expression. Ajoutons à cela que l’anthropologie parle, en effet, de l’échelle locale, mais que son développement au cours des dernières décennies nous a montré que toutes les instances peuvent être étudiées comme des localités. Il existe des ethnographies du fonctionnement des Nations-Unies, de parlements, de la Banque Mondiale, de l’industrie militaire, et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que l’anthropologie peut tout éclairer, mais elle peut certainement contribuer à comprendre ethnographiquement les connexions de proche en proche qui lient de grandes entités comme les Nations-Unis avec des entités locales, comme un village rwandais.
L’anthropologue Paul Farmer parlait de documenter les « chaines d’approvisionnement de la violence ». L’expression me semble très juste et appropriée pour éclairer la réalité voulant qu’en fin de compte, tout est local. Tenter d’ethnographier l’ensemble des connexions qui lient huit milliards de personnes humaines entre elles est cependant impossible. L’ethnographie ne nous permet de saisir qu’une petite partie de ces connexions, mais en détail.
...toutes les disciplines éclairant les conflits, de la psychologie individuelle jusqu’aux relations internationales, ont leur pertinence. C’est l’importance de chacun des facteurs et de chacune des échelles qui varie selon la nature du conflit et son stade d’expression. Ajoutons à cela que l’anthropologie parle, en effet, de l’échelle locale, mais que son développement au cours des dernières décennies nous a montré que toutes les instances peuvent être étudiées comme des localités.
Margaret Mead reprochait à l’anthropologie de limiter son essence à des petites sociétés ou aux conflits mineurs10. Comment analyser sa position au regard des questions de sécurité actuelle?
Il faut d’abord recontextualiser cette affirmation de Mead. À l’époque, l’anthropologie était encore largement confinée à l'étude de sociétés non occidentales. Son projet, au contraire, était d’appliquer les méthodes ethnographiques aussi aux État-Unis. Mead était pionnière par cette volonté de tourner le regard ethnographique vers sa propre société. Ce regard ne fait pas qu’ethnographier cette société, il signale aussi qu’elle est de même nature que les sociétés dites « ethnographiques », ce qui n’était pas du tout admis – et probablement considéré comme insultant par plusieurs – à l’époque où elle écrivait Coming of Age in Samoa, par exemple. Elle parlait de « symétrie », une idée qui sera reprise par la génération d’anthropologues qui lui succédera.
L’idée de symétrie dans le regard que l’on pose sur sa propre société et sur les sociétés dites exotiques jouera un rôle clé dans la convergence que je décrivais plus haut entre l’anthropologie politique classique, la militance pour la paix et l’analyse ethnographique des conflits et des violences à partir des années 1980. Cela permettra, par exemple, à plusieurs anthropologues militant contre la guerre américaine au Vietnam dans les années 1970, de dire que ce qui se passe dans les jungles d’Asie du Sud-Est peut être retracé jusque dans les bureaux à Washington, dans une chaîne d’interactions qui lient entre eux une foule d’acteurs qui interviennent entre les architectes de la stratégie américaine et les habitants d’un village vietnamien dont ils commandent le bombardement. Qui fait les bombes? Qui est envoyé au front? Pourquoi ce village en particulier? L’enchainement de ces questions développe un regard ethnographique sur le global. Dans les années 70, ce fut-là un tournant important qui faisait en sorte que, soudainement, un bureau de planificateurs militaires au Pentagone devenait aussi local qu’un village sud-vietnamien. Les connexions globales peuvent ainsi être ethnographiées et saisies d’une manière anthropologique.
Que nous dit ce regard anthropologique? Principalement que les institutions de la gouvernance locale et globale ont un fonctionnement concret qui est sensiblement différent de ce que prescrit leur charte explicite. Les réseaux qui connectent diverses localités ont des mandats, des organigrammes, des missions. Ils codifient les rôles des acteurs, mais ils sont aussi composés de connexions informelles, non dites, pleines de présupposés naturalisés. Quand un conflit éclate, tout cela en vient à jouer dans sa dynamique. La paix définie sur le papier du traité, et la paix vécue ou trahie dans la vie quotidienne sont toutes deux des produits de ces connexions complexes et variables.
[L'anthropologue étatsunienne Margaret] Mead était pionnière par cette volonté de tourner le regard ethnographique vers sa propre société. Ce regard ne fait pas qu’ethnographier cette société, il signale aussi qu’elle est de même nature que les sociétés dites « ethnographiques », ce qui n’était pas du tout admis – et probablement considéré comme insultant par plusieurs – à l’époque où elle écrivait Coming of Age in Samoa, par exemple.
L’anthropologue culturelle Sherry Ortner reprochait à sa discipline de s’être trop longtemps focalisée sur l’anthropologie sombre11 au lieu d’être la servante de l’humanité en s’engageant davantage pour les transformations sociales et pour la paix. Selon vous, quels liens pouvons-nous établir entre l’anthropologie engagée et l’anthropologie de la paix?
Comme nous avons pu le voir l’anthropologie engagée a toujours existé, même si de la fin du 19e au milieu du 20e siècle, nous pourrions dire que la norme de présentation de soi était plutôt celle du chercheur désintéressé. La discipline ne devait pas se mêler d’intervenir sur les conditions sociopolitiques sous peine de perdre sa légitimité institutionnelle. L’exception, bien entendu, est que l’anthropologie pouvait être aussi interventionniste qu’elle le souhaitait lorsqu’il s’agissait de favoriser les institutions dominantes, comme dans les projets d’appui à la transition vers la production capitaliste qui furent le pain et le beurre de l’anthropologie appliquée à partir des années 1950. Le changement dont parle Ortner est un renouvellement au niveau de la compréhension de l’objet anthropologique, tout autant qu’une transformation de la perception de ce qu’est l’engagement.
La période de l'histoire de la discipline allant de 1870 à 1950 est caractérisée, entre autres, par l’ethnographie de sauvetage. La mission des anthropologues à la fin du 19e siècle consistait à décrire des cultures avec un souci de conservateur de musée. On recueillait les chansons, les langues. On mettait sur papier les structures de parenté des sociétés traditionnelles menacées de disparition par le colonialisme ou par la modernité. Quand vous travaillez dans cette optique, vous voyez autour de vous la désintégration d’un monde12. C’est ce que Ortner appelle l'« anthropologie sombre », qui capte avant tout la violence et les souffrances, qui note les forces exogènes qui contribuent à la désintègration des cultures locales. Cette vision est logique dans le contexte des génocides ou des ethnocides issus des grands projets dominateurs qui ont complètement désarticulé les structures sociales des colonies.
On appellera cette période le moment « diagnostique ». Ceci dit, l’anthropologie sombre a toujours sa place, car elle porte un regard critique, elle donne à voir les injustices et leurs conséquences. Cette anthropologie est une proche parente de la paix négative dont je parlais plus tôt. Elle identifie les violences et tente de les dénoncer, d’en mitiger les effets, ou de les faire cesser à la pièce. Quand la maison brûle, on appelle les pompiers, pas un architecte.
Il ne faut donc pas établir une opposition entre l’anthropologie sombre et une anthropologie de l’espérance ou engagée dans la production de nouveaux possibles sociopolitiques. Chacune rend compte d’une partie de la réalité. La première voit les sociétés ethnographiées aux prises avec la déstructuration et la souffrance que cause la violence. La seconde les saisit dans un processus de restructuration et d’espérance. Il n’est pas rare, par ailleurs, que les deux dynamiques se déroulent simultanément. C’est peut-être cette simultanéité qui a été la plus difficile à saisir pour l’anthropologie. Le regard ethnographique classique – celui dont procédait l’ethnographie de sauvetage – a eu tendance à décrire les sociétés de manière assez statique. Ainsi, les Trobriandais devenaient ceux décrits par Bronislaw Malinowski13, les Nuer devenaient ceux décrits par Edwards E. Evans Pritchard, et ainsi de suite. Tout écart à ces versions de référence devenait problématique. Dans la désarticulation coloniale, capitaliste, impérialiste, on trouve simultanément de l’agentivité et de la création sociale. Voir les deux dynamiques simultanément fut très difficile pour l’anthropologie.
Tout un cheminement a eu cours dans la théorie anthropologique pour en arriver à prendre en compte la complexité de ces dynamiques sociales en contexte conflictuel et violent. Mais c’est dans cette complexité que l’anthropologie engagée prend tout son sens. Sinon, comme l’ethnographie de sauvetage, elle est tout entière absorbée par ce qui a été perdu, ne pouvant imaginer d’autre futur que celui d’un retour à l’état d’avant le conflit et d’avant la violence dénoncée. Les tragédies permettent rarement un tel retour en arrière. Aussi difficile que cela puisse paraitre, elles demandent d’imaginer de nouveaux futurs. C’est à cet acte que fait référence Ortner en parlant d’une anthropologie de l’espoir qui est le complément nécessaire de l’anthropologie sombre. Cet espoir, il va sans dire, n’est pas le projet personnel de l’anthropologue, mais plutôt l’attention portée aux mondes qui naissent de l’intentionnalité de nos interlocutrices et interlocuteurs sur le terrain.
L’attention donnée à la production du futur tente de remettre à l’avant-plan cette capacité qu'ont les personnes à façonner leur propre culture même dans des contextes de guerre civile où le tissu social est déchiré en lambeaux. On a vu au Rwanda par exemple des gens mettre en place une vision de la société qu’ils voudraient construire et habiter. C’est au changement social intentionnel que l’anthropologie a décidé finalement de s’intéresser.
...l’ethnographie de sauvetage, [...] est tout entière absorbée par ce qui a été perdu, ne pouvant imaginer d’autre futur que celui d’un retour à l’état d’avant le conflit et d’avant la violence dénoncée. Les tragédies permettent rarement un tel retour en arrière. Pour aussi difficile que cela puisse paraitre, elles demandent d’imaginer de nouveaux futurs. C’est à cet acte que fait référence Ortner en parlant d’une anthropologie de l’espoir qui est le complément nécessaire de l’anthropologie sombre.
Dans votre article « Présentation : paix, violences et anthropologie14 », pourquoi avez-vous choisi de parler d’anthropologie de la paix et non pas d’anthropologie pour la paix?
Je trouve intéressant que vous souleviez ce point, parce que j’ai toujours résisté à l’idée d’une anthropologie pour la paix.
Quand on dit « pour la paix », on en fait une question de conviction personnelle, et on centre la perspective sur la personne qui parle ou qui agit. Vous pouvez jouer pour la paix au soccer, au tennis, etc. Sous cet angle, l’anthropologie n’a rien de particulier à apporter à l’humanité. Nul besoin d’être anthropologue pour faire quelque chose pour la paix.
En revanche, là où l’anthropologie peut contribuer en tant que telle, c’est en faisant de la paix un objet empirique. Cela nécessite un véritable effort analytique, implique de la rigueur, des débats et, surtout, une accumulation graduelle de savoirs qui nous aident à raffiner notre compréhension de ce que nous recherchons lorsque nous nous intéressons à la paix dans un contexte donné.
Le travail anthropologique sur cette question est encore embryonnaire. Dans les années 1980, les premiers textes auxquels vous faites référence, des livres comme Societies at peace15 par exemple, présentaient une approche assez grossière et calquée sur un modèle de l’anthropologie classique où l’on cherchait à identifier des sociétés en paix. On se demandait si les Inuits ou les Zapotèques du Mexique étaient des peuples pacifiques, sans autres qualificatifs. Soit une société était pacifique, soit elle ne l’était pas.
Cette vision était essentialiste et la question centrale qu’elle posait était mal dégrossie. Quiconque entreprenait un terrain ethnographique le moindrement soutenu et rigoureux voyait rapidement que les peuples réputés « pacifiques » avaient aussi leurs dynamiques de contrainte, de conflit, de déviance, de transgression, et ainsi de suite. Tout ordre social est soumis à des forces centripètes et à des forces centrifuges. Comme l’a bien noté le philosophe roumain Emil Cioran, une société du pur consensus – c’est-à-dire une utopie – est une société hors de l’histoire et aucune société humaine n’est hors de l’histoire.
Ayant écarté cette vision romantique et essentialisée des sociétés pacifiques, il faut donc à nouveau nous demander ce qui fait qu’un rapport social contribue à la paix ou pas. Ayant opté pour ramener la paix dans le domaine des sociétés concrètes, il faut nous intéresser, pourrait-on dire, au processus de production de cette paix. Il n’est pas possible d’aborder cette question à l’échelle ethnique, et encore moins à l’échelle nationale. Il faut aller dans le détail, développer une compréhension plus fine des rapports sociaux, tant les violents que ceux qui semblent contribuer non pas à la pacification, mais bien à la paix, entendue au sens de la pleine réalisation du potentiel humain en harmonie avec notre milieu.
Avec cette approche, on peut trouver des conditions de la paix dans une vaste gamme de rapport sociaux. Parfois même, on peut les trouver où cela parait contre-intuitif. Dans des travaux de terrain que j’ai menés au Mexique, par exemple, j’ai pu observer que l’imaginaire, qui assurait la cohésion au sein de factions et de villages engagés les uns contre les autres dans des conflits violents, pouvait être mobilisé dans des processus de réconciliation entre ces mêmes factions ou villages. Paradoxalement, plus les obligations envers les ancêtres étaient invoquées pour justifier la défense de son bien contre la famille voisine ou contre le village voisin, plus cet imaginaire devenait une ressource importante pour cimenter la paix avec ces anciens ennemis. Pour paraphraser Albert Camus, une bonne raison de se battre est aussi une bonne raison de faire la paix.
Dans des travaux de terrain que j’ai mené au Mexique, par exemple, j’ai pu observer que l’imaginaire, qui assurait la cohésion au sein de factions et de villages engagés les uns contre les autres dans des conflits violents, pouvait être mobilisé dans des processus de réconciliation entre ces mêmes factions ou villages. Paradoxalement, plus les obligations envers les ancêtres étaient invoquées pour justifier la défense de son bien contre la famille voisine ou contre le village voisin, plus cet imaginaire devenait une ressource importante pour cimenter la paix avec ces anciens ennemis.
Nous avons noté qu’il y a un foisonnement d’écrits anglo-saxons dans le domaine et très peu dans le monde francophone. Est-ce la raison de votre engagement à faire de la recherche sur ces questions en français?
Un débat existe en sciences sociales où l’on se demande s’il ne serait pas mieux d’avoir une langue commune pour la communauté scientifique plutôt que de continuer à effectuer des recherches dans une diversité des langues humaines.
Mes trois premières années comme professeur ont été passées aux États-Unis, où j’enseignais dans un programme d’études de la paix et des conflits. Comme on s’en doute, mon travail dans ce contexte se réalisait en anglais. Cela m’a permis de constater à quel point la langue peut cadrer notre manière de penser. Chacune offre un coffre à outils où les manières d’organiser les idées et de construire les arguments ne sont pas tout à fait les mêmes. Je trouvais que nager dans cette seule littérature anglophone sur la paix et les conflits devenait redondant. Quand vous lisez votre premier texte, vous trouvez qu’il est génial; le 12e répète déjà en partie ce que le premier disait. Puis le 200e apporte une quantité assez minime d’informations supplémentaires. Là, il faut passer à une autre langue.
Mon choix de revenir au français et de penser en français, c’était comme reprendre le même problème, mais d’en voir de nouvelles facettes. Cela permet de le défamiliariser et de l’envisager autrement. Par exemple, le monde anthropologique anglo-saxon était très imprégné à l’époque, d’une interprétation psychoculturelle des conflits sociaux. Le monde francophone s’est davantage intéressé aux conflits sociaux du point de vue de l’imaginaire. En fait, je me rappelle avoir donné une conférence où j’utilisais le terme « the imaginary » comme un substantif, et mon public anglophone ne comprenait pas cette construction étrange. Aujourd’hui, sous l’influence de la traduction des écrits de Paul Ricoeur ou de Cornelius Castoriadis notamment, le terme a fait son chemin en anglais. Mais au début des années 2000, il sonnait encore étrange à un auditoire américain. Nous pourrions entrer dans les différences techniques entre ces deux lexiques – celui du psychoculturel et celui des imaginaires sociaux – mais disons simplement que chacun débouche sur des ethnographies très différentes.
Mon choix de revenir au français et de penser en français, c’était comme reprendre le même problème, mais d’en voir de nouvelles facettes. Cela permet de le défamiliariser et de l’envisager autrement.
Écrire en français permet donc de poser un regard différent sur la question de la paix, une sorte de manière francophone de faire de l’anthropologie inscrite non seulement dans une langue différente, mais aussi dans des traditions différentes, notamment dans des traditions intellectuelles moins réfractaires à la philosophie que peut l’être l’anthropologie pratiquée en anglais.
Les réflexions du monde anglophone sur la paix et les conflits sont d’abord largement issues du monde colonial britannique, surtout jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, le centre de gravité se déplace vers les États-Unis, dont l’identité nationale s’est développée tout autrement, soit dans l'apparent rejet du colonialisme à l’européenne et dans la pratique concrète de l’impérialisme. Ce sont des pensées différentes, mais toutes deux développées à partir du centre du système-monde à des époques où la Grande-Bretagne et les États-Unis occupaient respectivement cette position. Ces penseurs qui y ont réfléchi à la paix habitaient donc des pays qui étaient les principaux vecteurs de violence et de domination à l’échelle planétaire. La paix telle qu’elle a été conceptualisée par l'anthropologie aux États-Unis, par exemple, est souvent un acte de résistance des chercheurs face aux comportements impérialistes de leur gouvernement.
Décider d’écrire en langue française, c’est donc ramener ces questions de paix au cœur du débat et de les faire connecter avec une tradition de réflexion sur la paix et la guerre dans le monde francophone. Raymond Aron ou Gaston Bouthoul, tous deux pionniers dans les études de la paix et de la guerre, ont très peu de visibilité dans le monde anglophone. C’est donc une manière d’ajouter à un dialogue plus vaste. Mon but pour l’instant, c’est de travailler sur des terrains qui touchent l’univers francophone, y compris l’univers canadien. Le Canada a une place dans l’échiquier mondial très différente de celle des États-Unis. Ce n’est pas une superpuissance, mais en même temps, historiquement, il se cache derrière les superpuissances. Cette position change complètement le rapport aux dynamiques globales.
La langue française n’est pas qu’une question linguistique, c’est aussi une question d’épistémologie et de travail à partir d’une position sociale donnée.
Quelle place pour l’interdisciplinarité dans l’anthropologie de la paix?
Quand les populations sont activement en train de se tirer dessus et de se massacrer, la solution ne passe souvent que par l’intervention d’une force d’interposition. On commence par sauver des vies et après, on travaille sur les questions de fond. C’est là que les outils plus sophistiqués de l’anthropologie entrent en ligne.
Le champ de la paix est un enjeu multidisciplinaire. Dans cette multidisciplinarité, nous avons besoin des soldats, des policiers, certes et pourvu qu’ils soient bien formés, mais aussi des humanitaires pour palier au tissu social déchiré et de leaders communautaires capables de réconcilier les cœurs. Comme je l’ai déjà mentionné, le rôle de l’anthropologie, lui, est de contribuer à notre compréhension fine des conflits. À mon avis, elle est indispensable pour bâtir des paix durables et bien ancrées dans le local. Mais elle a ses biais. Elle sous-estime l’impact qu’une personne et sa psychologie peuvent avoir sur un conflit. L’anthropologie est muette devant l’émergence de figures idiosyncrasiques comme Vladimir Poutine ou Donald Trump. Pourtant, ces sociopathes ont un impact majeur sur le monde. Même chose pour les structures formelles ou les processus institutionnels. L’anthropologie aime les interstices et l’informel des grandes institutions, mais elle est beaucoup moins bien placée que les sciences politiques et économiques pour les analyser lorsque celles-ci jouent le rôle pour lequel elles ont été créées. Nous pourrions dire que l’anthropologie est la spécialiste de ce qui est structuré, mais pas trop. Aux deux bouts du spectre, soit le bout du totalement singulier et le bout où les institutions se comportent comme elles le devraient, l’anthropologie a besoin de s’appuyer sur d’autres disciplines.
Nous pourrions dire que l’anthropologie est la spécialiste de ce qui est structuré, mais pas trop. Aux deux bouts du spectre, soit le bout du totalement singulier et le bout où les institutions se comportent comme elles le devraient, l’anthropologie a besoin de s’appuyer sur d’autres disciplines.
Un mot peut-être sur ce qui sévit en Haïti. C’est l’insécurité totale et les gens demandent au Canada d’envoyer des forces d’interposition au moins juste pour restaurer une sécurité minimale dans les rues. Mais celui-ci refuse. Votre position?
Le Canada prend une position tout à fait inappropriée en refusant cette aide sous prétexte que le conflit est complexe et qu’on ne saurait intervenir. Certes, il ne voudrait pas être considéré comme impérialiste. Ce n’est pas ce que les gens demandent. Ils demandent simplement du secours pour établir une sécurité minimale. Dans les termes que nous avons utilisés ici, on demande que soit au moins établie une paix négative pour que le peuple haïtien puisse avoir l’espace et la tranquillité nécessaires pour exercer son autodétermination. Ce qui est demandé, ce sont des patrouilles dans les rues pour ne pas se faire dévaliser chaque fois que l'on met le pied en dehors de chez soi. Une fois la sécurité rétablie, la société haïtienne est capable de négocier des voies de sortie et de paix.
Au demeurant, comment envisagez-vous l’avenir de l’anthropologie de la paix au Québec, au Canada et dans le monde?
Depuis plusieurs décennies déjà, le champ des études de la paix s’est développé et diversifié d’une manière impressionnante. Un défi sera de maintenir une bonne communication entre les disciplines et entre les champs de spécialisation qui se découpent de plus en plus à l’intérieur même de cette question.
Comme déjà mentionné, il semble évident, avec les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et autour de Taïwan, que nous revenons à une dynamique d'un monde pluripolaire, où minimalement l’OTAN, la Russie et la Chine défendent leur sphère d’influence. Ce développement nous demande de bien cultiver les ponts entre les générations de chercheuses et de chercheurs, de militantes et de militants, impliqués dans les questions de paix.
Nous assistons à une résurgence de la menace d’un conflit nucléaire. Une quantité phénoménale d’expériences, de réflexions et d’outils d’analyse ont été développés dans les années 1960, 70 et 80 pour penser la paix dans un contexte de destruction mutuelle assurée. Il faut garder bien vivante la mémoire de ces mouvements à la fois intellectuels et citoyens.
Par ailleurs, les études de la paix, comme tous les autres champs, doivent être une force positive pour faire face aux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés, en particulier ceux liés aux bouleversements climatiques. Le monde devient malheureusement encore plus dur qu’il ne l’a été depuis longtemps. Ceci rend la question de la paix indissociable de celle des futurs que nous sommes en mesure d’imaginer et de produire ensemble. Ces futurs ne peuvent être pensés uniquement en fonction des humains. Aucune paix n’est viable si elle n’implique pas un respect pour les écosystèmes dans lesquels nous vivons. Pour contrer les forces du chacun-pour-soi, nous aurons donc besoin de toutes les ressources d’imagination, de créativité, d’empathie, de compréhension, d’analyse et d’invention dont nous disposons. Mais ces ressources seront dilapidées si nous ne sommes pas outillés pour penser la fin que nous poursuivons. Cette fin doit être la paix, mais il nous reste encore à l’arracher aux nues et à la faire atterrir dans le monde empirique, même en tant qu’idée.
Pour contrer les forces du chacun-pour-soi, nous aurons besoin de toutes les ressources d’imagination, de créativité, d’empathie, de compréhension, d’analyse et d’invention dont nous disposons. Mais ces ressources seront dilapidées si nous ne sommes pas outillés pour penser la fin que nous poursuivons. Cette fin doit être la paix, mais il nous reste encore à l’arracher aux nues et à la faire atterrir dans le monde empirique, même en tant qu’idée.
- 1G, Campagnolo., 2006. « Petite histoire sociologique du concept de paix » in Cités n° 26, Paris, PUF, pp.145-161.
- 2Kant, Emmanuel (1991 [1795]) Vers la paix perpétuelle. Paris, Flammarion, p.105.
- 3Fortes, M., E. E. Evans-Pritchard, 1987. African Political Systems, London, Routledge, 328p est l’ouvrage fondateur de l’anthropologie politique, publié en 1940.
- 4Simonis, Yvan, 1983, « Présentation », Anthropologie et Sociétés, 7, 1 : 1-2. ; Walter Goldschmidt, Mary Lecron Foster, Robert A. Rubinstein and James Silverberg, 1986. “Anthropology and Conflict”, Anthropology Today, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Feb., 1986, Vol. 2, n° 1 (Feb., 1986): 12-15
- 5Copans, J., 2000, « Anthropologues sans frontières : internationalistes, mondialistes ou internautes? L'inconscient national à l'épreuve des terrains... et des débats! » Anthropologie et Sociétés, vol. 24, n° 1: 53–55.
- 6HELLER, Monica ; GARRIDO SARDÀ, Maria Rosa (2023), «Les langues inventées et le bien commun», in HEBERT, Martin ; SAILLANT, Francine ; BOURDAGES DUCLOT, Sarah (dir.), Savoirs, utopies et production des communs.., Editions des archives contemporaines, France, ISBN : 9782813004505, pp. 139-150, doi : https://doi.org/10.17184/eac.6926
- 7George Balandier (1951) « La situation coloniale : approche théorique » Cahiers internationaux de sociologie, vol. 11, 1951, pp. 44-79.
- 8Les interventions de l’ONU par exemple, au début des années 90, au Rwanda ou ailleurs, ont puisé dans le savoir anthropologique pour faire sens de ce qu’on voyait sur le terrain. Et alternativement aussi, on a vu une importation des savoirs anthropologiques aussi dans tout un domaine naissant dans les années 70 qu’on appelait l’alternative dispute résolution (ADR). Aujourd’hui se pose aussi la problématique des « anthropologues embarqués » ou de l’anthropologie à l’épreuve de la guerre. En Afghanistan comme en Irak, l’armée américaine a « embarqué » des anthropologues afin de mieux comprendre les cultures locales. Le phénomène a déclenché un vif débat mondial sur le rôle de la discipline (Cf. Julien Bonhomme, « Guerres en Irak et en Afghanistan : Anthropologues embarqués », 2007, La vie des idées.fr. ou Anthropologues embarqués - La Vie des idées (laviedesidees.fr). Voir aussi Thierry Boissière, “L’anthropologie face au conflit syrien : replacer la société au cœur de l’analyse”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [Online], 138 | 2015, Online since 16 February 2016, connection on 08 July 2023. URL: http://journals.openedition.org/remmm/9237; DOI: https://doi.org/10.4000/remmm.9237).
- 9Jarrosson C., 1997, « Les modes alternatifs de règlement des conflits. Présentation générale ». in Revue internationale de droit comparé. Vol. 49, n°2 :325-345. La gestion alternative des conflits ne met plus en avant-plan les instruments de l’État comme le droit, la justice ou la répression policière etc., mais plutôt des dynamiques que les anthropologues connaissent bien comme la médiation, la palabre ou la résolution communautaire de conflits.
- 10MEAD, M., 1967, Alternatives to War. In War: The Anthropology of armed conflict and aggression, ed. Morton Fried, Marvin Harris, and Robert Murphy: 212-228.
- 11ORTNER, B., S., 2016, « Dark anthropology and its others Theory since the eighties », Hau: Journal of Ethnographic Theory 6: 47–73.
- 12Cf. Achebe, C., 1972.Le Monde S’effondre, traduit par Michel Ligny, Présence Africaine.
- 13« kula était l’ensemble le lieu d'échanges (en) de colliers contre des bracelets, objets de prestige sans utilité pratique ni valeur marchande, autour desquels toute la société s'organisait.Wikipédia.
- 14Hébert, M. (2006). Présentation : paix, violences et anthropologie. Anthropologie et Sociétés, 30(1), 7–28.
- 15HOWELL S., et R. WILLIS, 1989, “Societies at Peace”. Anthropological Perspectives. Londres, Routledge.
- Entretien réalisé par Borne Djeumegued Pascal
Université Laval
Borne djeumegued Pascal est doctorant en anthropologie à l’Université Laval, sous la direction de Martin Hébert. Il fait partie de l’équipe pédagogique de l’intervention civile de paix de l’Institut catholique de Paris. Praticien à la base, il s’intéresse notamment à l’anthropologie de la paix et des conflits ainsi qu’aux enjeux de résolutions pacifiques et non-violentes des conflits. Par ailleurs, ses travaux traitent également des influences des procès psychoculturels dans l’analyse des conflits ethniques en Afrique subsaharienne.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre