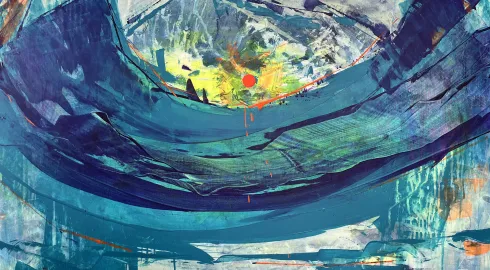[Archive de 1956] Nous republions ici le discours de l'anthropologue Marcel Rioux, alors qu'il recevait la médaille Léo-Pariseau en 1956, lors du banquet du Congrès de l'Acfas, tenu cette année-là à l'Université de Montréal. Le texte a été publié dans les Annales de l'Acfas en 1957 (vol. 23, 1957, pp. 46-49).

Je veux d’abord remercier l’Acfas du très grand honneur qu’elle me fait en me décernant la médaille Léo-Pariseau. Ma première surprise passée, je l’ai acceptée en pensant que c’est l’anthropologie culturelle que votre association veut ainsi reconnaître et associer à ses travaux. Soyez assurés que mes collègues et moi essaierons de nous rendre dignes de cet honneur. Que le R. P. Bernard Mailhiot, o.p., soit aussi très chaleureusement remercié; j’admire la façon dont il s’est acquitté de sa tâche : il n’était pas facile, me semble-t-il, de présenter une médaille à quelqu’un dont la carrière ne fait que commencer et qui sait mieux que quiconque qu’il est encore loin de l’idéal du travailleur intellectuel accompli. J’essaierai donc de mériter de plus en plus les éloges qu’il m’a décernés.
C’est d’anthropologie que je voudrais vous parler ce soir. Le R. P. Mailhiot en a tellement bien discouru qu’il ne me reste qu’à choisir un autre sujet; je vous dirai quelques mots de la liberté envisagée comme condition essentielle pour la pratique des sciences humaines. Je n’oublie pas que nous sommes réunis ici, dans la province de Québec, en 1956, et que la liberté y devient une denrée de plus en plus rare. Si tous les groupes humains aspirent à la liberté, il n’est peut-être pas d'individus qui en aient le plus besoin pour accomplir leur fonction dans la société que ceux qui s’adonnent aux sciences humaines. Le praticien de ces disciplines devrait être, en principe, un homme libre, libre des préjugés et des tabous de la culture dans laquelle il a grandi, libre vis-à-vis les puissances d’argent, libre vis-à-vis tous les crédos métaphysiques, artistiques ou littéraires; mais, en pratique, il lui est impossible de faire table rase de toutes les croyances et l’anthropologiste, qui vit lui-même en société, ne peut pas ne pas avoir de préférence pour tel ou tel système philosophique, pour telle ou telle confession religieuse, pour telle ou telle forme artistique. Il semble qu’il ne gagne rien à vouloir ignorer ses préférences et à travailler comme si elles n’existaient pas. Il lui faut, au contraire, essayer d’expliciter ce que lui-même croit être juste, bon et beau. Si le sociologue en vient à se rendre compte de ses préférences, à expliciter ses positions métaphysiques par exemple, il pourra discerner plus clairement là où ses explications prennent la tangente, là où dans ses observations son système d’idées et de croyances l’ont fait opter pour telle ou telle direction; il s’agit en somme de voir clair dans ce qu’il fait et de savoir pourquoi il fait ce qu’il fait. C’est en adoptant cette solution de lucidité qu’il aura chance d’éliminer plus sûrement tout jugement de valeur de ses observations et de ses analyses.
Si tous les groupes humains aspirent à la liberté, il n’est peut-être pas d'individus qui en aient le plus besoin pour accomplir leur fonction dans la société que ceux qui s’adonnent aux sciences humaines.
À supposer que le problème de la liberté personnelle de l’anthropologiste soit résolu, à supposer qu’il se soit débarrassé de la plupart de ses a priori, qu’il ait pris conscience de ceux qui lui restent, se pose immédiatement la question de l’existence et du degré de liberté de la société dans laquelle il vit. C’est là que le bât blesse le plus souvent. Tant qu’on se borne à étudier la nature, les plantes, les roches, les animaux, à créer de nouvelles formes picturales ou à assembler des sons, la société n’intervient pas trop pour régler les activités de ces savants et de ces artistes; il est rare qu’on invoque un principe moral pour réglementer leurs études et leurs conceptions. Ce n’est que dans les cas de dictature et de terrorisme extrêmes que telle forme musicale est proscrite et que telle théorie botanique est tenue comme rétrograde. Mais sitôt que l’anthropologiste veut étudier le comportement de ses semblables et surtout celui des membres de la société dans laquelle il vit, les mises en garde et les défenses commencent. Ces études intéressent trop directement l’idée que les hommes se font d’eux-mêmes, de leur société, pour qu’on lui laisse la chance de troubler la quiétude que procurent tant de certitudes. Toute société, si peu évoluée soit-elle, possède ses vérités sur la nature de l’homme, sur son origine, sur la façon dont les relations sociales s’ordonnent et doivent s’ordonner. Toute société possède une sociologie implicite qui concourt d’ailleurs à son intégration; les mythes, les préjugés et les tabous peuvent aussi bien, et peut-être mieux que la vérité, servir à cimenter les éléments d'une société, à l’unifier et à la faire vivre comme entité distincte. Toute société croit, d’autre part, que ses membres sont des prototypes de l’homme parfait. Les Esquimaux ne croient-ils pas qu’eux seuls sont des hommes; les autres, leurs voisins, les Indiens et les Blancs, ne sont que des poux. Les Esquimaux ne font que reproduire, un peu plus crûment peut-être, ce que chaque société pense d’elle-même et de celles qui l’entourent. Si l’on jette un rapide coup d’oeil sur l’histoire de l’anthropologie, on se rendra compte que les sciences qui la composent sont nées et ne se sont développées que dans les régimes de liberté; ce n’est pas un hasard qu’elles soient nées en France et en Angleterre, pays qui ont su se libérer avant les autres de tous les jougs qui accablent les hommes dans leur marche vers la vérité et la liberté. Pour que la sociologie puisse se développer dans un pays, il faut que ce pays soit assez fort pour se libérer de la peur, il faut que ses habitants soient assez forts pour regarder la vérité en face. Comment supposer par exemple qu’une dictature laisse imprimer des œuvres qui analysent objectivement le comportement d’hommes vivant heureux en démocratie; il faut que les gouvernés d’une dictature croient que leur forme de gouvernement est la meilleure et que la démocratie est la pire qui soit. Comment concevoir d’autre part qu’une œuvre comme Les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim puisse obtenir l’imprimatur d’une théocratie? Les postulats sur lesquels s’appuie une telle forme de gouvernement contiennent les réponses que Durkheim cherchait en étudiant le comportement des Australiens archaïques. Pour prendre un exemple récent et qui ne prête pas à controverse, le régime hitlérien, on peut dire que si toutes les activités intellectuelles de la nation allemande ont été brimées, il n’en est peut-être pas qui aient été frappées de plus d’ostracisme que l’anthropologie. Les œuvres marquantes des savants allemands, des Weber, des Scheler, des Von Wise, des Graebner, ont toutes été publiées avant l’avènement de Hitler. Sous son régime, il n’était pas permis d’exposer des faits qui eussent pu infirmer la vérité du national-socialisme.
Toute société possède une sociologie implicite qui concourt d’ailleurs à son intégration; les mythes, les préjugés et les tabous peuvent aussi bien, et peut-être mieux que la vérité, servir à cimenter les éléments d'une société, à l’unifier et à la faire vivre comme entité distincte.
Cette liberté dont nous croyons qu’elle est la condition essentielle de l’étude des sciences sociales, existe-t-elle au Canada français? Il faudrait être bien optimiste pour répondre affirmativement. Sans mentionner les obstacles que peuvent opposer au bon usage des sciences sociales des institutions aussi puissantes que l’État et l’Église et qui, dans le Québec, s’appuient l’une sur l’autre et se renforcent mutuellement, il n’est que d’examiner les limites que notre condition de minorité en Amérique nous ont imposées pour nous rendre compte que la liberté s’est amenuisée chez nous. On a trop eu tendance à mobiliser toutes les connaissances et tous les talents pour le service de l’action nationale; on a voulu enrégimenter l’art et la science et les mettre au service du patriotisme : ces activités qui trouvent leur fin en elles-mêmes se sentent à l’étroit dans quelque corset que ce soit, ce corset fût-il la survivance nationale. On voit ce que donnent la peinture et la science soviétiques quand elles sont au service d’une idéologie. La plupart de nos œuvres en sciences sociales sentent l’apologie et la thèse. Nous sommes un peu comme cet étudiant polonais à qui on avait donné comme sujet d’examen de parler de l’éléphant et qui sans sourciller inscrivit comme titre de sa dissertation : l’éléphant et la question polonaise. Comme cet étudiant, nous ramenons à peu près toutes les questions à la mesure de nos particularités de Canadiens français catholiques. Si encore nous nous efforcions par-là d’atteindre à l’universel, mais nous nous délectons dans notre individualité et, pour employer une expression de Gide, nous nous enfonçons toujours dans notre sens. Comme l’a très bien montré mon excellent ami Maurice Tremblay, sociologue de Laval, l’étude des sciences sociales chez nous s’est souvent confondue et se confond encore, en beaucoup de milieux, avec l’action nationale et l’étude de la doctrine sociale de l’Église. Il y a ici erreur sur les termes : ceux qui font de l’action sociale, nationale et religieuse, ne sont rien moins que des sociologues; ce sont des hommes d’action, des propagandistes, des zélateurs, des publicistes, de bonnes âmes, tout ce que l’on voudra, excepté des hommes de science. Une saine division du travail impose la répartition des tâches; nous ne gagnerons rien à vouloir tout mêler. La science s’accommode mal des consignes, des thèses à prouver et des bonnes intentions, si bonnes soient-elles. Tant que nous ne saurons pas regarder les faits bien en face et les analyser rationnellement, les sciences humaines seront inexistantes chez nous. Et ce sera dommage, même du point de vue de l’action nationale, car une action qui ne s’appuie pas sur une solide connaissance de la réalité est condamnée à la stérilité.
On a trop eu tendance à mobiliser toutes les connaissances et tous les talents pour le service de l’action nationale; on a voulu enrégimenter l’art et la science et les mettre au service du patriotisme : ces activités qui trouvent leur fin en elles-mêmes se sentent à l’étroit dans quelque corset que ce soit, ce corset fût-il la survivance nationale.
Heureusement, depuis quelques années, la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval fait dans ce domaine un travail de pionnier qu’on ne saurait trop louer. La fondation récente, à l’Université de Montréal, du Centre de recherches en relations humaines devrait doter la métropole d’un centre unique au Canada et comparable aux meilleures institutions de l’étranger. Que ces institutions aient pu naître dans une société aussi fermée que la nôtre marque une conquête importante; puissent-elles progresser librement!
On voudra bien excuser le pessimisme de quelques-unes de ces remarques; j’aurais cru manquer à mon devoir d’homme et d’anthropologiste en ne mentionnant pas les dangers que court la liberté dans la province de Québec, en l’an de grâce 1956.
Marcel Rioux, Annales de l’Acfas, vol. 23, 1957, p. 46-49
- Marcel Rioux
Université de Montréal
Dans le cadre du centième anniversaire de l'Acfas, l'équipe du Magazine de l'Acfas a souhaité revisiter les archives de notre association afin de faire ressurgir des travaux de recherche d'intérêt et les mots de scientifiques marquant·e·s. Au fil des différents dossiers sont ainsi republiés certains textes disparus, dont la relecture informe et contribue à la compréhension du monde d'aujourd'hui et de demain.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre