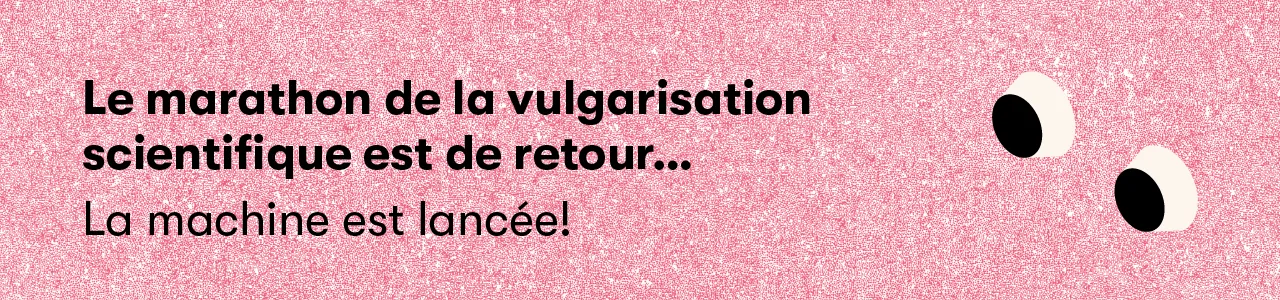

Prêt·e à vulgariser sur scène?
Avec le Vulgarisathon, devenez le ou la champion·ne de la vulgarisation qui sommeille en vous! En quelques semaines, vous participerez à un programme d'entraînement intensif où vos talents naturels ou insoupçonnés seront mis à contribution. La ligne d'arrivée? Un grand cabaret de la vulgarisation scientifique mettant en lumière les numéros scéniques que vous aurez créés, seul·e ou en équipe, pendant ce marathon créatif.
Quel est le format de cette 5e édition?
Les membres de la nouvelle cohorte du Vulgarisathon créeront chacun·e un numéro scénique au format Arts de la scène!
Qui sont les athlètes?
Les étudiant·es des 2e et 3e cycles universitaires et les postdoctorant·es, de tous les domaines. Consultez la page Appel de candidatures pour connaître l'ensemble des conditions de participation.
Quelle est la distance du circuit?
Pour la 5e édition : de janvier à mai 2026, en ligne et en personne. Découvrez la programmation sous l'onglet Format.
Quel est son coût ?
Le montant de l'inscription est de 250$ par personne pour participer à l’ensemble des activités de la programmation*.
*En plus des frais d’inscription de base, certains frais minimaux de transport et/ou d’hébergement s’ajouteront pendant l’année pour la participation aux différentes activités de la programmation.
Comment s'inscrire ?
L'appel à candidatures pour la 5e édition du Vulgarisathon est fermé depuis le 7 décembre 2025. Si votre candidature est sélectionnée, vous recevrez un message à la mi-décembre 2025. Il vous sera alors demandé de verser les frais d'inscription afin de confirmer votre participation.
Questions, commentaires?
- Envoyez un message à Audrey-Maude Falardeau, coordonnatrice de projets.

