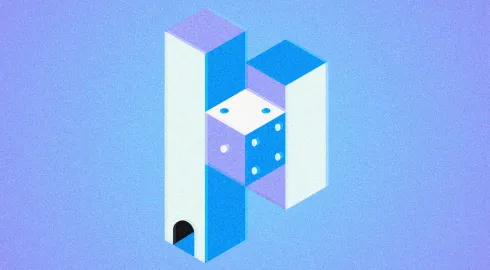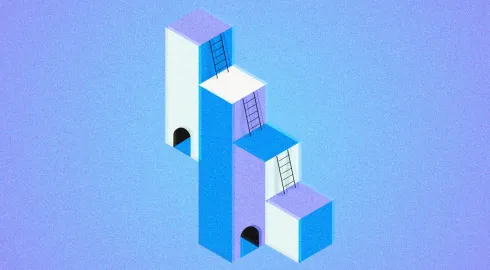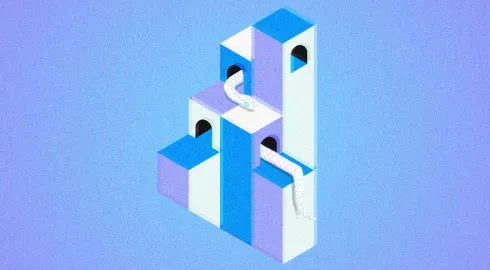...c’est l’articulation entre la maîtrise du savoir et celle du savoir-faire qui est essentielle aux cycles d’études supérieurs. Et le savoir-être aussi, bien sûr.

Johanne Lebel : Comme se passe l’initiation au métier de chercheur dans votre domaine, soit la neurophysiologie?
Richard Courtemanche : Cela commence pour ainsi dire dès le baccalauréat. On essaie d’abord d’encourager la curiosité, on initie les étudiants aux travaux fondamentaux en transmettant, par exemple, des notions générales d’anatomie et de physiologie pour qu’ils comprennent bien le système nerveux et son fonctionnement, le tout alimenté bien sûr de données récentes. Puis, on intègre des apprentissages pratiques, des laboratoires ou des exercices. Là on les atteint... rien de mieux que l’expérience que l’on fait soi-même. On essaie ainsi dès le bac de faire ressortir la dimension recherche.
Il existe des programmes de type « thèse de spécialisation », offerts dans différentes universités montréalaises. Ces Honours Thesis, un modèle plutôt présent dans les universités américaines ou canadiennes-anglaises, permettent à un étudiant du bac de creuser un sujet, de développer une spécialisation, voire de publier. Dans mon propre parcours, au bac, je me suis aussi impliqué dans un projet pour un cours, mais la motivation était très personnelle, moins liée au programme. On voit qu’aujourd’hui ça va plus loin, il y a des gestes beaucoup plus clairs pour initier à la recherche. À Concordia, on a même une mineure appelée Science College, l’école des sciences, qui offre un apprentissage spécialisé à l’intérieur du programme – par exemple, en culture scientifique plus générale et en « habiletés exportables », telles que la communication scientifique (préparation de présentations orales, etc.) ou la vulgarisation.
Johanne Lebel : Comment se distingue alors la maîtrise?
Richard Courtemanche : À la maîtrise, on tente de construire un réel équilibre entre la théorie et les éléments pratiques qui seront propres au projet de recherche. S’il n’y a pas eu d’apprentissage au bac, on part alors d’un peu trop loin, il en résulte de longues maîtrises. Qu’est-ce que les neurones, comment on enregistre leur activité, comment on agit lors d’une expérimentation avec des animaux, tout le côté éthique, etc., idéalement, tout cela doit être introduit au bac. Dans certains domaines, rendu à la maîtrise, c’est même un peu trop tard. À Concordia, il y a une vingtaine d’années, on comptait moins de programmes de maîtrise ou doctorat. Comme directeur des études aux cycles supérieurs et directeur du département, j’y ai vu au fil des ans se développer un arrimage entre le baccalauréat et les cycles supérieurs, particulièrement dans certains domaines, tels ceux reliés à la santé, à l’environnement ou aux biotechnologies, par exemple.
Au doctorat, c’est bien sûr là où les étudiants deviennent plus profondément impliqués dans la théorie, ils formulent une question de recherche avec un développement en plusieurs volets, alors qu’à la maîtrise, on se pose habituellement une seule question. Au doctorat, plus qu’une question, c’est une thématique, un mini-programme au sein duquel la théorie est centrale. Il n’y a pas que de l’apprentissage, il y a une construction d’un pan de recherche.
Si on reprend les trois moments sur une ligne : au bac, on transmet de la théorie avec quelques bases de travail de laboratoire. À la maîtrise, c’est un peu plus équilibré entre la théorie et la pratique. Au doctorat, on forme des philosophes de la science, des Philosophiæ doctors, des Ph.D., capables de naviguer dans la dimension théorique.
Johanne Lebel : Parlez-nous donc un peu de la part collective de l’initiation à recherche?
Richard Courtemanche : À l’intérieur d’un cours de maîtrise ou de doctorat, il y a beaucoup de discussions autour des avancées récentes, de la pertinence d’une méthodologie, de l’interprétation des données, des limites d’un aspect technique. On essaie d’être comme « une main de fer dans un gant de velours », car ces rencontres sont aussi une sorte de familiarisation avec la critique scientifique, critique qu’un chercheur dans son métier est appelé à recevoir comme à donner. Il faut communiquer les standards aux candidates et candidats, tout en enseignant.
Dans mon centre de recherche, il y a des espaces communs où les étudiants se rencontrent sans les professeurs, et là, parfois par une sorte d’osmose, ils s’appuient, ils avancent ensemble. « Comment tu résous ce problème de logiciel, de lignes d’Excel, de statistique? » Des fois, des solutions émergent de ces interactions informelles. Une sorte de mouvement brownien des connaissances. Cela fait beaucoup avancer les étudiants, tant sur le plan personnel que sur le plan du transfert de connaissances.
Comme pour le bac, c’est l’articulation entre la maîtrise du savoir et celle du savoir-faire qui est essentielle aux cycles d’études supérieurs. Et le savoir-être aussi, bien sûr.
Johanne Lebel : Comment abordez-vous avec vos étudiants les évaluations, les contrôles, les épreuves, dans un milieu coopératif certes, mais compétitif aussi?
Richard Courtemanche : Au niveau maîtrise et doctorat, il y a des jalons à placer tout au long de l’année, un calendrier bien établi qui permet de voir venir et de bien préparer les demandes de bourses et de subventions. Si quelqu’un réalise des travaux d’été, on en tient compte, par exemple. Dans mon département, on a établi une pratique où les étudiants reçoivent l’information au fur et à mesure, puis ils en discutent avec leur superviseur. Cela fait partie des préoccupations normales de l’étudiant diplômé, ou de celui qui se prépare à l’être, de regarder pour du financement, et c’est important aussi pour l’établissement de maintenir un certain niveau de participation aux concours.
Pour les évaluations, on essaie d’assurer un suivi régulier, parfois en comité, pour examiner le potentiel de projets, pour préparer à la présentation du mémoire ou de la thèse – ou à la rédaction d’articles scientifiques révisés par les pairs, pour ceux et celles qui poursuivent en recherche. Ce n’est pas obligatoire d’avoir publié pour obtenir un diplôme; mais pour passer au doctorat, cela aide beaucoup d’avoir produit un article à la maîtrise. Pour l’entrée au postdoctorat, là, c’est obligatoire. La qualité des publications varie et l’impact dépend du domaine, mais il reste que l’évaluation par les pairs est une belle carte de visite pour s’introduire dans des labos importants au pays et à l’international.
La qualité des publications varie et l’impact dépend du domaine, mais il reste que l’évaluation par les pairs est une belle carte de visite pour s’introduire dans des labos importants au pays et à l’international.
Johanne Lebel : Pour conclure, voulez-vous me parler de votre expérience personnelle, de votre formation au métier de chercheur?
Richard Courtemanche : J’ai été étudiant au bac entre 1989 et 1991. Quand j’enseigne, je ne peux plus dire « bien, on est à peu près pareils » parce que là j’ai l’âge de leurs parents [rires]. Il reste que la progression dans le parcours d’études est relativement semblable. Au bac, par exemple, aujourd’hui comme dans mon temps, on peut identifier ceux et celles qui sont les plus motivés par la recherche. Pour ma part, à cette étape, il y a eu un déclic avec Normand Teasdale, alors jeune professeur. Une relation basée sur le plaisir de chercheur, d’explorer tant du côté connaissances que du côté expériences en labo. C’est lui qui a été mon superviseur à la maîtrise à l’Université Laval. Et j’étais, je pense, son deuxième étudiant diplômé. On travaillait en kinésiologie, en contrôle moteur, on prenait des mesures du mouvement et des activités musculaires lorsqu’une personne est en action. Il y avait aussi une dimension clinique avec une série d’études menées avec des patients. Par ces recherches, on entrait dans les neurosciences, et c’est ce qui m’a donné l’idée de faire un doctorat dans ce domaine. Je me suis initié à ce champ d’études avec mon superviseur Yves Lamarre, professeur de l’Université de Montréal, qui lui était en fin de carrière, j’ai été de fait son dernier étudiant. C’était un type de supervision différent, mais on a aussi eu le déclic ensemble.
Johanne Lebel : J’imagine qu’ils doivent tous les deux être intéressants, avec chacun leurs forces?
Richard Courtemanche : Deux expériences différentes avec deux très bons chercheurs. La supervision du premier était de nature quotidienne, de proximité, du type « Comment ça va aujourd’hui ? ». J’étais bien appuyé pour la mise en place de bons protocoles, par exemple. C’était parfait pour un jeune étudiant débutant en recherche. Avec un superviseur plus expérimenté, il est certain que le style d’apprentissage est différent. Mais j’ai apprécié d’être initié aux neurosciences, à la neurophysiologie en fait, dans un cadre très structuré, mais aussi créatif, un plus gros centre, brassant une profusion de grandes questions fondamentales.
Par la suite, je suis allé faire des études postdoctorales à Boston, au Massachusetts Institute of Technology, qui est un environnement hypercompétitif. J’ai aussi eu le déclic avec ma chercheuse principale, Ann Graybiel. Mais là, on n’a plus le statut d’étudiant, et il faut être productif de manière autonome à l’intérieur d’un laboratoire. Pour ma part, je me suis senti capable de répondre aux exigences du poste, malgré la compétition, et j’ai trouvé le milieu très intéressant, avec son côté un peu « rebelle »...
Johanne Lebel : C’est là où on vérifie la solidité de tout le cheminement précédent?
Richard Courtemanche : Il faut que la sauce prenne. On n’a plus le contexte habituel de formation, on n’a pas de notes de cours, pas encore de cours à donner. Au MIT, le degré d’autonomie attendu de chacun des postdoctorants est élevé. En contrepartie, il y avait des ressources, mais la chercheuse principale nous poussait – dans le bon sens – à trouver la solution, et il y avait beaucoup de travail en équipe dans son groupe pour faire de la résolution de problèmes.
Un exemple de travail qui m’a beaucoup demandé, c’est la programmation. J’avais fait pas mal de traitement de données avant, mais de là à créer un programme à partir de zéro, à innover en méthodes d’analyse... parfois, on devait développer nos propres outils. Ceux qui ne sont pas prêts à faire ce petit supplément d’efforts sont souvent ceux qui ne réussiront pas à aller plus loin. C’est correct d’être exposé à ces situations parce que s’il faut lancer son laboratoire par la suite, il faut avoir une bonne dose d’autonomie.
D’une certaine manière, je pense que le travail postdoctoral, c’est vraiment d’essayer de trouver une manière de voler de ses propres ailes. C’est le terrain de pratique finalement où se conclut l’initiation à la recherche. Mais en recherche, on apprend toujours… ça nous garde motivé!
D’une certaine manière, je pense que le travail postdoctoral, c’est vraiment d’essayer de trouver une manière de voler de ses propres ailes. C’est le terrain de pratique finalement où se conclut l’initiation à la recherche. Mais en recherche, on apprend toujours… ça nous garde motivé!
- Richard Courtemanche
Université Concordia
Richard Courtemanche est un neurophysiologiste ayant une formation en kinésiologie (BSc et MSc) et neurosciences (PhD). La performance motrice humaine a été à la genèse de son intérêt pour la recherche, ouvrant sur des questions quant aux mécanismes du cerveau. Il a obtenu son doctorat en 2000, et a complété des études postdoctorales au Massachusetts Institute of Technology. Depuis 2002, il est professeur à l’Université Concordia, intégré dans le Département de santé, kinésiologie et physiologie appliquée, et depuis 2004 membre du Groupe de recherche en neurobiologie comportementale ,et du Centre PERFORM. Il publie dans des revues fondamentales, particulièrement sur le fonctionnement du cervelet et de ses plusieurs régions interconnectées. Son intérêt pour le rôle du cerveau dans les actions ne s’est pas affaibli depuis ses premières interrogations, jadis sur le tennis...
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre