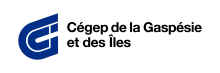Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 200 - Sciences naturelles, mathématiques et génie
Description :Le stockage et la séquestration de carbone en milieu marin offrent une option naturelle pour la mitigation des changements climatiques. Les écosystèmes marins considérés comme des puits de carbone sont appelés écosystèmes à carbone bleu.
C’est seulement depuis 2011 que le rôle des macroalgues dans le stockage et la séquestration du carbone est considéré sérieusement par la communauté scientifique. Depuis 2019, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a recommandé que la culture des macroalgues soit un domaine de recherche pour l’atténuation du changement climatique.
Pour le carbone issu des algues, les voies de séquestration naturelle sont l’incorporation dans les sédiments côtiers et dans les fosses océaniques. L’industrie de la transformation peut aussi contribuer à la lutte contre le changement climatique en remplaçant des produits à base de pétrole par des équivalents à base d’algues ou en modifiant l’alimentation animale pour réduire leurs émissions de méthane.
Le littoral maritime de l’est du Canada est caractérisé par une grande diversité d’espèces d’algues, et plusieurs entreprises sont engagées dans la cueillette, la culture et la transformation des algues marines. Dans ce contexte, il semble pertinent d’évaluer quel est le potentiel des champs d’algues et des fermes d’algues à agir comme puits de carbone bleu dans des zones climatiques tempérées froides et subarctiques.
Plusieurs initiatives de recherche ont été lancées en 2022 à la fois pour évaluer les ressources algales du golfe du Saint-Laurent et pour quantifier le devenir du carbone des algues cultivées sur les fermes marines au Canada. En rassemblant des experts de différents horizons, des représentants des agences gouvernementales concernées et des acteurs de l’industrie, nous souhaitons sensibiliser les acteurs locaux à l’importance de considérer les algues dans les stratégies de lutte aux changements climatiques, raffiner les approches utilisées en recherche dans ce domaine et établir des recommandations pour le développement de la filière industrielle des algues.
Ce colloque est divisé en trois sessions. Dans la première, les concepts fondamentaux et projets de recherche en cours sur le carbone bleu et les macroalgues seront présentés par des experts. La seconde session comprendra deux tables rondes : un sur les perspectives de développement en lien avec le carbone bleu et l’autre sur l’intégration du carbone bleu pour l’atteinte des objectifs de conservation marine 30x30. Des intervenant·es issus des milieux de pratique et décisionnels seront réunis au sein d’un panel et des questions seront soumises pour lancer les discussions. Finalement, une discussion ouverte avec la salle permettra de déterminer des axes d’intérêt pour la recherche appliquée, les actions à mettre en œuvre et des recommandations pour le développement du secteur. Le colloque se terminera par une période consacrée au maillage entre participants.
Remerciements :Le soutien de l'UQAR-ISMER, de l'AGHAMW, du Cégep de la Gaspésie et des Îles et de Ressources Aquatiques Québec a été crucial pour la mise sur pied de cet événement. Le colloque a bénéficié de l'aide financière de: Environnement et Changement Climatiques Canada, Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Cégep de la Gaspésie et des Îles et Ressources Aquatiques Québec.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Fanny Noisette (UQAR - Université du Québec à Rimouski)
- Éric Tamigneaux (Cégep de la Gaspésie et des Iles)
- Sandra Autef (Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Wolastoqey- AGHAMW)
Programme
Le carbone bleu et les algues
Dans la première session, les concepts fondamentaux et projets de recherche en cours sur le carbone bleu et les macroalgues seront présentés par des experts du Canada et de l'Europe.
-
Communication orale
Le devenir du carbone dans les macroalguesFanny Noisette (UQAR - Université du Québec à Rimouski)
Dans les zones côtières des régions tempérées à polaires, les macroalgues brunes dominées par les laminaires forment des communautés hautement productives. Ces macroalgues génèrent des détritus par le biais de l'érosion progressive de leurs frondes, de leur fragmentation et du délogement de thalles entiers. La matière organique ainsi produite est exportée vers les écosystèmes adjacents, parfois s'échouant sur les plages, parfois disparaissant dans les profondeurs. Ces transports de matière organique entre écosystèmes jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des communautés et la dynamique des réseaux alimentaires marins.
-
Communication orale
La Longue Odyssée de la matière organique et du carbone issus des forêts de laminaires : quantités exportées, transit, colonisation, consommation et stockageFlorian De Bettignies (Station Biologique de Roscoff)
Les forêts de laminaires à Laminaria hyperborea font partie des écosystèmes les plus productifs au monde. Une large part de leur production n’est pas directement consommée sur place, mais est exportée sous forme de macro-détritus. Ces tonnes de fragments transitent et, quand les conditions le permettent, peuvent s’accumuler sur différents écosystèmes benthiques côtiers adjacents. La dynamique de la matière organique issue de ces forêts est complexe. Plusieurs expérimentations ont été menées in situ, et montrent que les fragments de laminaires possèdent une dégradation particulièrement lente comparée aux autres macroalgues brunes et du même ordre de grandeur que les feuilles de posidonies de Méditerranée. Au cours de la dégradation, les fragments ont la capacité de maintenir pendant plusieurs mois leur photosynthèse et potentiellement leur capacité de reproduction si conditions environnementales le permettent. Une communauté abondante de macrofaune (170 espèces identifiées) colonise les tissus et une succession écologique s’opère. Les forêts jouent ainsi un rôle écologique important pour un grand nombre d’écosystèmes côtiers où les fragments sont exportés et leur aire d’influence est très probablement sous-estimée. Lorsque le carbone issu de ces forêts est exporté plus loin vers les environnements profonds du large, la dynamique de dégradation est peu connue et une partie du carbone est reminéralisée ou stockée et séquestrée à long terme dans les sédiments.
-
Communication orale
Quel devenir pour les écosystèmes des forêts de laminaires en mer d’Iroise à la Pointe de la Bretagne occidentale ?Eric Deslandes (Université de Bretagne Occidentale)
À la pointe de l’Europe Occidentale en face des Côtes de Bretagne en France, il existe en Mer d’Iroise l’un des plus grand champ de macroalgues au monde caractérisé par une biomasse importante et une très grande biodiversité d’espèces d’algues (environ 600 espèces). Parmi les grandes algues brunes, les espèces de l’ordre des laminariales forment des forêts sous-marines qui dominent les milieux côtiers rocheux des zones froides à tempérées à travers le monde et jouent un rôle clé dans les processus écologiques en tant que producteur primaire et habitat pour de nombreuses espèces, y compris celles exploitées commercialement. Les grandes algues brunes sont également utilisées par les directives européennes comme bio-indicateur pour l’évaluation de l’état écologique des écosystèmes marins et sont d’une grande importance économique pour la filière d’exploitation des algues en France (dont le début en Bretagne date des années 1960). L’ensemble des pressions anthropiques directes (e.g. l’exploitation industrielle des algues laminaires) et indirectes (e.g. le changement climatique) que subissent les forêts de laminaires les rend vulnérables et constituent une menace pour l’ensemble du milieu marin en mer d’Iroise.
-
Communication orale
Le bilan du carbone bleu: La quantification de la contribution des laminaires dans un contexte de changements climatiquesManon Picard
La contribution des laminaires dans le bilan global du carbone bleu a récemment suscité de l’intérêt. On suppose que les populations de laminaires contribuent de manière significative à la séquestration du carbone dans les océans grâce à leur biomasse élevée, leur productivité et leur capacité à exporter du carbone où il peut être ensuite séquestré. Cependant, les estimations existantes du stockage du carbone par les laminaires ont été générées à partir d’études disparates et contiennent un niveau d’incertitude important. L’objectif de notre projet est de générer un bilan du carbone bleu pour les écosystèmes de laminaires en Nouvelle-Écosse en appliquant plusieurs méthodes pour quantifier les stocks et les flux de carbone à l’échelle locale, incluant la synthèse de la littérature, la modélisation des données (modèles de répartition des espèces et modèles de suivi des particules) ainsi que les mesures directes dans le laboratoire et sur le terrain (productivité primaire et taux de sécrétions de carbone dissout). Ces travaux fourniront une évaluation complète des laminaires en Nouvelle-Écosse, ainsi contribuant à enrichir les connaissances quantitatives de la séquestration du carbone par les laminaires à l’échelle mondiale et généreront des outils et des méthodes qui pourront être appliqués à d’autres aires et régions de conservation du Canada, ce qui a pour but d’appuyer l’élaboration d’un budget national de carbone bleu.
Dîner réseautage
Nous vous invitons à partager un lunch en compagnie des participants de ce colloque afin de pourvoir bénéficier de ce moment pour discuter de potentielles collaborations et / ou futurs projets autour du carbone bleu. Merci de communiquer avec les organisateurs pour réserver votre place.
Survol des projets en lien avec le carbone bleu et les macroalgues
Plusieurs étudiants sont invités à partager leur travaux à travers la présentation d'affiches scientifiques qui seront exposées à partir du diner et jusqu'à la fin de la journée
Table ronde : Carbone bleu et objectifs de conservation
Au cours de ce panel, chaque participant sera invité à effectuer une présentation d'une dizaine de minutes afin de partager les informations avec l'auditoire concernant les implications de leur organisation respective dans les objectifs de conservation marine et l'intégration de la séquestration du carbone dans les choix de site. Le panel sera ensuite animé par Mme Lambert Koizumi qui posera différentes questions aux panélistes afin d'essayer de faire avancer la réflexion à ce sujet.
Table ronde : Carbone bleu et opportunité de développement
Dans le cadre de ce deuxième panel, les participants présenteront chacun rapidement leur implication ou travaux en lien avec le développement autour du carbone bleu. Ensuite, des questions permettront aux panélistes d'échanger sur différentes pistes de développement. L'auditoire sera aussi invité à participer en fin de panel.