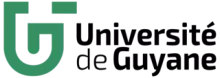Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :DESCRIPTION
Problématique
Le paradoxe consiste en ce que la langue est à la fois créatrice de culture et produit de la culture. Aussi est-elle un instrument de résistance à l’hégémonie linguistique et, par conséquent, à l’hégémonie culturelle. Voilà la principale question que soulève notre colloque, les interrogations suivantes résultant des différentes situations de diglossie existantes (Ninyoles, 1969 ; Aracil, 1980) et des propositions produites par les populations linguistiquement et culturellement subalternisées.
On peut donc, avec Deleuze (1976), postuler que, par l’art, on surcode la langue, lui permettant de dépasser ses signes figés. Autrement dit, le langage fuit la langue. Notre colloque pose également la question de la déterritorialisation/reterritorialisation (Deleuze, Avenir de linguistique, 1976), comme un autre pouvoir, hétérogène à une langue principale, constituant alors une autre géolinguistique, non traitée par le pouvoir majoritaire/dominant ; il y a alors microluttes, réaction des subalternes.
Sont concernés par ce questionnement tant les arts et les artistes invisibilisés sur leur propre territoire, comme c’est souvent le cas des artistes autochtones, déprécié·e·s et rabaissé·e·s au rang d’artisan·e·s, que les artistes qui ont dû s’exiler pour s’exprimer.
Nous discutons donc également cette hypothèse dans le contexte québécois, auprès d’artistes réfléchissant à leur propre pratique (chorégraphes, dramaturges, plasticiennes et plasticiens, poètes, etc.). Ces démarches, tant celles des acteurs sociaux résidant sur leur territoire d’origine que celles des artistes exilés, peuvent mener à une désaliénation des savoirs qui dépassent la barrière de la langue.
Notre colloque pose la question exposée précédemment à partir du rapport entre langue et langage, pour une hybridation des savoirs entre discours linguistiques, artistiques et phénoménologie.
Axes de réflexion
1) Rapport entre langue hégémonique et langues/langages autres, dans une perspective sociophilosophique
2) La pratique artistique comme alternative à une langue hégémonique et aliénante
3) Processus contradictoires et compatibilité des savoirs
4) Perspectives de re-signification des savoirs lors de parcours croisés (croisements disciplinaires)
5) Catégorisations des arts et artisanats et leurs conséquences économiques (marchandisation versus valeurs)
Possibilités de publication des textes
Les conférenciers pourront soumettre un texte issu de leur présentation, au cours de l’été 2024, en vue d’une publication sous forme d’ouvrage collectif ou de numéro spécial de revue. Des informations supplémentaires seront fournies dans les prochains mois. Les articles soumis seront évalués par un comité de lecture.
Remerciements :Université de Guyane (UG)
Grand conseil coutumier de Guyane
Collectivité territoriale de Guyane (CTG)
École d'art de Guyane
Compagnie Libi na weli
Centre interdisciplinaire de recherches sur les cultures autochtones, créoles et l'interculturalité aux Amériques (CIRCACIA), Cayenne, Guyane
Dates :Format : Uniquement en ligne
Responsables :- Benoît Baltus (Université de Guyane)
- Montserrat Fitó (EHESS, Paris - CIRCACIA, Cayenne)
- Amandine Galima (Jeunesse autochtone de Guyane)
Programme
Session d'ouverture : sous le signe de l’affirmation autochtone
-
Communication orale
Mot de bienvenueBenoît Baltus (Université de Guyane)
-
Communication orale
Conférence plénière : Désaliénation et décolonialité, les enjeux d'une controverseMontserrat Fitó, Éric Louis (Village de Kuwano, commune de Kourou)
Notre colloque s'inscrit dans le cadre du 91ème congrès international francophone de l'Acfas, organisé cette année par l'Université d'Ottawa. Les principaux points communs entre la Guyane et le Canada que nous avons choisi de problématiser par le biais du rapport entre les arts et les sciences sociales sont les questions autochtones et celles soulevées par les immigrations. L'intégration dans notre contexte global d'une telle diversité humaine et culturelle requiert une perspective inclusive. D'où la pertinence de convoquer pendant ces deux journées la démarche dénommée "Équité, diversité, inclusion (ÉDI)".
L'organisation du présent colloque reconnaît et respecte le lien profond, de longue date, unissant les peuples autochtones de Guyane à leur territoire traditionnel, qui demeure non cédé (2017). Nous rendons hommage à toutes les personnes des nations kali'na, teko, paykweneh, wayana, wayãpi et lokono qui habitent la Guyane ; qu'elles soient nées sur le territoire ou dans les pays voisins. Nous reconnaissons les gardiennes et les gardiens des savoirs de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, au courage indéniable.
Nous aborderons les interventions et les débats sous l'angle du concept de décolonialité et de la controverse qu'elle suscite. Les différents points de vues existants et les interrogations que ceux-ci engendrent nous apporteront un éclairage fécond sur les thématiques abordées tout au long du colloque.
-
Communication orale
"La légende de Kalali", un regard artistique sur l'histoire kali'naEléonore Johannes (Université de Guyane)
Un conte amérindien kali'na qui se raconte de génération en génération dans la famille de l'auteure. Ce conte à lui seul relate un pan de l'histoire kali'na. Éléonore Kadi Johannes raconte, tout en faisant des allers et retours dans le passé. L'auteure donne des éléments pour décoder le sens caché de son récit, mais également l'histoire de la nation kali'na de Guyane, dont elle fait partie.
Interférences entre société globale guyanaise et cultures autochtones
Dîner libre
"Adieu sauvage", film documentaire (projection)
Toutes et tous les participant.e.s : en présentiel, à l'université de Guyane, accès libre et gratuit pour tous les publics adultes.
-
Communication orale
"Adieu sauvage", film documentaireSergio Guataquira
Le réalisateur retourne en Colombie pour tourner un film sur une vague de suicides dans les communautés autochtones. C'est l'occasion pour lui de renouer avec ses racines oubliées.
L’appropriation culturelle et ses limites
Quelles sont les limites de l'appropriation culturelle alors que domine la confusion entre le biologique et le culturel, d'une part et l'appartenance ou non au territoire (en l'occurrence la Guyane), d'autre part ? Nous débattrons sur ces questions prégnantes et particulièrement actuelles à partir d'expériences observées ou vécues en Guyane. Il s'agit, dans cette table ronde, d'aborder la question, notamment en ce qui concerne la production artistique des populations autochtones de Guyane, largement plagiée ou, parfois même, spoliée. Avec la participation (sous réserve) de membres invités du Centre de ressources autochtones (CRA) de l'Université d'Ottawa, hôtesse du 91ème congrès de l'Acfas.
Immigration et arts : pour une hybridation des savoirs
-
Communication orale
Parcours d’immigrés en Guyane : une démarche sensible pour (re)lire un phénomène globalFrédéric Piantoni (Université de Reims Champagne-Ardenne), Ewa Kraska (Compagnie Itek)
Les discours dominants sur les migrations internationales s’inscrivent dans les registres économiques, le contrôle des flux et les politiques d’intégration fondées sur la maîtrise de la langue et de la culture du pays d’accueil. Ces représentations sont alimentées par des variables et des méthodes quantitatives qui gomment la dimension individuelle de l’expérience migratoire. En effet, il est rare que l’immigré soit considéré comme une personne autonome portant un projet corrélé à un parcours migratoire, dans lequel opportunisme et innovation constituent des facteurs essentiels. La complexité qui caractérise les choix des individus ne peut être saisie par des méthodologies classiques en sciences sociales.
L’art comme méthode ouvre à une hybridation des langages et des pratiques. Il permet d’aborder la diversité des parcours et des perspectives d’une part, et leur insertion dans un imaginaire riche de projections d’autre part. Cette démarche sensible, co-construite entre chercheur-artiste-migrant, incite à comprendre les stratégies d’une aventure humaine à part entière qui questionne l’altérité, s’affranchissant de la migration comme un sujet polémique et discriminatoire.
La recherche-création, mobilisant théâtre et photographies, menée avec 25 participants immigrés en Guyane par la compagnie itek, témoigne de cet engagement collectif valorisant une diversité de modèles réussis d’intégration et contredisant les schémas hégémoniques nationaux économiques, sociaux et culturels.
-
Communication orale
Conflits entre l’artiste et sa responsabilité socialeJacqueline Sierra
Le questionnement autour de la responsabilité sociale de l’artiste traite une problématique spécifique : comment apporter, à travers l’art, sinon une solution, du moins une ouverture à des populations culturellement et socialement fragilisées ? L’artiste propose une activité artistique à un public en situation de détresse. La position que doit prendre l’artiste s’avère complexe, car il ne s’agit pas seulement de transmettre un savoir-faire ; il s'agit de connaître le contexte social et de le comprendre. Un changement, une réponse sont attendus dans des délais courts, avec des budgets souvent serrés. Des interrogations émergent : comment traiter une problématique sociale sans avoir une formation spécifique et tous les outils dans ce domaine ? Quelle action proposer allant dans le sens de sa propre réflexion artistique, qui soit à la fois pertinente et ludique sans pour autant bifurquer dans le domaine de l’animation ?
Pour envisager une réponse face à cette demande, l’artiste doit mettre à disposition les "outils" qu'elle possède, dont ceux inhérents à sa pratique artistique. Il lui est donc indispensable de s’interroger sur ses processus de création, sur ses sujets de recherche, sur ses partis pris et tout ce qui concerne la réflexion autour de son activité créatrice. Car ce sera à partir des créations de l’artiste et de son processus que découleront les propositions, actions et interventions adressées à ces populations. D'où la recherche-création, approche ici développée.
-
Communication orale
Rester soi-même en dansantKiasa Nazeran (Collectif Vâtchik Danse), Nasim Lootij (Collectif Vâtchik Danse)
Depuis 1979, une dictature religieuse, celle des ayatollahs, règne sur l’Iran. C’est le paradis des Tartuffe. Être soi-même s’avère difficile, surtout quand on est artiste. D’où le nombre élevé d’artistes ayant quitté le pays par vagues successives. Emportés par l'une de ces vagues, nous sommes arrivés en 2016 à Montréal. Dès lors, notre quête d’intégrité n’a cessé de s’intensifier, ce qui nous a amenés à créer deux solos chorégraphiques : Moi-Me-Man (2017) et La Chute (2019).
L’Inconsistance est notre nouvelle création. Celle-ci est une réponse chorégraphique à la problématique suivante : d’où vient notre tendance à nous soumettre aux discours aliénants ? Cette question traverse l’esprit de tout.e Iranien.ne étonné.e de voir ses compatriotes soumis à l'idéologie obligatoire imposée par le régime des ayatollahs depuis son avènement, en 1979. Les Européens se la posent également, surtout celles/ceux qui ne peuvent rester indifférents à l’effondrement de la culture humaniste en Europe.
Notre installation dans le milieu artistique canadien ne fut pas facile. Dans certains contextes locaux, en effet, le conformisme ambiant empêche les artistes d’exprimer leurs questionnements politiques. Les artistes migrants sont souvent invités à créer des œuvres exotiques, cantonnés dans des rôles répondant à des idées reçues, à des préjugés.
Nous, Nasim Lootij et Kiasa Nazeran, fondateurs du Collectif Vâtchik Danse, essayons de ne pas tomber dans ce piège. Nous parlerons ici de notre approche.
-
Communication orale
L’action sociale glocale par le biais d’un parcours de formation plurilingue et plurilangagierPaulo Roberto Massaro (USP - Université de São Paulo)
À partir de la conception d'éducation linguistique selon la perspective de la Linguistique Appliquée Critique (Pennycook, 2001), cette communication discutera les résultats d’un projet de recherche-action visant le décloisonnement disciplinaire dans la formation d’enseignants de langues en poste au Brésil. Dans le but de (trans)former (Silva, 2022) la praxis d’enseignants de portugais du Brésil, aussi bien que de trois langues de prestige international (l’anglais, l’espagnol et le français), nous avons constitué une communauté de pratique (Wenger, 2005) où le dialogue, la réflexion et surtout l'expérimentation artistique plurilingue et trans-langagière ont été mobilisé.e.s pour bâtir, par la suite, des projets d'éducation linguistique émancipatrice (Freire, 2006) pour leurs élèves de l'école publique. Grâce à cette approche critique centrée sur l'interrelation entre les langues de la communauté et des œuvres scéniques, musicales et plastiques, les productions des enseignant.e.s indiquent que l’accès transversal à ces répertoires langagiers multiples permet l’irruption d’une nouvelle performance discursive plurilingue et artistique dans laquelle interviennent des aspects identitaires (tels que la race, le genre et l'origine sociale) ainsi que des spécificités locales, rendant compte de la diversité culturelle brésilienne. La plupart de ces expérimentations sont vouées à l’action sociale glocale, accomplie soit sur un terrain concret, soit dans des espaces virtuels.
-
Communication orale
Approches artistiques dans la valorisation sociale des savoirs traditionnels exogènesLisa Ndejuru Phd (Université Concordia)
En tant qu’artistes transnationales, liées à notre terre d’accueil, nous choisissons de centrer les histoires et savoirs traditionnels dont nous sommes à la fois pétries et coupées, avec la liberté de les interpréter pour le présent et pour l’avenir pour lesquels nous nous engageons.
Lisa Ndejuru est une conteuse, ainsi qu'une chercheuse universitaire, qui s'interroge sur la façon dont l'engagement créatif avec la tradition orale au Rwanda peut inspirer aujourd'hui. Son travail traverse les générations pour mélanger histoires anciennes, culture contemporaine et visions d’un monde futur.
Farah Fancy utilise ses connaissances ancestrales pathan (Pakistan) pour changer les comportements et tenter d'éliminer les préjugés, ceci dans le but d'accroître l'inclusion sociale.
Dîner libre
Pratiques artistiques en Guyane : pour une approche visible et sensible du territoire
-
Communication orale
Phénoménologie du regard entre les arts plastiques et le visible en GuyaneThierry Tian-Sio-Po (Collège Auxence Contout)
Il existe un type de regard qui ne veut voir l’espace vert guyanais qu’immaculé. Une forêt vierge qui, certes, obsède, mais qui exclut radicalement l’humain. Jusqu’à maintenant, quand des Autochtones, des Bushinengé ou des Créoles parcourent les forêts et les fleuves, il n’en reviennent pas en s’extasiant sur la beauté du lieu. Ils-elles sont plutôt en communication avec lui dans un rapport sensible : ils occupent un espace-temps fonctionnel.
En suivant Merleau-Ponty, dans L'œil et l'esprit, on peut dire que : « Tous mes déplacements, par principe, figurent dans un coin de mon paysage, [ils] sont reportés sur la carte du visible ». Or, un paysage n'est pas caractéristique par ce qui est repérable et typique. Si nous nous rapportons au végétal en Guyane, ce qui fait sens, ce sont les télescopages entre les zones végétales et la représentation de murs décrépis. Cette tension entre ensembles délabrés et espaces verdoyants est souvent idéalisée et rendue exotique par le regard colonial.
Les forêts n’ont jamais été vierges. Elles ont toujours été sillonnées par le pas des humains. Elles contiennent des traces, en gardent la mémoire. Les forêts guyanaises ont toutes été sillonnées par les Autochtones, au départ.
Le propre de l’exotisme n’est pas tant de s’extasier face aux versants souillés, de recouvrir de couches verdoyantes et luxuriantes la misère et le mal-être du monde, les évitant. L’option est ici de le rejeter, y compris l’exotisme sur soi-même comme nouvelle invention.
-
Communication orale
Anthropoétique de la recherche : les films anthropologiques, un genre cinématographique à part entièreMontserrat Fitó (EHESS, Paris - CIRCACIA, Cayenne)
Les films anthropologiques permettent, sous certaines conditions, de réinjecter une once de magie et de subtilité dans un monde souvent extrêmement routinier.
Nous développerons cette approche en comparant plusieurs méthodes de recherches filmiques : le film ethnographique, l'anthropologie visuelle de méthode française et les films anthropologiques. On verra ainsi que les grands questionnements admettent rarement des réponses conventionnelles et/ou simplistes. Aussi la poésie qui se dégage des images animées, dans la perspective concevant un film anthropologique comme une expression artistique, permet-elle de creuser le gouffre qui sépare le simplisme de la simplicité.
-
Communication orale
Dialogue entre le "street-art" (art urbain) et les arts graphiques autochtonesAmandine Galima (Jeunesse autochtone de Guyane), Emi Guttiérez (École d'art de Guyane (EAG))
Le street art (art urbain) est connu comme un langage visuel d'une modernité extrême. Paradoxalement, en Guyane, il pourrait permettre de revaloriser les arts graphiques autochtones auprès de tous les publics, y compris des résidents des quartiers urbains populaires. C'est le cas de la production d'Amandine Mawalum Galima au sein du projet Muzé laru.
La ligne, la figure, la forme, la couleur, ne relèvent pas d’un système du code du langage, mais au travers de ces éléments artistiques nous pouvons communiquer, transmettre, transformer, impacter, faire réfléchir autour d’un sujet. En tant qu’artistes, nous développons des chemins de communication et de convergence culturelle. L’art devient dans sa pratique une manifestation créative, libre et émotionnelle ; l’expression artistique nous permettant ainsi de déposer notre empreinte dans le contexte social qui nous entoure et de développer une symbolique.
La rencontre avec Amandine Galima, artiste plasticienne autodidacte kali’na, comme la réalisation des projets artistiques partagés dans le milieu urbain, nous permet d’explorer les manières de transposer nos langages artistiques propres. Chacune étant porteuse d’une empreinte et d’une identité culturelle, nous jouons artistiquement avec ces signes et ces symboles singuliers. Nous partageons et nous questionnons la construction d’un espace d’expression artistique commun, sans pour autant oublier de comprendre le contexte urbain multiculturel de la Guyane et de dialoguer avec lui.
-
Communication orale
L’expression artistique et les masques : le problème de la signification à travers les formes et processus d’aliénation, de résistance et de libérationBenoît Baltus (Université de Guyane)
Lors du colloque de Royaumont, Foucault observait le changement profond des techniques d’interprétation révélées par Nietzsche, Freud et Marx. Tout signe se donnerait deux fois, une fois comme simple apparence et une seconde fois comme signe déjà interprété. Le premier nous trahit car, sous les traits de l’apparence, nous croyons que sa seule présence est significative. Le second, en revanche, est un gouffre. Déjà codé, il est irréductible à un signifié stable. De plus, il renvoie l’interprète à s’interpréter lui-même. On découvre un univers de significations, approfondissant sans fin le mouvement interprétatif.
Notre tentative est d'interroger un mode post-colonial qui s’est donné pour tâche de se découvrir par lui-même et non plus par l’extérieur. Pour lui-même et le monde en soi dans lequel il repose. Un horizon de significations vertigineux qui redouble la difficulté en découvrant que, pour son propre monde, il n’y a aucun signifiant adapté. Les formes usuelles par lesquelles il passe sont systématiquement surcodées, les formes qu’il préserve, comme patrimoine et tradition, également.
Ainsi, pour exprimer ce qui se joue depuis cette émancipation, il faut accepter que les re-significations à l'œuvre enfoncent les interprètes dans leur propre mouvement de production culturelle et de savoirs. C’est aussi le moment d’observer les artistes dans leur démarche de production de signes. Qu'y a-t-il de mieux que l’art pour se déjouer des masques et des codages de notre modernité ?