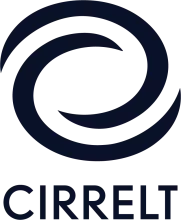Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :Le genre est bien reconnu comme un marqueur de diversité qui détermine l’accès des personnes aux ressources urbaines. Que ce soit dans le vaste domaine de la mobilité ou à l’égard de dimensions plus spécifiques comme l’accès au logement, aux équipements collectifs ou tout simplement aux espaces publics, il est indispensable de comprendre la manière dont le genre affecte la situation des personnes afin de développer des projets, des programmes et des politiques plus justes et efficaces.
Que nous apprennent la recherche récente et les actions posées au sein des milieux de pratique sur la place du genre dans le développement de collectivités plus inclusives et durables ?
Le colloque « Ville et genre : défis d’inclusion et perspectives de recherche » se veut une occasion de susciter le dialogue à la fois interdisciplinaire et intersectoriel dans le but de mieux comprendre l’état des actions et des études en cours ou récentes qui s’inscrivent à l’intersection des préoccupations d’inclusion et de transition vers des collectivités plus durables. Ce colloque constitue une occasion pour mettre en commun des travaux de recherche menés dans diverses disciplines au sujet des pratiques spatiales des femmes et, plus largement, du rôle du genre dans les processus d’exclusion et d’inclusion.
Cet événement réunira des personnes issues des milieux universitaires et de la pratique pour partager des idées sur leurs travaux les plus récents et sur les occasions que ces travaux permettent de déceler en recherche et en intervention, notamment dans la sphère municipale. Le colloque sera organisé autour de 12 communications, regroupées en trois sessions thématiques (mobilité, logement et espaces publics, justice urbaine) ainsi qu’un panel de discussion.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Geneviève Boisjoly (Polytechnique Montréal)
- Juan Torres (UdeM - Université de Montréal)
- Priscilla Dutra Dias Viola (UdeM - Université de Montréal)
- Maria Laura Guerrero Balarezo (Polytechnique Montréal)
- Martin Trépanier (Polytechnique Montréal)
Programme
Bienvenue
Mobilité, mode et genre
-
Communication orale
Des différences qui convergent : regards de femmes cyclistes de Montréal (Canada) et de Belo Horizonte (Brésil) sur leur milieuPriscilla Dutra Dias Viola (UdeM - Université de Montréal), Juan Torres (Université de Montréal), Geneviève Boisjoly (Polytechnique Montréal)
Les caractéristiques personnelles (genre, âge, revenu, etc.) ou environnementales (infrastructures, climat, sécurité routière et urbaine, etc.) peuvent être déterminantes pour le choix du vélo. Ces déterminants peuvent être considérés de manière subjective (variant selon les perceptions individuelles), ou objective (indépendants des variations perceptuelles des individus). Cette communication permettra de rendre compte des pratiques du vélo et de leurs déterminants chez les femmes de Montréal (Canada) et de Belo Horizonte (Brésil). Elle prend appui sur 46 entrevues semi-dirigées menées auprès de femmes cyclistes de deux villes (28 à Montréal et 18 à Belo Horizonte), âgées entre 18 et 35 ans et analysées selon une approche qualitative. Lors des entretiens, les participantes ont partagé leurs points de vue sur le contexte dans lequel elles font du vélo, les avantages et les inconvénients du vélo, ainsi que les conflits et les peurs auxquels elles sont confrontées. De plus, les participantes se sont exprimées sur l'image véhiculée socialement à l’égard des femmes cyclistes et sur la manière dont une telle image les affecte. Ce travail permet de suggérer des moyens pour surmonter les obstacles au cyclisme auxquels les femmes sont confrontées et contribue à une meilleure compréhension des défis contemporains de la promotion du vélo dans une perspective de genre et globale
-
Communication orale
La ville est pour qui? Modèles de mobilité des femmes à MontréalMaria Laura Guerrero Balarezo (Polytechnique Montréal)
Traditionnellement la planification des transports a eu tendance à favoriser les besoins de déplacement des hommes adultes dans les trajectoires domicile-travail, ignorant les expériences et les besoins distincts des femmes. Plus récemment, des chercheurs se sont penchés sur la relation entre le transport et le genre, mettant en évidence d'importantes divergences dans les comportements de déplacement (par exemple, le mode, le motive, l'heure du déplacement, etc.). Pourtant, une analyse spatiale approfondie, en particulier pour le contexte canadien, demeure rare. Ce travail examine les différences dans les habitudes de déplacement spatial entre les hommes et les femmes à Montréal, à l'aide de l'enquête Origine-Destination de 2018 et de deux modèles de régression linéaire. Les résultats montrent que les déplacements des femmes ont tendance à être plus locaux que ceux des hommes, peut-être attribuables à des facteurs socioculturels. Les différences entre les genres sont plus visibles parmi les groupes à faible revenu, tandis que la présence d'enfants dans le ménage réduit les distances des femmes plus sensiblement que celles des hommes. Cette recherche souligne la nécessité pour les chercheurs et les praticiens de tenir compte des différences entre les genres dans la planification des transports et peut contribuer à formuler et à concevoir des politiques et des systèmes de transport plus équitables pour les hommes et les femmes.
-
Communication orale
Perspectives genrées de la dépendance automobile et de l’exclusion sociale liée à la mobilité à Québec et à StrasbourgDominic Villeneuve (Université Laval)
Le genre semble faire une différence dans la façon dont nous percevons, vivons et participons à la ville. Cette communication présente une analyse lexicométrique (statistique du discours) portant sur la différence entre les discours des hommes et des femmes. L’étude passe en revue le discours de femmes et d’hommes issus de 57 ménages sans voiture lors d’entretiens semi-dirigés réalisés dans les régions de la communauté métropolitaine de Québec (Canada) et de l’Eurométropole de Strasbourg (France). Nous présenterons les différences dans la proportion des hommes et des femmes dans les ménages sans voiture dans ces deux régions et la description qu’ils font de leur mobilité quotidienne. Nous discuterons des différences dans le discours des hommes et de femmes quant à la perception de la dépendance automobile, la perception de l’accessibilité des destinations pour les personnes sans voiture, les politiques publiques de transport, les raisons qu’ils évoquent pour expliquer ne pas avoir de voiture, les activités qu’elles et ils ne peuvent plus faire du fait de ne pas avoir de voiture, leurs perceptions de l’exclusion sociale liée à la mobilité et finalement nous présenterons les différences quant à ce qu’ils imaginent serait différent de l’état actuel des choses dans un monde parfait pour les ménages sans voiture.
Urbanisme et genre
-
Communication orale
Les rapports aux soins et aux soignants comme indicateur de santé : cas des femmes immigrantes maghrébines de MontréalNaziha Benguergoura (UQAM - Université du Québec à Montréal)
La question de la disponibilité et de l’accessibilité aux soins met en rapport deux acteurs principaux; les soignant.e.s et les demandeuses de soins. Organisés par l’espace clinique, ces rapports ne sont jamais totalement neutres mais plutôt teintés des représentations sociales de chacune des parties. Dans le cas des femmes immigrantes, ces rapports se heurtent à des barrières linguistiques, culturelles, religieuses et ethniques ainsi qu’à des stéréotypes du genre. La relation entre les soignant.e.s et les soignées est alors soumises aux préjugés et aux stigmatisation à la fois dans les propositions de traitement et dans le recours effectif aux soins, ce qui pourrait expliquer en partie la sous-utilisation des structures de soins exprimée par les statistiques québécoises et canadiennes. Afin d’explorer les effets des rapports entre soignant.e.s et soignées sur la perception de la santé et la santé objective, une étude doctorale a été menée auprès de femmes immigrantes vivant dans les quartiers de St-Laurent et de Montréal-Nord et appartenant aux communautés maghrébines. C’est à travers le discours des femmes que je voulais saisir les perceptions ainsi que les craintes qui résulteraient à la fois des expériences avec les soignant.e.s et le système de santé.
-
Communication orale
Le graffiti et le street art des femmes montréalaises : entre expression et régulationMarie-Étienne Mélançon (UdeM - Université de Montréal)
Le graffiti et le street art sont des interventions directes dans l’espace urbain qui représentent une forme d’expression contemporaine. Cette communication aura pour but de rendre compte de ces pratiques faites par des femmes à Montréal et du sens qu’elles souhaitent leur donner. Elle prend appui sur 10 entrevues semi-dirigées menées auprès de sept femmes pratiquant le graffiti et le street art âgées de 18 à 35 ans ainsi qu’auprès de trois professionnel(le)s travaillant au sein d’organismes valorisant le graffiti et le street art à Montréal. Lors de ces entrevues, les femmes ont exprimé que leurs pratiques peuvent être pour elles des moyens d'expression créative, identitaire, politique ou sociale dans l'espace urbain. Les entrevues ont révélé que leurs motivations (besoins et messages) et les contraintes (légales et de sécurité) sont mises en perspectives par ces femmes lorsqu’elles choisissent un type de pratique (légale ou illégale). Il semble que la forme urbaine ainsi que les dispositifs (légaux ou non) du graffiti et du street art à Montréal peuvent influencer le choix et les moyens d'expression des femmes dans l'espace urbain. Ce travail contribue à une meilleure compréhension de la portée et des limites des opportunités qu’ont les femmes pour s’exprimer et poser des actions directes dans l’espace public urbain à Montréal ainsi que la place qu’elles occupent à l’intérieur de ce dernier.
-
Communication orale
L'urbanisation, le corps et des futurs améfricains : l'épistémologie d'une femme des favelasAnne-Marie Veillette (University of Pennsylvania)
Cette présentation explore la définition de la résistance donnée par une femme résidente de favela à Rio de Janeiro (Brésil) - Lucia – pour en démontrer le potentiel épistémologique en études urbaines. Plus spécifiquement, je cherche, dans un premier temps, à (ré)affirmer que les femmes des favelas produisent des savoirs sur la ville. Dans un second temps, je souhaite mettre en évidence que les femmes des favelas peuvent être et sont d’importantes protagonistes d’urbanisation. Cela est fondamental dans le contexte carioca, où les favelas continuent d’être largement associées à la violence et à la marginalité, et les femmes de favelas, à des images contrôlantes comme celles de « victimes » ou de « mères de bandits ». Je soutiens que la définition de la résistance proposée par Lucia offre un cadre épistémologique pour étudier l'urbanisation, notamment parce qu'elle déplace la question de « qu’est-ce que l'urbanisation » à « d’où vient-elle? ». En m'appuyant sur les théories féministes, afro-diasporiques et décoloniales, je soutiens que : (1) la favela produit de l’urbanisation (au lieu que la favela soit toujours perçue comme façonnée par des forces extérieures) ; (2) que l'urbanisation émerge subjectivement de savoirs situées, translocalisées et corporels ; et que (3) que les corps des femmes des favelas constituent, dans de nombreux cas, la base même d’un futur « Autre » pour la ville, c’est-à-dire un futur améfricain
-
Communication orale
Le harcèlement de rue : un frein à l’accès des filles et des femmes à la villeMélusine Dumerchat
Montréal est souvent présentée comme une ville sécuritaire et pourtant, de nombreuses femmes témoignent y subir des violences dans l’espace public, couramment appelées « harcèlement de rue » (Courcy, Lavoie Mongrain et Blais, 2022). À Montréal, comme dans d’autres villes canadiennes, il s’agit d’une pratique fréquente, qui cible principalement les femmes et les personnes des minorités de genre et parmi elles, les jeunes en sont les premières victimes (ibid; Cotter et Savage, 2018). Vécu dès l’enfance, le harcèlement de rue marque de façon durable le rapport des femmes à l’espace public, en les conditionnant à y vivre de l’insécurité et développer des tactiques d’évitement (Blais, Dumerchat et Simard, 2021). Malgré ce constat, la recherche sur le harcèlement de rue est récente au Québec et le vécu des jeunes reste particulièrement sous-documenté. C’est pour pallier cette lacune qu’une recherche-action sur les vécus des jeunes en matière de harcèlement de rue a été menée, en partenariat avec le Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) (Dumerchat, 2023). Cette communication vise à en présenter les principaux résultats et à exposer notamment en quoi le harcèlement de rue constitue un frein à l’accès des filles et des femmes à l’espace public. Il s’agira d’explorer comment se manifeste le harcèlement de rue commis spécifiquement envers les jeunes, quels sont ses effets sur les trajectoires des enfants, adolescentes et jeunes adultes et comment entendent-elles y répondre.
Dîner
Pratiques urbaines, infrastructures, culture et genre
-
Communication orale
D’une vision féministe de la ville à une recherche-action pour une mobilité durable, inclusive et sécuritaire : démarche et résultats préliminairesMarie-Ève Desroches (INRS - Institut national de la recherche scientifique)
Le milieu féministe montréalais a récemment amorcé une réflexion autour du droit à la ville. Les groupes de femmes ont ensemble articulé un ensemble de revendications pour l’avenir de la mobilité, du logement, des milieux de vie et du travail à Montréal/Tiohtià:ke. En continuité avec cette vision, une recherche-action sur la mobilité des femmes en situation de handicap a été amorcée. Cette démarche est centrée sur une dizaine de femmes qui vivent avec diverses limitations qui affectent leur mobilité (motrices, auditives, vision, cognitives, douleurs, etc.). Ces dernières tiennent un journal de bord sur leur mobilité durant la période hivernale et estivale et participent à des groupes de discussion. Elles documentent ainsi les obstacles et sources d’insécurité quotidiennes dans leurs déplacements à Montréal. La perspective de ces expertes du vécu permet de jeter un regard nouveau sur les aménagements pour le transport actif, la formation du personnel et l’offre de services de transport collectifs nécessaires pour assurer une mobilité durable réellement inclusive et sécuritaire.
-
Communication orale
La considération de la dimension du genre dans les projets d’écoquartier au Québec : une étude de cas multiplesMarilyn Jean (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Depuis la définition du développement durable avec le rapport Brundtland, de nouveaux modèles de développement urbain durable ont émergé. C’est le cas des écoquartiers. Ces derniers, de plus en plus présents dans le paysage de nos villes, sont souvent considérés comme d’excellents exemples de projet urbain. Néanmoins, comme le signale Raibaud (2015) dans son article «Durable mais inégalitaire : la ville», il y a lieu de se questionner sur qui planifient les écoquartiers et qui en bénéficient. Notre recherche a pour objectif d’interroger ces projets d’urbanisme durable et la place du genre dans leur conception. Il est reconnu que les réalités et les besoins des femmes et des hommes dans la ville ne sont pas identiques. Certaines composantes de l’aménagement permettent la création de quartiers plus sensibles à la notion du genre. C’est notamment ce que l’on retrouve dans le guide de «Gender Mainstreaming» en aménagement et développement urbain de la ville de Vienne. Nous avons développé une grille d’analyse basée sur cette approche et étudié trois cas montréalais, soit le Technopôle Angus, l’écoquartier Lachine-Est et l’écoquartier Louvain-Est. Des entrevues avec des acteur.e.s clé.e.s ont complété l’analyse. La communication présentera les modalités d’intégration du genre dans les aménagements dits durables, les convergences et les différences de même que les enjeux liés au processus de planification de projets urbains novateurs.
-
Communication orale
Les infrastructures en soutien à la vie quotidienne : un nouveau regard sur l’aménagement des villes et le careSophie Paquin (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Les enjeux environnementaux et d’égalité de genre viennent requestionner les principes et les façons d’aménager les villes. Les rôles sociaux et les activités reliées à ces rôles se manifestent dans l’environnement bâti, souvent dans une relation de modelage mutuel. Cette communication explorera comment l’aménagement des villes contribue à la réalisation des rôles sociaux liés au care, rôles principalement réalisés par les femmes. La théorie des infrastructures de soutien à la vie quotidienne dans l’espace urbain (IVQ) permet de démontrer comment l’aménagement des villes est en étroite relation avec les tâches et activités liées au care. Les IVQ regroupent des équipements publics, collectifs, les commerces et services, les systèmes de transport, les espaces vert et l’urbanisme éphémère. Ces espaces construits sont perçus et appropriés de façon différenciée par les femmes. En mobilisant le cadre théorique des IVQ, nous avons fait l’analyse des guides de planification urbaine rédigés par des villes européennes ayant adopté une stratégie de Gender Sensitive Planning. Notre analyse identifie les formes que prennent les IVQ, les besoins identifiés, un certain nombre de pratiques sociospatiales de genre typiques qui se manifestent dans l’espace urbain et les stratégies d’action publique mis en oeuvre. Une série d’indicateurs sera présentée. La communication conclura en discutant du potentiel de transformation des villes par l’action publique pour un care plus égalitaire.
-
Communication orale
Créer des places publiques urbaines féministes : les cas de Montréal et de MontevideoCharmain Levy , Sylvie Paré (Université du Québec à Montréal)
Les espaces publics féministes sont rares. Pourtant, dernièrement, certaines villes se sont efforcés de créer des places publiques qui reconnaissent la contribution des femmes à la société moderne et dans certains cas, l'urbanisme féministe est devenu un champ d'action. Partant du constat que les liens entre la citoyenneté urbaine et les droits des femmes restent peu abordé, cette communication analyse deux cas de places publiques dédiées aux féministes : la Place des Montréalaises à Montréal et la Plaza las Pioneras à Montevideo. La Place des Montréalaises est un grand projet urbain en cours de développement. La construction de cette place publique est prévue sur un viaduc d'autoroute situé entre le Vieux-Montréal et le centre-ville. À Montevideo, l'administration progressiste de la ville, forte de 30 ans d'expérience en matière de gender mainstreaming, a décidé en 2017 de créer une place publique pour le mouvement féministe. Dans les deux cas, nous examinons le type de négociations derrière ces projets urbains, la dynamique entre les parties prenantes et ce que cet espace public signifie pour elles. Nous montrons également comment la mobilisation et la coordination des femmes de la société civile avec les fémocrates municipaux et les professionnels/chercheurs jouent un rôle important dans les dynamiques de pouvoir. Ancrée dans une approche féministe, nous analyserons les liens entre la création des places publiques et comment elles contribuent à une ville plus féministe.
Le genre dans le discours
-
Communication orale
La circulation du discours international sur l'approche Femmes et VillesMélissa Côté-Douyon (INRS - Institut national de la recherche scientifique)
Depuis la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1996 (Habitat II), l’approche femmes et villes, qui consiste à intervenir sur les milieux urbains en prenant en considération les enjeux de genre, a intégré le discours de différents acteurs et actrices, dont de nombreuses organisations internationales (Biarrotte 2017). Le discours au sujet de cette approche circule d’autant plus à l’échelle internationale dans un contexte de circulation internationale des modèles et politiques urbaines (Béal, Epstein et Pinson 2015). En parallèle, une préoccupation grandissante pour les enjeux de genre résulte de l’impulsion des mouvements féministes transnationaux qui militent, notamment au sein de forums internationaux, pour une prise en compte de ces enjeux dans la manière dont les villes sont planifiées (Gabizon 2016). On observe aujourd’hui ce qu’on pourrait appeler un « urban gender agenda » (Chant et McIlwaine 2015, 14) qui s’incarne, par exemple, dans des cadres normatifs mondiaux comme le Nouveau Programme pour les villes (Moser 2017). En adoptant une approche conceptuelle multiéchelle centrée sur les acteurs et actrices, les résultats de recherche, découlant principalement d’une analyse documentaire, présentés dans cette communication permettent de caractériser le discours international sur l’approche femmes et villes et de mettre en lumière les mécanismes qui sous-tendent sa circulation à travers le monde.
-
Communication orale
Réflexions du projet Femmes et mobilité sur les inégalités de genre en matière de mobilité dans une perspective intersectionnelleMarie-Soleil Gagné (Accès transports viables)
Cette conférence se veut une introduction à l’outil d’aide à la décision que représente l’analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+). Après un bref état des lieux de la mobilité au féminin dans une perspective intersectionnelle, nous replacerons l’outil dans son contexte historique. Nous explorerons les différentes étapes de l’ADS+ et mettrons de l’avant la pertinence d’appliquer l’ADS+ dans l’élaboration de projets d’aménagement et de transport inclusifs.