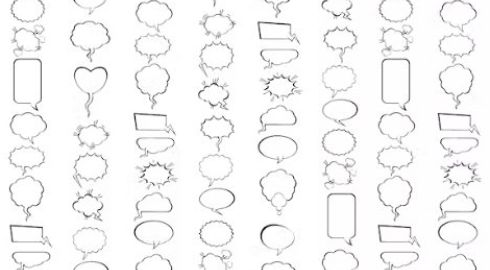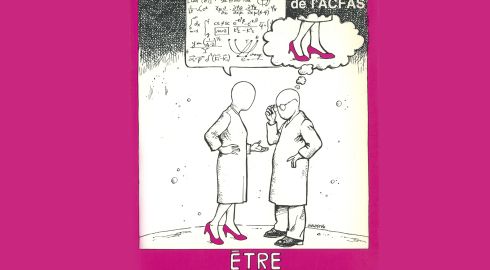Ricarson Dorcé, ethnologue et poète, s’interroge sur la notion de savoir. C’est quoi, savoir? Il part en voyage littéraire à la rencontre d’auteur·trices pour en discuter. Après Yanick Lahens, Mohamed Mbougar Sarr et Nadia Yala Kisukidi, voici sa quatrième escale, avec Gisèle Sapiro, sociologue française, spécialiste des écrivain·es et des institutions littéraires dans les « années noires ».
Cet entretien est publié conjointement dans le Magazine de l’Acfas et la revue Liberté.
Gisèle Sapiro est docteure en sociologie, spécialiste de sociologie des intellectuel·les, de la littérature et de la traduction. Directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, France), elle est depuis 2011 directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. De 2010 à 2013, elle a dirigé le Centre européen de sociologie et de science politique. Dans plusieurs ouvrages, elle réfléchit sur la notion de responsabilité de l’écrivain·e. Ses travaux s’inscrivent dans la continuité de l’œuvre de Pierre Bourdieu. En 2000, elle a obtenu la médaille de bronze du CNRS et, en 2021, celle d’argent.
Ricarson Dorcé : Dans La responsabilité de l’écrivain, une œuvre éditée en 2011 visant à combler les lacunes de la sociologie historique du champ littéraire, vous avez revisité l’histoire sociale et politique de la littérature. Quels sont les enjeux éthiques qui sous-tendent l’engagement de l’écrivain·e?
Gisèle Sapiro : Alors que Bourdieu s’est concentré dans Les règles de l’art sur l’autonomisation du champ littéraire par rapport aux contraintes économiques, je me suis centrée dans ce livre sur les combats des écrivain·es pour conquérir leur liberté d’expression et leur autonomie par rapport à la morale publique et à l’idéologie dominante. J’ai pris pour objet et pour trame les procès littéraires depuis le début du XIXe siècle, moment où la liberté de presse est adoptée durablement (quoique de façon très restrictive) en France, si l’on met à part les cinq années qui ont suivi la proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Je montre que les écrivain·es ont élaboré leur conception de leur éthique de responsabilité en se confrontant et en s’opposant aux définitions hétéronomes produites par les institutions sociales et politiques, définitions qui se reflètent lors des procès et des débats parlementaires sur la liberté de presse, ainsi que dans la critique littéraire de l’époque. De ces luttes pour l’autonomie ont émergé deux postures idéaltypiques : d’un côté l’art pour l’art, incarné par Gautier (dans sa fameuse préface à Mademoiselle de Maupin), Flaubert, Wilde et jusqu’au Nouveau Roman (Robbe-Grillet et Sarraute l’ont théorisé), et de l’autre l’engagement, illustré par Hugo, Zola, Gide, Sartre (qui l’a également théorisé) et Beauvoir (qui en a fait le sujet de son roman Les mandarins).
Quand on parle d’engagement, on pense d’abord aux écrivain·es de gauche. À droite, n’est-il pas également possible de rencontrer des intellectuel·les réputé·es progressistes? Qu’est-ce qui donne sens à l’importation des catégories de « gauche » et de « droite » dans le champ littéraire?
Il y a certainement une tradition d’intellectuel·les, voire d’idéologues de droite, qui se divisent en plusieurs courants. Je distinguerai ici pour simplifier le courant réactionnaire, qui remonte à la contre-révolution (de Maistre, Bonald) et a trouvé son chef de file sous la Troisième République en la personne de Charles Maurras, le fondateur de la Ligue d’Action française. Ces intellectuels réactionnaires se sont constitués comme tels en s’opposant aux dreyfusards, qu’ils ont initialement désignés de cette appellation d’« intellectuels » avec mépris, pour les disqualifier. Cette mouvance a formé l’aile traditionaliste du régime de Vichy. Mais parmi les disciples de Maurras, certains se sont tournés vers la modernité et les régimes fascistes. C’est le cas par exemple de Brasillach et de Rebatet, qui deviendront des ultra-collaborationnistes sous l’occupation allemande. Et une petite fraction de la gauche s’est aussi tournée vers le fascisme suivant le modèle italien. On peut penser aux deux partis fascistes fondés l’un par Doriot, ancien communiste, et l’autre par Déat, ancien socialiste. Mais ce type de parcours reste minoritaire.
Il reste que l’importation des notions de droite et de gauche dans le champ littéraire revêt un sens particulier; elle est réfractée selon les enjeux propres au champ. À partir du début du XXe siècle, quand l’usage de ces catégories politiques se généralise, elles sont retraduites pour désigner par exemple la Rive droite et la Rive gauche, ou encore la polarisation de l’Académie Goncourt lors des votes pour désigner le lauréat du prix. C’est ainsi la « droite » du jury emmenée par Léon Daudet qui a soutenu la candidature de Proust, contre Dorgelès, le candidat de la « gauche » académique rangée derrière Lucien Descaves. Le succès de Proust, qui avait une réputation de salonnard, contre un écrivain-soldat témoignant de la guerre, fit scandale.
Dans La sociologie de la littérature, essai publié en 2014, vous avez étudié « les médiations entre les œuvres et les conditions sociales de leur production ». Comment aborder la composante matérielle de la littérature sans tomber dans le « réductionnisme sociologique »?
Je m’appuie sur la théorie du champ littéraire de Bourdieu pour tenter de dépasser l’opposition entre, d’un côté, l’analyse purement textuelle, à laquelle j’ai été formée dans mes études littéraires, et, de l’autre, une approche matérialiste réductionniste qui ferait l’impasse sur les œuvres. J’ai identifié trois ensembles de médiation.
Premièrement, les conditions de production : elles vont des contraintes idéologiques (par exemple, la censure dans les régimes autoritaires, mais aussi l’organisation des professions intellectuelles et artistiques) ou économiques (par exemple, les concentrations dans l’édition qui accroissent les attentes en matière de rentabilité) aux conditions sociales d’accès au métier d’écrivain·e (selon des variables sociales comme le capital économique, le capital culturel, le genre, l’ethnicité, la citoyenneté, l’appartenance à la majorité ou à une minorité) et au fonctionnement de ce que le regretté Alain Viala appelait les institutions de la vie littéraire (cénacles, académies, prix).
Deuxièmement, l’espace des possibles, qui inclut le répertoire des formes disponibles et accessibles, pour reprendre les concepts forgés par Itamar Even-Zohar, à savoir les genres littéraires mais aussi les sous-genres, les styles, les options formelles (narrateur omniscient ou focalisation du point de vue, rime ou vers libre). Le choix de ces options positionne un·e auteur·e dans le champ littéraire (par exemple, la première moitié du siècle a opposé les modernes, partisans du vers libre à l’instar d’Apollinaire, auquel Anna Boschetti a consacré une belle analyse en termes de champ, aux anciens qui défendaient la prosodie classique comme Maurras). Ces choix doivent être rapportés, d’un côté, à cet espace des possibles et, de l’autre, aux trajectoires collectives et individuelles ainsi qu’aux dispositions éthiques et esthétiques, afin de comprendre les conditions permettant les révolutions symboliques, comme Bourdieu l’a fait dans le cas de Manet et Pascale Casanova dans les cas de Becket et de Kafka. Dans cet espace des possibles, les identités sociales et nationales sont aussi un marqueur tantôt subi, tantôt revendiqué : théâtre bourgeois, littérature prolétarienne, écriture-femme, autant d’étiquettes qui ont fonctionné dans le champ littéraire de leur époque, et la classification nationale des écrivain·es est encore très opérante malgré sa remise en cause par la valorisation des parcours migratoires et des expériences minoritaires depuis les années 1990, comme en témoigne le prix Nobel (auquel je viens de consacrer un article dans la revue Poetics).
Et le troisième ensemble de médiations concerne la réception, qui contribue à la signification sociale de l’œuvre. Cette réception est en partie cadrée par les intermédiaires qui la diffusent, à travers ce que Roger Chartier appelle la «mise en livre», avec la couverture, le paratexte (quatrième de couverture, préface ou blurbs, le cas échéant), le matériel publicitaire. La réception inclut la réception critique, les prix littéraires, les festivals de littérature, sur lesquels j’ai travaillé, mais aussi les procès et les appropriations idéologiques dont l’œuvre fait l’objet, ainsi que les jugements moraux prononcés contre les œuvres en raison de leur contenu ou des attitudes de leur auteur·e (l’exemple de Gabriel Matzneff faisant converger les deux).
Toutes ces médiations contribuent à produire la signification sociale de l’œuvre, qui peut évoluer avec le temps : Flaubert a inclus son procès dans les rééditions de Madame Bovary, devenu un classique après avoir fait scandale en son temps.

Selon vous, le champ littéraire est-il un champ autonome? Pourquoi?
Le champ littéraire s’est historiquement autonomisé, mais cette autonomie demeure toujours relative et variable selon les conditions sociopolitiques : en régime autoritaire, l’autonomie de l’écrivain·e est fortement réduite, comme on l’observe en Russie ou en Chine aujourd’hui, mais c’est aussi le cas dans les régimes dits illibéraux comme la Turquie ou la Hongrie. Le degré d’autonomie n’est pas donné et doit être étudié à travers le cadre légal mais aussi ses applications, les autres formes de contrôle exercées par le gouvernement, les institutions religieuses, et les pratiques de publication et de diffusion. L’hétéronomie peut également advenir par les contraintes économiques, qui ont un effet de censure en écartant les œuvres plus expérimentales parce qu’elles sont supposées peu rentables.
Pierre Bourdieu a dirigé votre thèse de doctorat. Vous avez collaboré avec lui. Vous avez écrit sur lui. Selon vous, qu’est-ce qui a caractérisé la figure de cet éminent intellectuel engagé?
C’était un grand savant et en même temps un homme révolté, en colère contre les institutions responsables de la reproduction sociale et des inégalités, qu’il n’a cessé de combattre. Mais c’est la science et non pas l’idéologie qui était son arme : l’objectivation des rapports sociaux par l’observation, les entretiens, la quantification, l’analyse des trajectoires individuelles et collectives, et l’étude des logiques institutionnelles qui favorisent la reproduction, comme l’école. Alors que les intellectuel·les révolutionnaires débattaient la question de savoir si c’était la classe prolétarienne ou la classe paysanne qui ferait la révolution sans jamais avoir étudié les sociétés précapitalistes, il a effectué des enquêtes de terrain sur la société algérienne en période coloniale, observant les résistances à la modernisation forcée par le colonialisme, les effets des regroupements urbains contraints, et les conditions de travail. Il abordait toujours des sujets brûlants avec les armes de la sociologie, des enquêtes empiriques mêlant les approches quantitative et qualitative, et aussi un cadre conceptuel qu’il a élaboré, ancré dans la tradition sociologique, notamment Durkheim, Marx, Weber, mais aussi nourri de sa formation philosophique et de ses vastes lectures dans d’autres domaines, comme l’histoire de l’art. À la fin de sa vie, il s’est engagé dans un combat contre le néolibéralisme, qui est devenu sa grande cause. Pour ce faire, il a tenté de donner corps à un « intellectuel collectif » qui se différencie de la figure de l’intellectuel total à la Sartre. Plus proche de l’intellectuel spécifique de Foucault, cet intellectuel collectif tient compte de la division du travail d’expertise tout en y apportant un regard critique contre le modèle de l’expert pourvoyant un diagnostic « neutre » aux dominants. L’intellectuel collectif articule collaboration scientifique et approche critique. Il a pris diverses formes, dont la collection de livres en petit format « Raisons d’agir », qui a été ensuite imitée par d’autres.
En 1999, vous avez publié La guerre des écrivains, 1940-1953, un essai dans lequel vous expliquez pourquoi certain·es écrivain·es se sont associé·es au régime de Vichy, alors que d’autres ont choisi d’entrer dans la Résistance. Pouvez-vous revenir sur les divisions politiques dans le champ littéraire? Comment comprenez-vous les différentes postures politiques?
J’ai montré que les choix politiques des écrivain·es en cette période de crise pouvaient se comprendre à la lumière de leur position dans le champ littéraire. En effet, le clivage entre, d’un côté, le soutien au régime de Vichy et donc à la politique de collaboration avec l’occupant et, de l’autre, la Résistance recoupe la polarisation entre dominants et dominés dans le champ. Ce sont les écrivains les plus établis et les plus institutionnalisés, de plus de soixante ans, notamment la majorité des membres de l’Académie française (dont le maréchal Pétain faisait partie), qui se rallient au régime de Vichy. À l’autre pôle, la Résistance intellectuelle recrute principalement parmi les jeunes poètes, la poésie étant un genre relégué aux marges du marché du livre depuis la fin du XIXe siècle qui a vu le triomphe du roman. Ils s’y rallient à travers des réseaux littéraires, par le biais de petites revues semi-légales, où Aragon lance le mot d’ordre de la « littérature de contrebande » avant de passer à la clandestinité. Progressivement, la Résistance rallie aussi un certain nombre d’écrivains plus âgés opposés au régime, qui sont reconnus au pôle de production restreinte du champ littéraire, c’est-à-dire au pôle autonome, comme André Gide et François Mauriac. Ils et elles sont les cibles des collaborationnistes, qui sont un peu moins institutionnalisés que les vichystes et qui sont un peu plus jeunes (la cinquantaine en moyenne), à l’instar de Drieu La Rochelle ou de Montherlant. Évidemment ces choix sont profondément idéologiques, mais l’idéologie n’est pas dissociée des dispositions éthiques et en l’occurrence esthétiques, d’autant que c’est en tant qu’écrivain·es qu’ils et elles se positionnent dans une conjoncture de surpolitisation où la littérature est devenue un enjeu pour toutes les forces en présence. Dans ce contexte, certains affrontements politiques ont pris des allures de règlement de compte littéraire, comme entre Drieu La Rochelle et Aragon.
En 2018, vous avez publié Les écrivains et la politique en France : de l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, ouvrage dédié à la mémoire de Pierre Bourdieu. Par ailleurs, depuis la fin des années 1960 à nos jours, avez-vous recensé des écrivain·es qui symbolisent en France la figure de l’intellectuel·le engagé·e? Avez-vous fait le constat d’une dépolitisation ou repolitisation du champ littéraire ces dernières années? Quelle est la place des œuvres littéraires dans le débat politique et social actuel?
Il y a des cycles de politisation et de dépolitisation, qui tiennent en partie aux circonstances politiques, et en partie au mouvement de balancier que l’on observe dans l’histoire du champ intellectuel. L’art pour l’art a émergé non seulement contre le théâtre bourgeois, mais aussi contre l’art social et le prophétisme incarné par Victor Hugo et George Sand. L’affaire Dreyfus est un moment de forte politisation du champ littéraire, qui se divise, avec côté antidreyfusards la majorité de l’Académie française et côté dreyfusards les symbolistes et Zola, tandis que les naturalistes se sont divisés entre les deux, comme l’a analysé Christophe Charle. La Première Guerre mondiale est aussi une conjoncture de crise et d’injonction au nationalisme à laquelle ont résisté quelques pacifistes comme Romain Rolland, qui a publié Au-dessus de la mêlée, et Barbusse, qui a dénoncé les horreurs de la guerre dans son roman Le feu. Les années 1930 sont un moment de repolitisation qui prélude à la surpolitisation de la période de l’Occupation, dont j’ai déjà parlé, et à l’issue de laquelle Sartre théorise la littérature engagée. Contre la littérature engagée illustrée par Sartre et Beauvoir, et contre le réalisme socialiste promu par les communistes, le Nouveau Roman revendique à nouveau, à la fin des années 1950, l’art pour l’art et l’engagement par le langage et la forme. Ce qui n’empêche pas les nouveaux romanciers et romancières de signer la Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, autrement appelée Manifeste des 121. Cette critique du Nouveau Roman contre la littérature engagée a longtemps pesé sur le champ littéraire français, malgré une repolitisation autour de Mai 68 bien étudiée par Boris Gobille, et autour de l’engagement féministe, qu’incarne l’œuvre de Monique Wittig.
Il faut distinguer l’engagement par les prises de position de l’engagement par l’œuvre, qui sont les deux modalités traditionnelles d’engagement : elles peuvent être associées, comme chez les existentialistes, ou dissociées, comme chez les nouveaux romanciers. La figure de l’intellectuel total incarnée par Sartre a été remise en cause par la montée de l’expertise, et la parole de l’écrivain·e relativisée face à l’essor des sciences sociales à partir des années 1950, ce qui fait qu’on ne trouve plus en France de telle figure d’écrivain·e engagé·e sur tous les fronts, à la différence d’autres pays, notamment sous les régimes autoritaires ou illibéraux. Concernant l’engagement par l’œuvre, le social a été longtemps banni du roman français – à la différence du roman francophone où il était très présent –, mis à part quelques livres sur l’usine au début des années 1980, dont L’établi de Robert Linhart. L’œuvre autosociobiographique d’Annie Ernaux constituait une exception. Il a fallu réinventer des formes d’écriture novatrices pour parler de ces réalités sociales ou de l’histoire, ce qui arrive depuis une vingtaine d’années dans la littérature expérimentale, face à la montée de l’extrême droite, qui a aussi ses incarnations littéraires, comme je l’analyse dans l’épilogue des Écrivains et la politique. Il y a eu, par exemple, en 2012, une mobilisation de la gauche « esthète » du champ littéraire, comme je la qualifie, contre le pamphlet de Richard Millet Éloge littéraire d’Anders Breivik, le meurtrier norvégien. Elle s’est rassemblée derrière Le Clézio et Annie Ernaux, qui ont dénoncé ce livre dans des articles argumentés. Les formes d’engagement ont aussi changé, elles sont devenues moins visibles médiatiquement, mais plus ancrées dans l’expérience quotidienne, dans le cadre de résidences d’écriture qui requièrent de plus en plus des activités d’animation, ou sous la forme du témoignage, comme le fait Arno Bertina dans Ceux qui trop supportent. On peut parler d’une politique de la forme. Il faut noter que les auteur·es francophones issu·es du continent africain ou des Caraïbes n’avaient quant à eux et elles pas attendu cette phase de repolitisation, et leur œuvre est souvent porteuse d’une dimension ethnographique, politique ou mémorielle, ce qui n’empêche pas le travail de la forme, comme chez Mohamed Mbougar Sarr ou Makenzy Orcel.
En 2020, vous avez réédité, de façon autonome et en version poche, la quatrième partie de La responsabilité de l’écrivain : littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècle) sous le titre Des mots qui tuent : la responsabilité de l’intellectuel en temps de crise (1944-1945). En quoi était-ce important pour vous de revenir sur cette période consacrée à la Libération?
Quand j’ai commencé à travailler sur les années 1940, il y a plus de trente ans de cela, je pensais que je travaillais sur un passé révolu, qui jamais ne pouvait revenir. La réémergence du nom de Maurras comme référence intellectuelle, les entreprises de réédition de Maurras, de Rebatet, le projet avorté de Gallimard de rééditer les pamphlets de Céline après qu’ils ont été réédités au Québec (où ils sont tombés dans le domaine public plus tôt qu’en France), dans une conjoncture de montée de l’extrême droite, m’ont fait réaliser la nécessité de rappeler les prises de position pour lesquelles ces auteurs ont été condamnés à la Libération, même si cette justice s’est heurtée à des difficultés dans la qualification des actes de parole : une partie de ces procès se sont tenus avant la définition des crimes contre l’humanité par le tribunal de Nuremberg fin 1945, et bien avant sa transposition dans le droit français; le crime pour lequel ils étaient poursuivis était celui d’«intelligence avec l’ennemi», c’est-à-dire le crime de trahison nationale. Sartre, en théorisant la responsabilité de l’écrivain·e, l’a dégagée de ce cadre national pour lui conférer une portée universelle en l’associant à sa conception de la liberté.
Il m’importait surtout de rappeler que, dans les conjonctures autoritaires, où les opinions contraires ne peuvent s’exprimer, la parole autorisée se trouve en situation de monopole et a de ce fait un pouvoir de légitimation idéologique des actes perpétrés contre les populations discriminées.
Même dans les conjonctures non autoritaires, je soutiens que les propos racistes, et plus généralement ce qu’on appelle les discours de haine contre les personnes en raison de leurs origines, de leur sexe, de leur religion, de leur appartenance ethnique, ou de leurs préférences sexuelles, ne relèvent pas de la liberté d’opinion mais sont des actes de parole dotés d’un pouvoir performatif (pour reprendre la notion de John Austin) : celui de stigmatiser les populations cibles – au sens où le sociologue Erving Goffman définit les stigmates. C’est pourquoi je préfère parler de discours de stigmatisation plutôt que de discours de haine, car ils n’expriment pas seulement les sentiments de ceux et celles qui les profèrent, mais ils font quelque chose aux individus ou groupes ciblés, en les disqualifiant et en les discréditant socialement, voire en les déshumanisant. Or comme on le sait, tous les massacres de masse ont été précédés par une phase de déshumanisation, et, sans parler de causalité, car il n’y a pas de causalité mécanique entre discours et actes, on peut parler de légitimation. Sans aller jusqu’au massacre, ces discours légitiment du reste au quotidien les différentes formes de discrimination officielles ou officieuses dont les groupes cibles sont l’objet, en fonctionnant comme des prophéties autoréalisatrices telles que les définit le sociologue Robert Merton.
Vous avez repris la citation de Simone de Beauvoir, à propos de la condamnation à mort et de l’exécution en 1945 de Robert Brasillach, où celle-ci mettait en lumière la responsabilité de l’écrivain·e : « l y a des mots aussi meurtriers qu’une chambre à gaz. » Pour vous, la littérature est-elle indissociable d’un système de valeurs? Quels sont les rapports entre littérature et morale? L’écrivain·e peut-il ou doit-il tout dire?
Cette phrase de Simone de Beauvoir m’avait troublée, elle a quelque chose de choquant. D’un côté, je n’ai pas une conception idéaliste ou spiritualiste de l’action et mon livre sur la responsabilité de l’écrivain·e interroge cette croyance dans le pouvoir des mots, que l’on peut faire remonter au moins à la Révolution française, et qu’illustre la chanson de Gavroche dans Les misérables, « C’est la faute à Voltaire », « C’est la faute à Rousseau ». De l’autre, comme je viens de l’expliquer, s’ils ne sont pas une cause en soi, les mots peuvent légitimer les actes, produire ce que Bourdieu appelle une justification lettrée. C’est le rôle de l’idéologie. Mais la littérature, sans relever de l’idéologie en tant que système politique élaboré, véhicule une vision du monde, et aucune vision du monde n’est neutre, elle est toujours porteuse d’un système de valeurs éthico-politiques plus ou moins euphémisé par le travail esthétique de la forme. D’ailleurs cette dimension politique ne se limite pas aux représentations, mais concerne aussi la forme; les choix formels peuvent conduire à déconstruire l’idéologie dominante, comme lorsque Flaubert épouse le point de vue d’une femme adultère dans Madame Bovary par la technique du discours indirect libre et en conservant une posture de narrateur impassible qui ne juge pas son personnage, d’où le scandale suscité par l’œuvre. Le choix de Houellebecq dans Plateforme de faire tenir un discours islamophobe à quatre personnages sans offrir de point de vue contradictoire est aussi un choix éthico-politique.
Les représentations racistes contribuent à véhiculer, banaliser, normaliser, légitimer ces représentations. C’est pourquoi elles sont interdites en France par la loi de 1972, loi contestée aujourd’hui par les idéologues d’extrême droite, comme Éric Zemmour, Renaud Camus ou Richard Millet. Dans la littérature, ces représentations sont tolérées quand elles sont l’expression de points de vue de personnages fictionnels sans être endossées par l’auteur·e, selon le principe de distinction entre représentation et apologie qui a été une des conquêtes des combats pour la liberté d’expression. Du coup, la fiction sert parfois de subterfuge pour faire passer ce type de discours illicite.
Il y a d’autres restrictions à la liberté d’expression qui concernent aussi la littérature, comme la diffamation et, en droit privé, l’atteinte à la vie privée, deux causes fréquentes de poursuites et de condamnations. Par exemple, Mathieu Lindon et son éditeur, P.O.L, ont été poursuivis en diffamation par Jean-Marie Le Pen pour le roman Le procès de Jean-Marie Le Pen et ont été condamnés, y compris par la Cour européenne des droits de l’Homme. Il est intéressant de rappeler que plusieurs magistrat·es de cette dernière ont émis une opinion dissidente en regrettant qu’il n’ait pas été davantage tenu compte de la dimension fictionnelle.
En ces temps de guerre en Ukraine et ailleurs, quelle pourrait être la responsabilité de l’intellectuel·le?
Il y a tout d’abord l’aide matérielle aux réfugié·es et aux populations exposées aux attaques. Cela peut prendre des formes spécifiques pour les producteurs culturels et les universitaires. Ainsi nous avons accueilli nombre de chercheurs, de chercheuses et d’artistes ukrainien·nes dans le cadre du programme PAUSE du Collège de France. Le programme apporte un soutien aux exilé·es de tous les pays et a accueilli aussi des opposant·es russes. La sélection se fait sur examen du dossier scientifique et artistique, et s’appuie donc sur l’expertise bénévole des membres du comité. Ce n’est qu’un exemple. Il y a aussi la défense des libertés universitaires. Une nouvelle association, OALA, vient d’être créée par l’Association française de sociologie et l’Association française de science politique, mais sa capacité d’action hors des frontières nationales n’a rien d’évident, même si elle soutient par exemple la sociologue Pinar Selek, qui est poursuivie par le gouvernement turc. Ces formes d’engagement collectif et de solidarité sont moins visibles que l’engagement traditionnel, mais parfois plus concrètes. Je pense qu’il est important de maintenir le contact, et de donner voix, de relayer les paroles critiques qui peinent à s’exprimer dans leur pays, comme le font certains festivals internationaux de littérature. Il faut créer des espaces pour publier, exposer les œuvres des artistes exilé·es. Et évidemment, il revient aussi aux intellectuel·les d’analyser la situation, et je voudrais citer à ce propos le livre très éclairant et courageux d’Anna Colin Lebedev, Jamais frères? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique, paru au Seuil l’an dernier.
En 2020, vous avez publié Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur?, un essai très pertinent sur le rapport entre morale de l’œuvre et moralité de l’auteur·e. Pour nos lecteurs et lectrices, j’aimerais que vous reveniez sur votre réponse « oui et non ».
De fait, on sépare tout le temps l’œuvre de l’auteur·e, dont on ne connaît pas nécessairement la biographie, et l’œuvre est transmise par le truchement d’intermédiaires qui contribuent à lui donner son sens. En outre, l’œuvre ne peut être réduite à la biographie de son auteur·e : elle est aussi le produit du champ littéraire dans son ensemble, comme l’explique Bourdieu, car aucun·e auteur·e n’écrit ex nihilo. On est imprégné·es de l’histoire culturelle et on reproduit consciemment ou inconsciemment des modèles, des formes symboliques et des représentations collectives.
Cependant, du point de vue sociologique, l’œuvre ne peut être dissociée de son auteur·e, car elle est le fruit d’une trajectoire particulière et de dispositions esthétiques et éthico-politiques qui lui confèrent ses particularités et la singularisent parmi d’autres. Même les œuvres les moins originales sont l’expression de ces dispositions, à moins d’avoir été composées par des auteur·es fantômes. Mais dans ce cas, si elle ou il y a apposé son nom, elle ou il en est tout de même légalement responsable.
Dans votre livre, vous avez abordé la question sous l’angle de la métonymie, de la ressemblance, ainsi que de l’intentionnalité. Pouvez-vous résumer ce schéma?
J’avance que l’identification entre l’auteur·e et son œuvre, qui a atteint son apogée avec le romantisme, passe par ces trois dimensions, mais qu’elle n’est jamais complète.
Le nom d’auteur·e fonctionne comme une métonymie subsumant toutes les œuvres attribuées à l’auteur·e; c’est ce que Foucault appelle la «fonction-auteur». Mais le périmètre de l’œuvre est instable, tout comme son unité. On peut prendre l’exemple de Céline : son œuvre s’est soudain élargie de six mille feuillets découverts récemment, et plusieurs nouveaux livres en ont été tirés, dont Guerre, qui n’est en réalité pas un roman autonome, mais un morceau écarté du Voyage au bout de la nuit. Sur l’unité de l’œuvre, alors que Céline avait publié ses pamphlets antisémites dans les années 1930 en prolongement de ses romans, il a décidé après la guerre de les retirer de la circulation, exerçant son droit de retrait. Les pamphlets font-ils partie de l’œuvre ou non? Et si oui, en quoi consiste son unité? Ce qui nous conduit à la deuxième dimension.
L’identification entre l’auteur·e et l’œuvre est aussi métaphorique : on suppose que son œuvre lui ressemble. Par exemple, lors de la réception critique des Fleurs du mal, on a supposé que les vices décrits étaient ceux de l’auteur. Cette identification tenait au genre de la poésie lyrique. Cependant, la littérature moderne a dissocié l’auteur·e, le narrateur et les personnages – sauf dans les écritures de soi, à savoir le journal intime et le récit autobiographique, qui reposent sur un pacte de lecture. L’identification est souvent associée au style, qui est ce qui fait l’originalité de l’auteur·e et qui est protégé par le droit d’auteur. Mais que faire des auteur·es qui changent de manière, comme Romain Gary, qui a pris le pseudonyme d’Émile Ajar pour changer de style? On peut penser aussi au peintre Emil Nolde, classé par les nazis comme un peintre dégénéré, et qui a changé de manière pour plaire à Hitler – en vain. Ayant été définitivement banni par le régime en 1942, il s’est construit une image de martyr après la guerre, jusqu’à la découverte récente de ses œuvres de la période nazie, où il tentait de faire allégeance au pouvoir en place. Je considère que, plus que le style, qui, certes, est personnel, mais se nourrit de l’histoire des formes et des styles, c’est la vision du monde véhiculée par l’œuvre et ses dimensions éthiques sous-jacentes qui ressemblent le plus à son auteur·e. Il s’agit moins du choix des sujets que de leur traitement. La littérature a le pouvoir de reproduire la vision du monde dominante, mais aussi celui de la subvertir, et c’est dans cette reproduction ou dans ces écarts que l’on peut appréhender le système de valeurs véhiculé par l’œuvre.
Enfin, la troisième dimension concerne la relation d’intentionnalité supposée entre l’auteur·e et l’œuvre, et donc de causalité entre les deux. Mais, là encore, il peut y avoir un décalage entre les intentions affichées et la réception de l’œuvre, comme j’en donne des exemples.
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, vous avez réfléchi sur les «auteurs scandaleux» impliqués dans les actes de pédocriminalité, ou qui font l’éloge d’atrocités, des idéologies racistes, antisémites, islamophobes, sexistes, capables de provoquer la haine ou la violence. Comment comprenez-vous le choix de certaines institutions qui honorent un auteur inculpé ou accusé de toutes sortes d’abus? Ne s’inscrivent-elles pas dans une dynamique de consolidation d’un système d’acceptation sociale d’injustice?
Certes, je dis en conclusion qu’il y a une responsabilité des intermédiaires. Ce problème se pose en amont, dans le cadre du processus de sélection des œuvres, et en aval, dans leur diffusion. Fayard avait décidé d’interrompre la diffusion du journal de Renaud Camus, qui comportait des propos antisémites. Gallimard a retiré les livres de Matzneff de la vente après la parution du témoignage d’une de ses victimes, Vanessa Springora. Mais le problème n’est pas toujours simple. Par exemple, à Montreuil, une œuvre de l’artiste Claude Lévêque, accusé de pédocriminalité, avait été éteinte puis a été rallumée à la demande des habitant·es du quartier du Bel Air qui considéraient qu’elle faisait partie de leur environnement.
Pour les auteur·es du passé, ils et elles n’auraient sans doute pas une place si importante dans notre patrimoine intellectuel sans ces intermédiaires : ce n’est souvent pas par connivence idéologique d’ailleurs, mais par intérêt économique qu’on réédite certains des écrits de ces auteur·es. Je plaide dans mon livre contre l’effacement de ces auteur·es, car cela contribuerait à effacer la violence symbolique qu’ils et elles ont pu véhiculer, et je pense que le travail d’anamnèse de cette violence symbolique est plus urgent, sans bien sûr réduire les œuvres à cette dimension. En même temps, leur place dans le canon devrait être réévaluée pour permettre de faire émerger des auteur·es et artistes femmes ou issu·es des minorités ethniques, qui ont été marginalisé·es dans cette histoire pour des raisons qui n’avaient rien d’esthétique ou d’intellectuel, mais qui relevaient de préjugés et de biais cognitifs.
- Propos recueillis par Ricarson Dorcé
Université Laval
Ricarson Dorcé est doctorant en ethnologie et patrimoine à l’Université Laval. Ses recherches actuelles portent sur la participation communautaire, le tourisme communautaire et le patrimoine culturel immatériel.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre