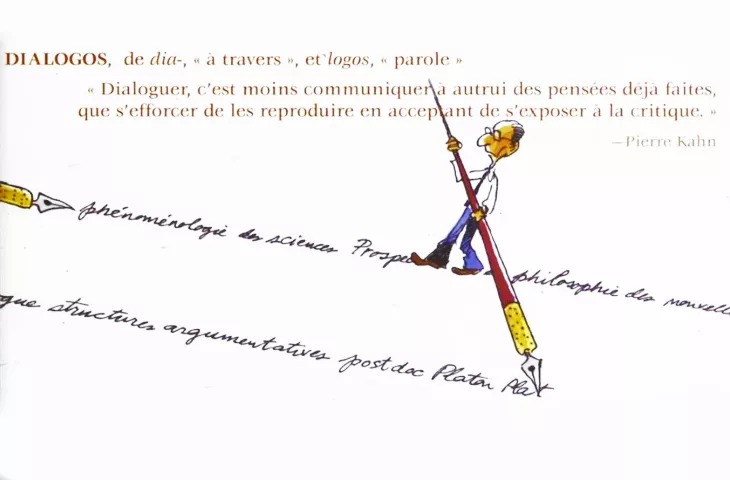"C’est le langage qui doit s’adapter aux faits et non l’inverse. Tenter d’accommoder l’interprétation d’un phénomène avec un langage déjà formé et rempli d’a priori ne peut mener qu’à des conclusions fausses sur la nature des choses", Ludwig Wittgenstein.
Le prestige de la science a longtemps tenu au fait qu’on lui conférait le pouvoir symbolique de proposer un point de vue surplombant sur le monde : assise sur un refuge neutre et haut-placé, sûre d’elle-même, elle semblait se déployer à la fois au cœur du réel, tout près de la vérité et hors de l’humain. Cette image est aujourd’hui dépassée. Nous avons compris que la science n’est pas un nuage lévitant calmement au-dessus de nos têtes : elle pleut littéralement sur nous. Ses mille et une retombées pratiques, qui vont de l’informatique à la bombe atomique en passant par les vaccins, les OGM et les lasers, sont diversement connotées et diversement appréciées : ici, ce que la science permet de faire rassure; là, ce qu’elle annonce angoisse. Tout se passe comme si ses discours, ses réalisations et ses avancées devaient constamment être interrogées, systématiquement mis en ballotage.
Certes, cette situation n’est pas vraiment nouvelle ni spécialement « postmoderne » : à bien regarder en arrière, on constate que chaque fois que la science nous a permis d’agir librement sur des aspects de la réalité qui s’imposaient jusqu’alors à nous comme un destin, l’angoisse de commettre un sacrilège et la peur de sortir des contours de notre nature se sont exprimées de manière spectaculaire : ainsi quand Galilée ouvrait à l’intelligibilité d’un univers où les mêmes lois valaient sur la terre comme au ciel; ou quand Darwin inscrivit l’homme dans la chaîne de l’évolution des espèces; a fortiori quand, aujourd’hui, le génie génétique, la procréation médicalement assistée, les nanotechnologies ou la biologie synthétique nous permettent d’obtenir de la vie biologique des effets dont elle paraissait incapable.
La puissance de dévoilement de la science et l’impact des techno-sciences sur les modes de vie provoquent désormais des réactions de résistance qui semblent de plus en plus fortes.
Reste que la puissance de dévoilement de la science et l’impact des technosciences sur les modes de vie provoquent désormais des réactions de résistance qui semblent de plus en plus fortes, qu’elles soient d’ordre culturel, social, idéologique : ces réactions peuvent être le désir de réaffirmer son autonomie face à un processus qui semble nous échapper; ou bien l’envie de défendre des idéaux alternatifs contre la menace d’un modèle unique de compréhension ou de développement; ou bien encore la volonté de rendre sa pertinence au débat démocratique quand la complexité des problèmes tend à le confisquer au profit des seuls experts.
Science et société : un rapport ambivalent
Notre rapport à la science est à l’évidence devenu ambivalent. Cela peut se voir sous forme condensée en mettant l’une en face de l’autre les deux réalités suivantes : d’une part, la science nous semble constituer, en tant qu’idéalité (c’est-à-dire en tant que démarche de connaissance d’un type très particulier qui permet d’accéder à des connaissances qu’aucune autre démarche ne peut produire), le fondement officiel de notre société, censé remplacer l’ancien socle religieux : nous ne sommes certes pas gouvernés par la science elle-même, mais au nom de quelque chose qui a à voir avec elle. C’est ainsi que dans toutes les sphères de notre vie, nous nous trouvons désormais soumis à une multitude d’évaluations, lesquelles ne sont pas prononcées par des prédicateurs religieux ou des idéologues illuminés : elles se présentent désormais comme de simples jugements d’« experts », c’est-à-dire sont censées être effectuées au nom de savoirs et de compétences de type scientifique, et donc, à ce titre, impartiaux et objectifs. Par exemple, sur nos paquets de cigarettes, il n’est pas écrit que fumer déplaît à Dieu ou compromet le salut de notre âme, mais que « fumer tue ». Un discours scientifique, portant sur la santé du corps, a pris la place d’un discours théologique qui, en l’occurrence, aurait plutôt porté sur le salut de l’âme.
Mais d’autre part - et c’est ce qui fait toute l’ambiguïté de l’affaire -, la science, dans sa réalité pratique, est questionnée comme jamais, contestée, remise en cause, voire marginalisée. Elle est à la fois objet de désaffection de la part des étudiants (les jeunes, dans presque tous les pays développés, se destinent de moins en moins aux études scientifiques), de méconnaissance effective dans la société (nous devons bien reconnaître que collectivement, nous ne savons pas trop bien ce qu’est la radioactivité, en quoi consiste un OGM, ce que sont et où se trouvent les quarks, ce qu’implique la théorie de la relativité et ce que dirait l’équation E = mc2 si elle pouvait parler), et, enfin et surtout, elle subit toutes sortes d’attaques, d’ordre philosophique ou politique.
La plus importante de ces attaques me semble être le « relativisme radical » : cette école philosophique ou sociologique défend l’idée que la science a pris le pouvoir non parce qu’elle aurait un lien privilégié avec le « vrai », mais en usant et abusant d’arguments d’autorité. En somme, il ne faudrait pas croire à la science plus qu’à n’importe quelle autre démarche de connaissance.
« Monsieur, personnellement, je ne suis pas d’accord avec Einstein… »
Une anecdote m’a permis de prendre conscience de cette évolution. Récemment, j’ai eu l’occasion de donner un cours de relativité (et non de relativisme…) à de futurs ingénieurs. Alors que je venais d’effectuer un calcul montrant que la durée d’un phénomène dépend de la vitesse de l’observateur, un étudiant prit la parole : « Monsieur, personnellement, je ne suis pas d’accord avec Einstein ! » J’imaginai qu’il allait défendre une théorie alternative, ou bien réinventer l’éther luminifère, en tout cas qu’il allait argumenter. Mais il se contenta de dire : « Je ne crois pas à cette relativité des durées que vous venez de démontrer, parce que je ne la… sens pas ! » Là, j’avoue, j’ai éprouvé une sorte de choc : ce jeune homme qui n’avait certainement pas lu Einstein avait suffisamment confiance dans son « ressenti » personnel pour s’autoriser à contester un résultat qu’un siècle d’expériences innombrables avait cautionné. Je découvris à cette occasion que lorsqu’elle se transforme en alliée objective du narcissisme, la subjectivité semble avoir du mal à s’incliner devant ce qui a été objectivé si ce qui a été objectivé la dérange ou lui déplaît.
On ne saurait donner à cette anecdote une portée générale, mais elle me semble tout de même indicatrice d’un changement de climat culturel (qui explique au passage la facilité déconcertante avec laquelle a pu se développer en France la vraie-fausse controverse sur le changement climatique). Aujourd’hui, notre société semble en effet parcourue par deux courants de pensée qui semblent contradictoires.
D’une part, on y trouve un attachement intense à la véracité, un souci de ne pas se laisser tromper, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière, bref une attitude de défiance généralisée.
Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d’être dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l’égard de la vérité elle-même : la vérité existe-t-elle, se demande-t-on? Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle? Ce qui est troublant, c’est que ces deux attitudes, l’attachement à la véracité et la suspicion à l’égard de la vérité, qui devraient s’exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher au sein de la société un processus critique qui vient ensuite fragiliser l’assurance qu’il y aurait des vérités sûres.
Le fait que l’exigence de véracité et le déni de vérité aillent de pair ne veut toutefois pas dire que ces deux attitudes fassent bon ménage. Car si vous ne croyez pas à l’existence de la vérité, quelle cause votre désir de véracité servira-t-il? Ou – pour le dire autrement – en recherchant la véracité, à quelle vérité êtes-vous censé être fidèle? Il ne s’agit pas là d’une difficulté seulement abstraite ni simplement d’un paradoxe : cette situation entraîne des conséquences concrètes dans la cité réelle et vient nous avertir qu’il y a un risque que certaines de nos activités intellectuelles en viennent à se désintégrer.
Grâce à la sympathie intellectuelle quasi spontanée dont elles bénéficient, les doctrines relativistes contribuent à une forme d’illettrisme scientifique d’autant plus pernicieuse que celle-ci avance inconsciente d’elle-même.
Grâce à la sympathie intellectuelle quasi spontanée dont elles bénéficient, les doctrines relativistes contribuent à une forme d’illettrisme scientifique d’autant plus pernicieuse que celle-ci avance inconsciente d’elle-même. Au demeurant, pourquoi ces doctrines séduisent-elles tant? Sans doute parce que, interprétées comme une remise en cause des prétentions de la science, un antidote à l’arrogance des scientifiques, elles semblent nourrir un soupçon qui se généralise, celui de l’imposture : « Finalement, (en science comme ailleurs) tout est relatif. ». Ce soupçon légitime une forme de désinvolture intellectuelle, de paresse systématique, et procure même une sorte de soulagement : dès lors que la science produit des discours qui n’auraient pas plus de véracité que les autres, pourquoi faudrait-il s’échiner à vouloir les comprendre, à se les approprier? Il fait beau : n’a-t-on pas mieux à faire qu’apprendre sérieusement la physique, la biologie ou les statistiques?
En 1905, Henri Poincaré publiait un livre intitulé La valeur de la science. Un siècle plus tard, cette valeur de la science semble de plus en plus contestée, non pas seulement par les philosophes d’inspiration subjectiviste ou spiritualiste, toujours prompts à exploiter ce qui ressemble de près ou de loin à une « crise » de la science, mais aussi par une partie de l’opinion. Dans cette méfiance à l’égard du mode de pensée scientifique, peut-être faut-il lire une sorte de pusillanimité à l’égard de la vérité et de ses conséquences. On se souvient de ce que Musil disait d’Ulrich, le personnage principal de L’homme sans qualité, dont on devine qu’il aurait sans doute jeté un regard sévère sur nos façons de penser : « Pendant des années, Ulrich avait aimé la privation spirituelle. Il haïssait les hommes incapables, selon le mot de Nietzsche, "de souffrir la faim de l’âme par amour de la vérité"; ceux qui ne vont pas jusqu’au bout, les timides, les douillets, ceux qui consolent leur âme avec des radotages sur l’âme et la nourrissent, sous prétexte que l’intelligence lui donne des pierres au lieu de lui donner du pain, de sentiments qui ressemblent à des petits pains trempés dans du lait. »
Le difficile bilan de la diffusion de la culture scientifique et technique
Est-il pertinent de parler d’un « illettrisme scientifique » qui gagnerait nos sociétés? Certains signes pourraient porter à le penser, mais nul d’entre eux ne vaut démonstration.
L’un de ces signes tient au fait que tous ceux qui, comme moi, écrivent des livres de physique destinés à un « public large » savent d’expérience que les éditeurs se montrent de plus en plus insistants sur un point : le niveau de ce que l’on écrit ne doit être trop élevé et le moins de choses possibles doivent être supposées connues du lecteur. Mais cette demande, qui est nette, relève d’une motivation qui, elle, est sans doute ambigüe : faut-il la mettre sur le compte d’un louable souci démocratique, celui de toucher le plus grand nombre de personnes, ou avère-t-elle plutôt qu’il existerait effectivement une croissance de l’illettrisme scientifique? Il est difficile de le dire.
Mais l’invocation d’un tel argument est-elle suffisante pour expliquer d’où vient que le bilan de la diffusion de la culture scientifique et technique au sein de la société demeure mitigé, malgré de très nombreuses initiatives prises ces dernières années dans ce domaine, notamment par les scientifiques eux-mêmes? Certainement pas. Reste que certains parlent d’un « échec relatif » de la vulgarisation. Par exemple, plus d’un siècle après sa découverte, la très grande majorité de nos concitoyens continuent d’ignorer ce qu’est la radioactivité, alors même que de grands efforts ont été déployés pour expliquer en quoi elle consiste à l’occasion du premier centenaire de sa découverte (en 1896) par Henri Becquerel et Marie Curie.
Il nous faut donc bien admettre que nous ne vivons pas vraiment dans une « société de la connaissance », comme on se plaît à le répéter, mais plutôt dans une société de l’usage de technologies : nous utilisons avec aisance les appareils issus des nouvelles technologies mais sans presque rien savoir des principes scientifiques dont elles découlent. Un enfant de cinq ans les manipule d’ailleurs aussi aisément qu’un ingénieur. Par leur facilité d’usage, les nouvelles technologies sont devenues les produits à la fois dérivés et masquants de la science. On peut même se demander si ce ne serait pas notre besoin compulsif de produits innovants qui viendrait sournoisement ronger notre appétit de savoir, par un effet quasi-mécanique : plutôt que de prêter attention aux savoirs fondamentaux et aux percées décisives de la recherche, nous préférerions consommer leurs innombrables retombées prosaïques.
Il nous faut donc bien admettre que nous ne vivons pas vraiment dans une "société de la connaissance", comme on se plaît à le répéter, mais plutôt dans une société de l’usage de technologies.
Quoi qu’il en soit, cette évolution n’est pas sans incidence politique. Il est en effet difficile de nier qu’une certaine inculture scientifique est devenue intellectuellement et socialement dangereuse : elle empêche de fonder une épistémologie rigoureuse de la science contemporaine, favorise l'emprise des gourous de toutes sortes et rend délicate l'organisation de débats sérieux sur l'usage que nous voulons faire des technologies. Gaston Bachelard aimait à dire que « la culture scientifique nous demande de vivre un effort de la pensée ». Sans doute est-ce cet effort là que nous ne pratiquons pas assez. On ne saurait toutefois se montrer aussi sévère qu’Einstein lorsqu’il disait : « Ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie, en ne les comprenant pas plus qu’une vache ne comprend la botanique des plantes qu’elle broute avec plaisir, devraient avoir honte ». Car il y a comme un « durcissement sportif » de la culture scientifique : il est devenu difficile de se faire une bonne culture à la fois sur la physique des particules, les mini-trous noirs, les OGM, la génétique, le nucléaire, le changement climatique ou la virologie, de sorte que si l’on voulait que les citoyens participent aux affaires publiques en étant vraiment éclairés sur tous les sujets concernés, il faudrait que chacun ait le cerveau de mille Einstein… Inutile de rappeler que cette faiblesse de notre équipement intellectuel vaut pour tout le monde : philosophes, femmes et hommes politiques, journalistes et experts compris.
Reste que la soi-disant opposition entre culture et technique mériterait sans doute d’être davantage inquiétée. Il est devenu urgent de réinventer une « culture technique et scientifique » qui permette aux citoyens de s’orienter face aux défis du développement technologique qui sont à l’horizon de notre temps. Nul doute en effet qu’une intelligence de « première main », même limitée, même drastiquement incomplète, changerait considérablement la donne en la matière.
Se pose toutefois la question de savoir quelle portion de la science peut – ou doit - être transformée en véritable « bien public ». Tout est-il transmissible, ou y a-t-il des limites à ce que la science puisse être l'affaire de tous? Ces questions peuvent choquer, car elles secouent la croyance commune en la transparence de la communication : l’un des axiomes implicites de la démocratie est que plus le débat est public, et plus on a de garanties que le partage a bien lieu (qu'il s'agisse de partage du pouvoir, du savoir, de l'information, des responsabilités). Mais est-ce bien ainsi que les choses se passent? La circulation des savoirs au sein du corps social semble être devenue plus compliquée que ce que l'on entend habituellement par « vulgarisation » : l'explication pédagogique des résultats n'épuise pas l'ensemble des situations où les savoirs, le rôle des spécialistes, le statut d'expert sont tour à tour sollicités, controversés ou plébiscités de façon ambiguë. Le lien science-société n’est plus une droite descendante : il emprunte désormais de multiples circuits qui compliquent, détournent, transforment le flux unidirectionnel d’antan.
"La culture scientifique nous demande de vivre un effort de la pensée", Gaston Bachelard
Pensez maintenant aux grands débats qui agitent nos sociétés : nucléaire, OGM, nanotechnologies. Dès qu’il s’agit de sciences et de technologies, la cacophonie règne. Toutes sortes d’arguments s’entremêlent qui puisent parfois dans des sources de savoir alternatives, de sorte que la diffusion des connaissances scientifiques au sein de la société est devenue une tâche extraordinairement difficile. Les messages que l’on transmet ne sont pas des sortes de cours que l’on donnerait dans une salle de classe où il y aurait les bons élèves et les cancres : ce sont plutôt des armes distribuées sur une sorte de champ de bataille.
Retour à Galilée
Si la physique est si difficile à traduire avec des mots, c’est parce qu’il y a une rupture entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. Cela date de la révolution galiléenne. Je sais bien qu’il y a des désaccords sur le sens véritable de cette révolution, qui brouillent le regard rétrospectif que l’on peut porter sur elle. Certains ont tendance à voir dans l’abandon de certaines questions spéculatives qu’elle recommande et dans la mathématisation de la description des phénomènes qu’elle propose l’acte « positif » par excellence qui a conduit l’humanité du sommeil métaphysique vers la froide observation des faits et donné naissance à la science moderne. Pour eux, la révolution galiléenne constitue avant tout un acte initial de renonciation et d’humilité, qui a ouvert finalement des perspectives immenses. D’autres y voient au contraire un pari audacieux et ambitieux, une sorte d’acte de foi dans la possibilité d’expliquer réellement les phénomènes en profondeur, au lieu de se contenter de les décrire de façon aussi satisfaisante que possible. D’autres encore, tel Ernst Mach, considèrent que la révolution effectuée par Galilée avait consisté à tourner les yeux vers la nature « pour lasser modeler ses pensées par elle, au lieu de vouloir l’immobiliser dans les liens de ses préjugés . » Dans un passage célèbre, Kant reconnaissait au contraire à des hommes comme Galilée et Torricelli le mérite d’avoir fait comprendre au monde scientifique que « la raison ne voit que ce qu’elle produit elle-même d’après ses propres plans et qu’elle doit prendre les devant avec les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois immuables, qu’elle doit obliger la nature à répondre à ses questions et ne pas se laisser conduire pour ainsi dire en laisse par elle . » Alexandre Koyré disait quant à lui que la révolution galiléenne a d’abord été une réaction contre l’empirisme aristotélicien qui, en n’admettant aucune forme d’idéalisation, rendait impossible une physique mathématisée.
Si la physique est si difficile à traduire avec des mots, c’est parce qu’il y a une rupture entre la connaissance commune et la connaissance scientifique.
Quoi qu’il en soit, un fait demeure certain, que les écoliers pressentent, que les collégiens disent et que les anciens collégiens le répètent : la physique n’est pas une discipline facile d’accès… Nos intellects pétris de préjugés ont donc tendance à lui faire barrage. D’où cela vient-il? De ce que, depuis quatre siècles, cette science ne cesse de s’opposer à l’intuition, de ridiculiser les simili-vérités qui s’imposent spontanément à notre esprit. C’est son côté dérangeant.
C’est Alexandre Koyré, que nous venons d’évoquer, qui, à mon avis, a le mieux perçu le nœud de l’affaire : il expliquait que le pari de la physique moderne, à rebours de celle d’Aristote, consiste à vouloir « expliquer le réel par l’impossible ». Il prenait l’exemple du principe d’inertie qui, pour comprendre l’amortissement du mouvement des corps que nous observons dans le monde empirique, nous prie d’envisager l’idéal d’un mouvement qui ne s’amortit pas, le moment « inertiel », que personne n’observe jamais et qui semble de ce fait impossible. Il écrit précisément ceci : « Il n’est pas étonnant que l’aristotélicien se soit senti étonné et égaré par ce stupéfiant effort pour expliquer le réel par l’impossible – ou ce qui revient au même pour expliquer l’être réel par l’être mathématique. Le concept galiléen du mouvement (de même que celui de l’espace) nous paraît tellement naturel que nous croyons même que la loi d’inertie dérive de l’expérience et de l’observation, bien que, de toute évidence, personne n’a jamais pu observer un mouvement d’inertie pour cette simple raison qu’un tel mouvement est entièrement et absolument impossible. […] Nous ne sommes plus conscients du caractère paradoxal de sa décision de traiter la mécanique comme une branche des mathématiques, c’est-à-dire de substituer au monde réel de l’expérience quotidienne un monde géométrique hypostasié et d’expliquer le réel par l’impossible » Les véritables lois physiques contredisent en effet l’observation aussi bien que l’intuition, de sorte qu’elles semblent souvent absurdes au premier abord. Pour les saisir, il ne faut donc pas se fier à l’observation directe, en tout cas pas seulement à elle, mais mettre sur pied une méthode permettant de les découvrir, inventer un moyen de trouer l’écran du sensible pour faire apparaître le plan intelligible qu’il recouvre.
Au fin fond de la physique, on trouve donc l’idée, sans doute assez platonicienne, qu’il existe deux mondes distincts : un premier monde fait de concepts, de lois mathématiques, dont l’agencement permet de comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent dans le second monde, qui est le monde empirique. Parce qu’elles semblent dire le contraire de ce que nous observons, les lois physiques obligent à réinterroger l’observation, à réinterpréter les faits. Prenez la chute des corps : chacun voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. En disant cela, n’énonce-t-on pas une loi aussi exacte que définitive, qu’Aristote avait d’ailleurs amplement théorisée il y a plus de deux millénaires? Et pourtant, en 1604, un certain Galilée est venu expliquer qu’en dépit des apparences, à rebours des observations, tous les corps tombent en réalité de la même façon, avec rigoureusement la même vitesse, quelles que soient leur masse.
Comment comprendre que le Pisan ait pu avoir raison contre l’évidence empirique? En modifiant radicalement notre regard sur les choses. La gravité fait effectivement chuter tous les corps de la même façon. Mais à cette force s’ajoutent des effets liés à la résistance de l’air qui, elle, n’agit pas de la même manière sur les corps lourds que sur les corps légers. C’est pourquoi nous ne voyons pas les boules de pétanque tomber comme les balles de tennis. L’observation seule – même la plus scrupuleuse – de corps en train de choir ne nous permet pas de percevoir l’énoncé de la véritable loi de la chute des corps, qui demeure tapie derrière les phénomènes communément observables. D’où le caractère déroutant de la physique, qui nous obligé à réinterroger l’évidence. C’est peut-être ce qui la rend si difficile à transmettre.
Ne pas cesser de traduire l’intraduisible
Les physiciens se posent en somme deux questions fondamentales. La première, qui occupe la plupart d’entre eux, concerne le lien qui existe (ou qui n’existe pas) entre les théories physiques et la réalité : les théories rencontrent-elles la réalité ou divaguent-elles à son sujet? La seconde question concerne le lien entre les théories physiques et le langage ordinaire : comment bien dire avec des mots ce que nous comprenons grâce à des équations?
La physique théorique, toute bardée d’équations absconses, c’est bel et bien du chinois. Prenez un livre de physique, écoutez la conférence d’un physicien lors d’un colloque, vous n’y comprendrez rien. Face à ce constat, il y a deux façons de réagir.
Rien de plus vrai : la physique théorique, toute bardée d’équations absconses, c’est bel et bien du chinois. Prenez un livre de physique, écoutez la conférence d’un physicien lors d’un colloque, vous n’y comprendrez rien.
La première rejoint la fameuse citation de Lacan : « Tout le monde n’a pas le bonheur de parler chinois dans sa langue ». Elle consiste à penser que la physique n’est compréhensible que par ceux qui la comprennent déjà, à la considérer comme une sorte de corpus intraduisible, car d’essence trop singulière. Mais à la phrase de Lacan, on peut préférer celle de Richard Feynman : « Ce qu’un fou a pu comprendre, tous les fous peuvent le comprendre ». En d’autres termes, la physique est par définition partageable, mais ce partage exige un effort d’un type très particulier.
La physique a en effet son langage à elle : les mathématiques, comme on le sait depuis Galilée. Avec une efficacité stupéfiante, les mathématiques sont capables de condenser en une simple équation beaucoup de phénomènes physiques différents. L’algèbre abrège. Les mathématiques en physique sont même devenues une sorte de « treuil ontologique ». Pensez aux nouveaux objets physiques qu’on a été capable de prédire au XXème siècle par des arguments mathématiques : le photon, l’antimatière, les neutrinos, les quarks, les bosons intermédiaires, bientôt le boson de Higgs qu’on va peut-être voir au LHC , etc. Eugène Wigner parlait à ce propos de miracle : l’efficacité des mathématiques en physique relève d’un miracle, et ce miracle permet un dévoilement de la nature aussi impressionnant qu’émouvant.
Mais ce dévoilement est aussi obscurcissement. Car la nature que la physique nous dévoile est dite dans un langage parfaitement incompréhensible pour les non-mathématiciens. Mise en phrases, n’importe quelle équation perd toute concision et l’essentiel de sa puissance, sans rien gagner en intelligibilité pour le profane. Laplace en donne de plaisantes illustrations dans son Essai philosophique sur la théorie des probabilités, où l’on rencontre des paraphrases de cet acabit : « La probabilité des erreurs que chaque élément laisse encore à craindre est proportionnelle au nombre dont le logarithme hyperbolique est l’unité, élevé à une puissance au carré de l’erreur, pris en moins, et multiplié par un coefficient constant qui peut être considéré comme le module de la probabilité des erreurs. » Encore s’agit-il là de notions simples : on imagine ce que peut donner la transcription d’équations de la théorie quantique des champs ou de la Relativité générale…
Pour rendre la science accessible aux non-scientifiques, pour la traduire en mots compréhensibles, il faut effectuer un saut. Le saut dont il s’agit ne peut être un simple déplacement : ce doit être une transformation.
Pour rendre la science accessible aux non-scientifiques, pour la traduire en mots compréhensibles, il faut donc effectuer un saut. Rien à voir avec le saut à la perche où le sauteur, sauf accident, est le même à l’arrivée qu’avant. Le saut dont il s’agit ne peut être un simple déplacement : ce doit être une transformation. Il ne s’agit pas de transporter la physique telle qu’elle est dans le langage tel qu’il est, de dire ses équations avec des mots ordinaires, mais de la transposer, de la donner à voir et à sentir. Par manque de compétence, je ne saurais ici engager quelque variation nouvelle sur le thème rebattu de « l’incommunicabilité » entre les langues, ou entre les sciences - en l’occurrence la physique moderne - et les langues vernaculaires, mais la question de la traduction m’a suffisamment intéressé pour que je devienne conscient qu’elle « n’est nullement ce petit événement inoffensif pour lequel on le prend encore de nos jours » , pour reprendre les mots de Heidegger. La traduction, de quelque type qu’elle soit, est à l’évidence une authentique activité intellectuelle. Je crois même qu’on pourrait aller jusqu’à dire qu’elle est l’activité la plus proche de la pensée. S’agissant de la physique - je veux parler de la « traduction littéraire » de la physique, c’est-à-dire de sa vulgarisation, de sa mise en phrases dépourvues d’équations mais si possible justes et élégantes -, cette dernière a un objectif dont l’ambition peut sembler démesurée : concevoir et élaborer rien de moins qu’une sorte de « sel » qui soit capable de rendre aux idées et aux concepts de la physique leur saveur propre, au prix d’un déplacement et à l’issue d’une analyse critique de ces concepts et de ces idées. En d’autres termes, elle consiste à tenter de dire ce que diraient les équations de la physique si celles-ci pouvaient parler.
Pour les puristes, une telle entreprise est par définition vouée à l’échec, et même dangereuse. La science ne s’écrit ni ne se dit : on ne peut que l’étudier et l’apprendre. Pour eux, le passage à la langue commune est une concession dangereuse à un désir de communication, voire une trahison pure et simple.
Pour ma part, je considère que les physiciens doivent plutôt réapprendre à verbaliser – à baliser par le verbe – l’apparente étrangeté de la science vis-à-vis du langage ordinaire. Penser, c’est être en lutte avec la langue, disait Wittgenstein. Ce travail de mise en mots est plus que jamais indispensable, car c’est précisément dans l’espace qui sépare le calcul du langage que trouve à se déployer la pensée scientifique. Il donne lieu à une activité d’analyse, de clarification et de reconstruction logique, mais ce travail ne conduit pas à un discours scientifique de niveau supérieur, qui constituerait une sorte de science de la science : traduire la science en mots, ce n’est pas rêver d’une métalangue qui intégrerait ou réconcilierait science et langage ordinaire; c’est plutôt déployer un seuil qui permette de faire entrer la première dans la seconde, au prix d’un aménagement scrupuleux.
- Étienne Klein
Commissariat à l’énergie atomique, France
Né en 1958, Etienne Klein est physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en philosophie des sciences. Il a travaillé à divers grand projets de physique, notamment à la conception du LHC. Il dirige le Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA (LARSIM). Il est professeur de physique et de philosophie des sciences à l’Ecole Centrale de Paris. Et il a écrit plusieurs ouvrages de réflexion sur la physique, notamment sur la question du temps. Il vient de publier Discours sur l’origine de l’univers, Flammarion, 2012, et Anagrammes renversantes (avec Jacques Perry-Salkow), Flammarion, 2011.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre