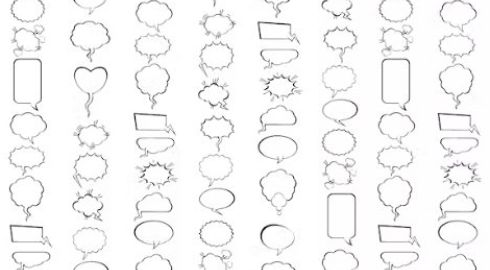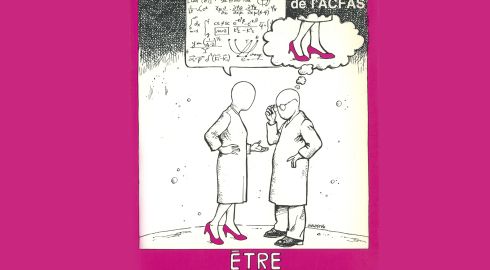"Homo journalisticus" est avant tout un animal politique qui, à ce titre, a pour réflexe premier d’interviewer des politiciens et des activistes. Et dont le réflexe second est d’éviter les sources qui risquent de détruire une bonne histoire…
[NDLR : Jean-François Cliche est rédacteur invité du Spécial congrès 2015 de Découvrir, dirigeant une compagnie de six journalistes-étudiants. Le caricaturiste André-Philippe Côté du quoditen Le Soleil illustre ici son éditorial.]
Dans un monde où la science n’a jamais été aussi présente, percolant par d’innombrables chemins jusque dans nos assiettes, nos train-train quotidiens et même nos rapports intimes, dans un monde où « l’appel à l’expert occupe une place croissante », comme l’écrivaient avec raison les philosophes Frédéric Bouchard et François Claveau dans le dernier numéro de Découvrir, dans un tel monde, donc, on se dit a priori que les journalistes doivent constamment être en train de courir après les scientifiques pour les interviewer, obtenir leur aide afin d’y voir plus clair et de bien informer le public. Surtout lorsque le sujet de l’heure possède un bon fond technique, ce qui arrive de plus en plus fréquemment.
Eh bien non : comme tant d’autres idées qui semblent parfaitement logiques à vue de nez, celle-là est fausse. Archifausse, même. Car quiconque s’inspirerait de Diane Fossey et observerait, « dans son environnement naturel », le comportement de ce drôle de singe qu’est Homo journalisticus devrait rapidement réaliser qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un animal politique qui, à ce titre, a pour réflexe premier d’interviewer des politiciens et des activistes. Et dont le réflexe second est d’éviter les sources qui risquent de détruire une bonne histoire…

Tenez, en 2010, l’entreprise Bruce Power, qui exploite des centrales nucléaires en Ontario, voulait expédier 16 gros générateurs de vapeur en Suède afin d’en extraire le petit peu de radioactivité qu’ils contenaient et d’en recycler les métaux. Il était physiquement impossible que l’opération tourne au drame. La radioactivité est facile à détecter et l’on connaissait précisément sa quantité et sa nature dans les générateurs. Même en imaginant un scénario du pire tellement tiré par les cheveux qu’il en devenait farfelu, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) n’arrivait pas à manufacturer une catastrophe potentielle. Ainsi, en supposant que l’ensemble de la cargaison coule, que tout son contenu radioactif soit relâché dans l’eau d’un seul coup — ce qui était impossible parce que les isotopes étaient insolubles, ou pris dans la rouille, etc. —, que cela survienne à seulement 1 mètre d’une prise d’eau potable, que les autorités ne fassent rien pendant une année complète et que la population desservie par l’aqueduc contaminé boive deux litres d’eau par jour comme si de rien n’était, la CCSN estimait à environ 40 milliSieverts (mS, une unité d’exposition aux radiations) la dose de radioactivité reçue au bout de 12 mois.
C’était, certes, plus que la limite permise pour le grand public, seuil placé arbitrairement bas à 1 mS. Mais ces 40 milliSieverts demeuraient quand même sous les normes d’exposition pour les travailleurs du nucléaire (50 mS/an ou 100 mS sur 5 ans) et en deçà du seuil à partir duquel les effets épidémiologiques d’un accident deviennent statistiquement observables (autour de 100 mS/an). Et encore, soulignons de nouveau qu’il fallait, pour en arriver là, étirer la notion de scénario du pire jusqu’aux limites de l’absurde.
Mais les médias du Québec n’en ont rien dit, réservant plutôt à cette affaire une couverture très alarmiste — en grande partie, je pense, parce que qu’ils ont tous méticuleusement évité de citer des gens qui savaient de quoi ils parlaient. D’après le site d’archives médiatiques eureka.cc, le sujet a généré 189 articles et topos, du début de 2010 à la fin de 2012. Du nombre, j’ai compté que les politiciens étaient, et de loin, le type de source le plus fréquemment cité, avec 176 mentions. Dans une majorité de cas, il s’agissait d’élus locaux ou provinciaux, souvent des maires de petites localités riveraines qui n’avaient aucune formation pertinente ni d’expertise appropriée dans leurs fonctions publiques, mais qui accréditaient quand même explicitement ou implicitement les inquiétudes des groupes antinucléaires. Suivaient, pratiquement ex-æquo, la CCSN avec 53 mentions et des militants écologistes, avec 52 mentions. Notons toutefois que ces derniers ont accusé la CCSN, en substance, de manger dans la main de l’industrie — allégations qui furent largement reprises dans les médias et discréditaient son expertise.
Logiquement, dans une situation où l’arbitre (ici, la CCSN) est accusé de partialité par une des parties prenantes, tout journaliste devrait en principe chercher un scientifique indépendant pour l’aider à trancher. Mais voilà, en près de 200 topos sur l’« affaire Bruce Power », le nombre total d’experts ne travaillant ni pour le fédéral ni pour l’industrie cités par la presse québécoise (j’exclus mes propres textes) s’est élevé à… un seul. Il s’agissait d’Émilien Pelletier, professeur d’écotoxicologie à l’UQAR, qui disait qu’il n’y avait vraiment « pas de quoi s’alarmer ».
Peu importe le mal que l’on peut penser de l’industrie nucléaire, il n’y a aucun moyen de considérer ce genre de couverture comme de l’information. Quand l’écrasante majorité des sources citées n’a aucune idée de quoi il retourne, ce sont plutôt les notions de déformation et de fausseté qui correspondent le mieux à la réalité. Et le même réflexe d’évitement des experts et des scientifiques s’observent malheureusement dans tant et tant d’autres dossiers, surtout lorsque ladite expertise contredit une trame narrative «vendeuse» — gaz de schiste, pipelines, etc.
C’est pour cette raison que, plus que jamais, l’on a besoin de journalistes scientifiques. Dans bien des cas, par leur proximité d’esprit avec la science, ils saisissent mieux l’importance de trouver de vraies expertises, comprennent et rendent mieux le jargon des articles scientifiques et, par les relations qu’ils tissent avec les milieux de la recherche, peuvent obtenir des entrevues que des chercheurs, conscients des controverses, hésiteraient à donner à d’autres reporters. C’est ainsi que le journalisme scientifique éclaire le débat public — du moins, quand on lui en laisse la chance.
Pour que florisse ce journalisme capable de tirer parti des connaissances objectives, il faut nécessairement former la relève. Cette année encore, six stagiaires en journalisme se feront la main sur les centaines de présentations du congrès de l’Acfas : Anne-Marie Duquette, Rachel Hussherr, Édith Jolicoeur, Isabelle Neveu, Laurie Noreau, Geneviève Quévillon et Pascal Royer-Boutin, que j’aurai l’honneur d’accompagner. Vous pourrez lire en ces pages le fruit de leur travail, mais je sais d’avance que les congrès de l’Acfas sont toujours, pour un journaliste scientifique, un extraordinaire terrain de jeu!
- Jean-François Cliche
Journaliste scientifique, Le SoleilPrésentation de l’auteurAprès des études en histoire et en sociologie, Jean-François Cliche s’est joint à la rédaction du Soleil en 2001. Il y couvre les actualités scientifiques depuis 2006. Il est co-auteur, avec le mathématicien Jean-Marie De Koninck, des livres En chair et en maths (tomes 1 et 2) et ses chroniques ont été publiées sous forme de recueil chez MultiMondes en 2011.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre